
POUR UNE PSYCHOLOGIE OUVERTE À CE QUI VIENT DE L’AVENIR – Introduction
- Posté par Guillaume Lemonde
- Catégories Articles, Démarche Saluto, Relation thérapeutique, Temporalité
- Date 12 mai 2023
Bonjour ! Au cours des prochains mois, je vais vous faire participer de temps à autre à l’écriture d’un ouvrage et cela commence aujourd’hui ! Vous allez trouver ici un premier chapitre. Il va probablement éveiller en vous des questions, des remarques, des incompréhensions. Je souhaiterais que vous les écriviez en commentaire (je ne prendrai pas en compte les messages me parvenant par d’autres voies.). Cela me permettra, un peu comme lors d’un échange épistolaire, d’aller plus loin et de préciser toujours plus avant ce que je tiens à partager avec vous. D’avance, je vous remercie pour vos contributions précieuses et pour l’assiduité avec laquelle, chaque semaine, vous êtes au rendez-vous. En vous souhaitant bonne lecture, je vous adresse mes plus fraternelles salutations. Guillaume Lemonde

Pour une psychologie ouverte à ce qui vient de l’avenir – UNE TÉLÉO-PSYCHOLOGIE
INTRODUCTION
Lorsqu’une personne se présente à la consultation, elle se trouve à une étape de son chemin qui se déploie de la naissance à la mort. Cela va de soi. Mais nous allons voir que cette évidence, si elle était approfondie, pourrait être d’une grande aide pour le psychologue (1). En effet, toute expérience humaine, les maladies, les crises, les événements, qu’ils soient heureux ou malheureux, ne sont que des instants de ce grand voyage. Habituellement nous considérons chacun d’eux pour soi-même, indépendamment du reste. Nous leur trouvons une origine et espérons une conclusion heureuse. Pourtant chaque moment est en lien en permanence avec tout ce qui a été depuis le début du voyage et tout ce qui sera jusqu’à son ultime aboutissement. À chaque étape d’un voyage, le début et la fin du parcours se rencontrent.
Nous sommes en lien avec le début, lorsque nous nous souvenons du déroulé des événements (que s’est-il passé depuis le début du chemin pour que j’en sois là aujourd’hui ?). Nous sommes en lien avec la fin, quand nous nous retournons sur le trajet et constatons que chaque étape était nécessaire pour être là où nous sommes arrivés.
Tandis que nous traversons une épreuve, il est facile de se tenir au début du chemin. Il suffit de nous remémorer les circonstances de départ et les projets que nous avions. Il suffit de les prolonger en émettant des souhaits pour la suite. Le psychologue est compétent pour dresser une telle anamnèse. En revanche, se tenir à la fin de l’épreuve que nous sommes justement en train de traverser est une autre affaire. Ce serait comme pouvoir se souvenir dès maintenant du progrès intérieur que nous constaterons un jour lorsque nous nous retournerons sur le chemin parcouru ; ce serait se souvenir d’un talent que nous n’avons pas encore acquis.
Comment fait-on cela ? Est-ce seulement possible ? Si tel était le cas, ce serait très précieux. Nous pourrions d’ores et déjà faire l’expérience de ce que nous avons à exercer pour traverser l’épreuve. Nous saurions concrètement où diriger notre attention. Plutôt que de souffrir des circonstances rencontrées depuis le début du parcours, nous resterions orientés.
C’est un peu comme lors d’une randonnée en montagne. La comparaison a ses limites, mais elle peut avantageusement illustrer ce propos : imaginons que nous ayons le projet d’atteindre un sommet. Nous rencontrons un torrent qui dévale la pente. Il nous empêche de poursuivre. Du point de vue de ce que nous avions projeté, c’est à dire du point de vue du début de l’histoire, nous croyons avoir été détourné par le torrent. Cependant, le sommet que nous voulons atteindre a ses propres exigences. Il est comme il est, situé où il est, indépendamment de ce que nous souhaitons. Du point de vue de cette donnée concrète, du point de vue de l’avenir, notre trajet n’est pas un détour, mais le seul passage possible.
Quand nous regardons le chemin depuis le sommet et non depuis le point de départ, nous comprenons que le trajet ne se forme pas à partir de ce que nous avons prévu, mais à partir de l’endroit où nous allons arriver. Et cet endroit est une réalité complètement indépendante de ce que nous pouvons porter comme désirs, comme aspirations ou même comme idéaux. De même, le progrès intérieur que nous constaterons un jour lorsque nous nous retournerons sur le chemin parcouru, ne dépend pas de ce que nous aimerions bien aujourd’hui. Il ne dépend pas de ce que la personne que nous sommes se fait comme idées à ce sujet.
Lorsque nous marchons en montagne, nous faisons l’expérience que le chemin n’est pas une pure création personnelle. Il est une réalité avec laquelle nous nous confrontons personnellement et qui se dessine objectivement à partir de son aboutissement. En somme, lorsque nous faisons chemin, nous apprenons à glisser nos pas dans ce que l’objectif attend objectivement de nous. Le sujet qui fait chemin et l’objet du chemin se rencontrent à tout moment.
Mais quel est l’objet du chemin de notre vie ? Quel progrès intérieur attend, dans notre avenir, de devenir présent. Nous l’ignorons.
Nous marchons dans la vie tels des amnésiques qui ont oublié le sommet qui les attend quelque part. Nous tombons sur un torrent et comme il nous empêche d’aller dans la direction que nous avions prise, le désir de le franchir devient une fin en soi. La réalité objective du chemin fait place à une subjectivité contrariée, tandis que nous déambulons d’obstacle en obstacle, incapable de nous tenir aux réalités du monde. Pour nous, le chemin semble ne dépendre que du hasard et se former à mesure que nos aspirations sont empêchées ou réorientées par toutes sortes de circonstances inattendues.
Nous nous rendons alors chez le psychologue ou chez le médecin et nous exposons nos mésaventures. Nous passons en revue les étapes de notre trajet, celles qui pourraient expliquer pourquoi nous en sommes arrivés là. Nous examinons nos aspirations afin de résoudre ce qui nous empêche de les concrétiser ou d’en trouver d’autres. Cependant, comme nous ne savons pas qu’un sommet nous attend quelque part, nous ne prenons pas en compte l’éventualité que tout ce que nous vivons est peut-être à mettre en relation avec lui. Sans lui, nous n’avons de concret que des obstacles, mais rien qui puisse nous donner un appui pour décider d’une autre direction. Seul notre vécu fait loi.
Au mieux, nous nous convainquons que ce que nous vivons n’est pas en vain. Et nous nous construisons un système de croyances, qui tout à la fois nous rassure et nous enferme dans une illusion. Il nous enferme dans une illusion, puisqu’il est produit par nous-même au lieu d’être à la rencontre entre nous-même et le monde. Nous sommes alors perdu, orphelin du monde, centré sur nos désirs. La subjectivité est source d’illusion au moment où elle ne sait plus comment rencontrer les faits qui ne dépendent pas d’elle.
Si nous pouvions percevoir concrètement ce que le chemin attend de nous, nous gagnerions en liberté. Nous pourrions, chacun à notre manière, avec la fantaisie qui nous est propre, nous orienter à une réalité ne dépendant pas de nous-même. Une réalité tout aussi objective que le nord magnétique que nous repérerons avec une boussole.
Depuis Descartes, l’Université de médecine se refuse à penser que quelque chose, au-delà de notre personne, puisse orienter le chemin de notre existence. Cette pensée prenant en compte une cause qui dans l’avenir rend nécessaire ce qui se vit maintenant, est difficilement acceptable au sein de l’Université, puisqu’en contradiction avec les lois de la thermodynamique et la flèche du temps. Celles-ci nécessitent que les causes précèdent leurs effets et non l’inverse. Elles nécessitent que rien depuis l’avenir ne puisse agir dans ce que nous vivons actuellement.
Pourtant, si nous tenons pour évident que l’existence dont nous avons conscience se déploie entre un début et une fin, et que chaque moment du parcours entretient forcément un rapport particulier avec ces deux bornes, nous devons les prendre toutes les deux au sérieux. Il n’est pas possible de continuer à chercher l’origine des problèmes que nous traversons en les regardant à partir d’une antériorité que l’on projette vers la fin, sans essayer de percevoir également notre histoire à partir de son accomplissement qui éclaire tout le trajet depuis la fin jusqu’à son commencement. Ce serait comme s’obstiner à penser une existence qui aurait un début, mais où la fin ne représenterait rien d’autre que l’arbitraire interruption de ce qui se développe depuis le début. Ce serait une existence que l’on voudrait finalement perpétuelle, telle que la rêvent certains chercheurs influencés par la pensée de Descartes.
Il est essentiel de découvrir comment percevoir, dans notre vie, ce qui depuis la fin du voyage pourrait éclairer l’étape que nous sommes en train de traverser aujourd’hui. Certes, lorsque nous considérons que rien n’est jamais joué, la question d’une cause située dans l’avenir peut paraître absurde. Serions-nous déterminés depuis l’avenir ? Y-aurait-il un destin dont nous serions le jouet ? Nous verrons que la question ne se pose pas ainsi. Le randonneur n’est pas le jouet du sommet qu’il veut atteindre. Mais avant d’aller plus avant dans ces considérations, le fait même qu’il y aura une fin à notre parcours devrait suffire à ce que nous la prenions au sérieux. Alors comment penser à partir d’une cause située dans l’avenir ? Comment penser à partir d’une donnée qui ne soit pas subjective, c’est-à-dire dépendante du sujet et de ses désirs, de ses espoirs et de ses croyances, mais qui soit bel et bien objective ? Comment percevoir cette donnée lors d’une rencontre, la reconnaître ? Car, dans les faits, la perception de cette réalité à venir serait ce qui permettrait d’orienter la personne venant consulter. Tel sera le sujet de cet ouvrage.
(1): ce qui va suivre sera d’une grande aide pour toute personne en relation avec une autre : pour le médecin, l’éducateur, l’enseignant, le conseiller, le coach, mais aussi le parent, l’ami, etc. Toutefois, dans ce texte, nous nous intéresserons au domaine thérapeutique.
À SUIVRE
Guillaume Lemonde
Médecin, chercheur, développe et enseigne la démarche Saluto dans ses différents champs d'application. Après des études de médecine à Lyon, il découvre la pédagogie curative et la sociothérapie, alliant la pédagogie et la santé. Pour lui, la question de toujours est d’offrir l’espace et les moyens permettant à chacun de devenir acteur de sa vie. Il ouvre un cabinet en Allemagne où il poursuit ses recherches dans le cadre de l’éducation spécialisée, puis en Suisse.
À partir de l’étude des grands chapitres de la pathologie humaine, il met en évidence quatre étapes de la présence à soi et au monde (1995) et découvre et développe à partir de cette recherche la Salutogénéalogie (2007) et la démarche Saluto (2014).
Il donne des conférences et des séminaires de formation pour enseigner cette démarche.
Il est auteur de publications faisant état de ses travaux.
Vous aimerez aussi

LES VOYAGEURS DE LA STEPPE
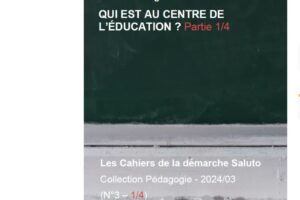
QUI EST AU CENTRE DE L’ÉDUCATION
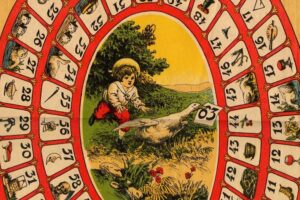

21 Commentaires
“La logique nécessite que les causes précèdent leurs effets et non l’inverse. Elle nécessite que rien depuis l’avenir ne puisse agir dans ce que nous vivons actuellement.” La logique reste logique : les causes produisent leurs effets, il n’y a que le courant du temps qui s’inverse… Si le temps flue depuis l’avenir (ce qui est tout-à-fait pensable), au lieu de venir du passé, la cause est en amont et produit les effets que je vis maintenant… Et d’une certaine façon, l’amont ne précède-t-il pas l’aval ?
Je pense à ce vers de Rainer Maria Rilke : “Le futur s’infiltre en nous afin de s ‘y transformer longtemps avant son arrivée”.
Dans ce texte, Guillaume, tu valorises l’objectivité et dans le subjectif tu places l’illusion. Mais n’est-on pas ébloui, quand on regarde les biographies de tel ou tel, par l’intelligence du sujet à déceler le chemin qui va au sommet sans savoir même, comme tu l’écris, où se trouve celui-ci…
Effectivement, ce que j’écris peut être compris comme une valorisation de l’objectivité. Il va falloir reprendre ce passage, car effectivement il n’y a pas d’intelligence et de créativité sans subjectivité, mais alors il s’agit de l’ouvrir à l’objectivité du monde. Ce qui est facteur d’illusion, c’est la subjectivité coupée de l’objectivité du monde, croyant que le monde tourne autour d’elle. La rencontre d’une subjectivité avec l’objectivité du monde, complète le monde de ce qui ne s’y trouve pas encore. Merci Monique
Merci pour ton commentaire, Monique. J’ai réécrit un paragraphe suivant : “Au mieux, on se convainc que ce que l’on vit n’est pas en vain, mais ce faisant, on se construit un système de croyances qui tout à la fois nous rassure et nous enferme dans une illusion. Il nous enferme dans une illusion, puisqu’il est produit par nous-même au lieu d’être à la rencontre entre soi-même et le monde. Nous sommes alors perdu, orphelin du monde, orienté sur nous-même et nos désirs. La subjectivité est source d’illusion au moment où elle ne sait plus comment rencontrer les faits qui ne dépendent pas d’elle. À l’inverse, si nous pouvions percevoir concrètement ce que le chemin attend de nous, nous gagnerions en liberté. Nous pourrions, chacun à notre manière, avec la fantaisie qui nous est propre, nous orienter à une réalité ne dépendant pas de nous-même. Une réalité tout aussi objective que le nord magnétique que l’on repère avec une boussole.”
Ah oui, ça me plaît beaucoup comme ça !
J’ai changé 2 ou 3 formulations dans le texte pour répondre à tes remarques. Merci
Bonjour Guillaume,
Merci de ta réponse à mon commentaire de la semaine dernière, aussi vais-je me permettre le tutoiement. Merci de ton offre de participation à cette démarche téléologique qui apparaît dans mon vécu actuel comme une belle synchronicité.
Correctrice et traductrice, dans un premier temps, je vais me contenter de pointer les “coquilles diverses et variées” que je pourrais remarquer et te faire des propositions pour des phrases trop longues dans lesquelles j’observe que je me noie et que je dois les relire plusieurs fois avant de comprendre où tu veux nous emmener.
Par exemple, dans la phrase : “La réalité objective du chemin fait place à une subjectivité contrariée tandis, que nous déambulons d’obstacle en obstacle, incapables de nous tenir aux réalités du monde.” il est clair que la virgule devrait se trouver avant “tandis” et non pas après. Et puis il y a “incapables” au pluriel alors que tu as écrit par ailleurs nous-même au singulier. Faire le choix du singulier ou du pluriel avec l’utilisation du “nous” est quelque chose qui me demande toujours de faire un choix difficile dans les textes que je traduis. Et pourquoi pas, dans ce texte-ci, faire le choix que tu as fait d’utiliser parfois le singulier et parfois le pluriel. Pourquoi pas ?
Pour la phrase : “Même si cette question paraît absurde lorsque l’on considère que rien n’est jamais joué, le fait même qu’il y aura une fin devrait suffire à ce que nous la prenions au sérieux.” je propose : “Certes, lorsque nous considérons que rien n’est jamais joué, cette question peut paraître absurde. Mais le fait même qu’il y aura une fin devrait suffire à ce que nous la prenions au sérieux.”
Et pour : “Comment penser à partir d’une cause finale, c’est-à-dire à partir d’une donnée qui devra être objective (ne pas dépendre du sujet et donc ne pas être la projection d’un désir ni même d’une croyance) et permettre d’orienter factuellement la personne (le sujet) venant consulter ?”, je propose : “Comment penser à partir d’une cause finale ? [Je veux dire par là :] Comment penser à partir d’une donnée qui ne soit pas subjective, dépendante du sujet et de ses projections possibles d’un désir ou d’une croyance ? Car, dans les faits,/ Car en réalité, c’est cet élément/ ce principe/ cette attitude intérieure qui permet d’orienter la personne (le sujet) venant consulter.
Gênée par “factuellement”, j’ai vu que cet adverbe n’apparaît pas dans mon dictionnaire qui certes date un peu…
Retraitée, j’offre volontiers mes services gracieusement aux écrivains qui traitent des sujets qui me tiennent profondément à coeur car ce travail me nourrit intérieurement. C’est une manière pour moi d’apporter ma contribution au monde d’aujourd’hui. Bien à toi, Mathilde
Merci beaucoup, Mathilde ! Je viens de corriger, avec gratitude pour ton apport.
Oups ! Petit rajout à ma proposition précédente qui n’était pas complète :
“Comment penser à partir d’une donnée qui ne soit pas subjective, c’est-à-dire dépendante du sujet et de ses projections possibles d’un désir ou d’une croyance, mais qui soit bel et bien objective ?”
Tout de bon,
Mathilde
Bonjour,
Merciiii mais pourquoi devrions nous être intrigué par cette vision :)?
Tous les jours je demande à mes clients que souhaite-t-il qu’il y ait marqué sur leur tombe, que ne veulent-ils jamais avoir regretté d’avoir fait avant de mourir. Je suis planificateur financier 🙂 c’est pourtant le seul moyen pour moi de mettre en place une stratégie financière et fiscale. Souhaitent-t-ils passer plus de temps avec leur famille ? Souhaitent-t-ils posséder le maximum de biens matériels ? Souhaitent-ils voyager et prendre leur retraite le plus tôt possible ?… Personne ne peut répondre à ces questions s’interroger, non pas sur son sens existentiel, mais tout simplement sur ses frustrations et ses peurs que nous devons combler pour pouvoir continuer notre chemin…. Tant que je n’ai pas eu une Porsche j’en aurai toujours au fond de moi quelque part un petit peu envie même si je sais que c’est futile en revanche le jour où je l’ai eu je n’y ai plus jamais pensé….
Sans être croyant je me lève chaque matin en remerciant le patron de vivre la vie exceptionnelle magique incroyable que j’ai lorsque je prends ma douche d’eau chaude je me rends compte que dans l’histoire de l’humanité 0, 00001%des hommes ont pu prendre une douche d’eau chaude, se réveiller dans un bon lit, dans une chambre à la bonne température, prendre un bon café, avec un kiwi et une banane… Même le roi de France ni d’ailleurs n’a jamais pu avoir le luxe que j’ai dans la sécurité et la quiétude…
Le seul mantra donc j’ai besoin une fois par mois de me rappeler et que la vie est une fête et l’amour est sa musique, et c’est moi le dj.
Belle journée
Oui, David. Et je vois qu’il est bien difficile d’exprimer ce que je cherche à dire: ton commentaire me montre qu’il va falloir reformuler le premier paragraphe.
Regarder à partir de la fin, ce n’est pas regarder vers la fin. Lorsque je me demande ce que j’aimerais atteindre et ne pas regretter, je regarde vers la fin (donc depuis un point de vue placée au début d’un moment donné). C’est très précieux de le faire et trop souvent oublié. Mais qu’en serait-il si en plus, nous avions la possibilité de distinguer une réalité aussi concrète que le sommet d’une montagne et qui, dans l’avenir nous attend (comme si nous nous étions donné de la gravir et que nous ne nous en souvenions plus.) Une réalité qui ne dépend absolument pas de ce que nous souhaiterions voir écrit sur notre tombe. Qu’en serait-il si nos aspirations, nos rêves, nos souhaits, pouvaient rencontrer cette réalité que nous cherchons sans le savoir ? Et quelle est cette réalité dont nous n’avons pas conscience et que nous cherchons à travers nos épreuves ?
Bref… je vais réécrire 🙂
Chers amis, fort de vos remarques, j’ai pris un moment pour reprendre ce texte et vais passer à la suite. Comment est-ce pour vous désormais ?
Bonjour,
Je n’ai pas grand chose à ajouter aux propositions de Mathilde en ce qui concerne la forme car ses remarques pertinentes clarifient encore le propos, qu’il me semble avoir toutefois “compris” à la lecture initiale.
Je trouve cette approche vraiment innovante et inspirante. Il y a déjà environ 2 ans que je suis régulièrement “bousculée” par cette question de la temporalité et de notre façon de l’aborder depuis notre monde en 3D et notre pensée linéaire.
Il n’est pas facile de changer de point de vue mais l’image de la montagne que l’on gravit, permettant de faire se rencontrer l’objectivité du réel et la subjectivité du sujet rend plus “abordable”, en l’illustrant, la question envisagée.
Merci pour ce travail d’écriture, tout à fait pertinent, et que je suivrai avec grand intérêt 🙂
Namasté <3
Sinaya
Bonjour Guillaume,
Voici quelques nouvelles contributions, notamment pour éviter de passer du « on » au « nous » et rester tout du long dans le « nous », et quelques autres suggestions qui, selon mon expérience de secrétaire littéraire, si elles ne sont pas suivies à la lettre, parfois inspirent l’auteur qui les arrange à sa manière.
Tout de bon, Mathilde
de son chemin qui, entre la naissance à la mort, se déploie : de son chemin sur Terre/ terrestre qui se déploie entre la naissance et la mort / qui se déploie de la naissance à la mort
Cette évidence est triviale, mais nous allons voir qu’elle pourrait, si nous avions les moyens d’en faire quelque chose, devenir très utile au psychologue et au médecin. : Cela va de soi. Mais nous allons voir qu’utilisée à bon escient par le psychologue et le médecin, cette évidence pourrait lui être d’une très grande utilité/ extrêmement utile.
et à la fin du parcourt : parcours
Ainsi, à tout moment, nous sommes en relation avec le début lorsque nous regardons, à partir de là, le déroulé des événements (que s’est-il passé pour que j’en sois là aujourd’hui ?). Nous sommes également en relation avec la fin lorsqu’on se retourne sur le trajet. On perçoit alors que chaque étape était nécessaire pour être là où nous sommes arrivés. : Souvent, la personne se contente de se poser la question : « Que s’est-il passé qui fait que je sois là où je suis aujourd’hui ? Généralement, nous ne nous interrogeons qu’à propos du début de notre parcours. Et pourtant, à tout moment, nous sommes également en relation avec sa fin et notre aspiration la plus profonde./ son but et notre aspiration la plus profonde./ son objectif final et notre aspiration la plus profonde. Dès que nous en tenons compte, nous percevons que toutes les étapes étaient absolument nécessaires pour que nous soyons là où nous sommes arrivés.
Tandis que nous traversons une épreuve, il est facile de se tenir au début du chemin. Il suffit de se souvenir des projets que nous avions et de prolonger ce geste en émettant des souhaits pour la suite. Se tenir à la fin de l’épreuve que l’on est justement en train de traverser est une autre affaire. Ce serait comme pouvoir se souvenir dès maintenant des progrès intérieurs que nous percevrons un jour lorsque nous nous retournerons sur le chemin parcouru. : Lorsque nous traversons une épreuve, nous avons tendance à ne revenir que vers nos projets d’avant cette épreuve. Nous émettons alors des souhaits pour que ces projets se réalisent coûte que coûte. Mais de cette manière, nous ne tenons compte que du début du chemin. Ici, il est donc fort judicieux de ne pas oublier de prendre en compte sa finalité. Considérer le chemin parcouru de cette façon nous permet de prendre conscience de nos progrès intérieurs.
Comment fait-on cela ? Est-ce seulement possible ? Si tel était le cas, ce serait très précieux. Nous ferions l’expérience de ce que nous avons à exercer pour traverser l’épreuve. Au milieu de l’épreuve, nous resterions orientés, comme lorsqu’on se promène en montagne. : Au centre de l’épreuve, comment procéder pour rester orienté sur la totalité de notre parcours ? Qu’est-ce qui peut nous aider à découvrir ce que nous avons à exercer pour traverser l’épreuve, comme lorsque nous nous promenons en montagne ?
atteindre a ses : atteindre détient ses
Quand on regarde le chemin depuis le sommet et non depuis le point de départ, on comprend que le trajet ne se forme pas à partir de ce que l’on a prévu. Il se forme à partir de l’endroit où l’on va arriver. Un endroit qui n’est pas conformé selon ce que l’on souhaite, mais qui est une réalité indépendante de ce que l’on porte comme désirs, comme aspirations ou même comme idéaux. Ainsi, lorsque l’on marche en montagne, on fait l’expérience que le chemin n’est pas une pure création personnelle. Il est une réalité avec laquelle nous nous confrontons personnellement et qui se dessine objectivement à partir de son aboutissement. En somme, lorsque l’on fait chemin, on apprend à glisser ses pas dans ce que l’objectif attend objectivement de nous. Le sujet qui fait chemin et l’objet du chemin se rencontrent à tout moment. : Quand nous regardons le chemin depuis le sommet et non depuis le point de départ, nous comprenons que le trajet ne se forme pas à partir de ce que nous avons prévu, mais à partir de l’endroit où nous allons arriver/parvenir. Et cet endroit est une réalité complètement indépendante de ce que notre imaginaire peut porter comme désirs, comme aspirations ou même comme idéaux. Nous diriger vers un sommet montagnard, c’est donc faire l’expérience que le chemin n’est pas une pure création personnelle, mais une réalité avec laquelle nous nous confrontons personnellement et qui se dessine objectivement à partir de son aboutissement. En somme, lorsque nous cheminons, nous apprenons à glisser nos pas dans ce que notre objectif attend objectivement de nous. Le sujet qui chemine et l’objet du chemin se rencontrent à tout moment/ dansent ensemble/ cheminent ensemble.
Mais quel est l’objet du chemin de notre vie ? Nous l’ignorons. : Mais quel est l’objet du chemin de notre vie ? La plupart du temps, nous l’ignorons.
Nous marchons dans la vie : Tant et si bien que nous marchons dans la vie
une fin en soi. La réalité objective du chemin fait place à une subjectivité contrariée, tandis que nous déambulons d’obstacle en obstacle, incapable de nous tenir aux réalités du monde. Pour nous, le chemin semble se former à mesure que nos aspirations sont empêchées ou réorientées par toutes sortes de circonstances inattendues. Il semble ne dépendre que du hasard. : une fin en soi. Dès que nous sommes dans l’incapacité de faire face aux réalités du monde telles qu’elles se présentent à nous, nous nous mettons à déambuler d’obstacle en obstacle, et la réalité objective du chemin s’efface devant une subjectivité contrariée. C’est comme si le chemin ne dépendait que du hasard et se formait à mesure que nos aspirations sont empêchées ou réorientées par toutes sortes de circonstances inattendues.
comme nous ne savons pas : comme nous avons oublié
à mettre en relation avec lui. Sans lui, nous n’avons de concret que des obstacles, mais rien qui puisse nous orienter et nous donner un appui. : à mettre en relation avec lui. Oubliant notre objectif final, nous ne considérons plus que les obstacles. Tant et si bien que n’avons rien qui puisse nous orienter et nous donner un appui.
Au mieux, on se convainc que ce que l’on vit n’est pas en vain. On se construit un système de croyances qui tout à la fois nous rassure et nous enferme dans une illusion. Il nous enferme dans une illusion, puisqu’il est produit par nous-même au lieu d’être à la rencontre entre soi-même et le monde. Nous sommes alors perdu, orphelin du monde, orienté sur nous-même et nos désirs. La subjectivité est source d’illusion au moment où elle ne sait plus comment rencontrer les faits qui ne dépendent pas d’elle. : Au mieux, nous nous convainquons que ce que nous vivons n’est pas en vain. Et nous nous construisons un système de croyances qui tout à la fois nous rassure et nous enferme dans une illusion. Il nous enferme dans une illusion, parce que c’est un produit de notre imaginaire et non une rencontre/ une danse entre nous-même et le monde. Nous sommes alors perdu, orphelin du monde, centré sur nous-même et nos désirs. Une subjectivité devenue incapable de rencontrer les faits qui ne dépendent pas d’elle, est source d’illusion.
À l’inverse, si nous pouvions percevoir concrètement ce que le chemin attend de nous, nous gagnerions en liberté. Nous pourrions, chacun à notre manière, avec la fantaisie qui nous est propre, nous orienter à une réalité ne dépendant pas de nous-même. Une réalité tout aussi objective que le nord magnétique que l’on repère avec une boussole. : Alors que si nous percevons concrètement ce que le chemin attend de nous, nous gagnons en liberté. Chacun à notre manière, avec la fantaisie qui nous est propre, nous adhérons à une réalité/ nous consentons à une réalité/ nous participons à une réalité qui ne dépend pas de nous. Une réalité tout aussi objective que le nord magnétique indiqué par une boussole.
ce que nous vivons actuellement. : ce que nous vivons actuellement. Le moment est venu de tenir compte des lois de la physique quantique./ de la mécanique quantique/ des lois qui vont au-delà de celles de la physique classique.
Comment penser à partir d’une donnée qui ne soit pas subjective, c’est-à-dire dépendante du sujet et de ses projections possibles d’un désir ou d’une croyance, mais qui soit bel et bien objective ? Car, dans les faits, la perception de cette réalité à venir serait ce qui permettrait d’orienter la personne (le sujet) venant consulter. : Comment penser à partir d’une donnée qui ne soit pas dépendante d’une projection, d’un désir, d’une croyance, qui ne soit donc pas liée à une subjectivité déformée mais à une objectivité en lien avec la réalité ? Car c’est la perception objective de cette réalité à venir qui permet d’orienter la personne (le sujet) venant consulter.
Reformulation de ce passage : Ainsi, à tout moment, nous sommes en relation avec le début lorsque nous regardons, à partir de là, le déroulé des événements (que s’est-il passé pour que j’en sois là aujourd’hui ?). Nous sommes également en relation avec la fin lorsqu’on se retourne sur le trajet. On perçoit alors que chaque étape était nécessaire pour être là où nous sommes arrivés. :
Souvent, la personne se contente de se poser la question : « Que s’est-il passé qui fait que je sois là où je suis aujourd’hui ? » Généralement, nous ne nous interrogeons qu’à propos du début de notre parcours. Et pourtant, à tout moment, nous sommes également en relation avec l’objectif final de notre incarnation/ de notre nature véritable/ de notre nature essentielle. Dès que nous en tenons compte, nous percevons que toutes les étapes étaient absolument nécessaires pour que nous soyons là où nous sommes arrivés.
Cher Guillaume,
Merci d’offrir cette opportunité de penser plus loin….;-)
Cela m’amène à ceci:
Pouvons-nous réellement retrouver par nos propres moyens la mémoire du sommet que nous cherchons à atteindre ?
« Nous nous rendons alors chez le psy ou le médecin pour exposer nos mésaventures »
…nous cherchons à rencontrer quelqu’un qui lui-même n’est pas amnésique sur la réalité du sommet vers lequel nous cheminons.
L’action d’aller à la rencontre de quelqu’un, qu’il soit psy, médecin, amis, pédagogue ou tout autre, c’est placer de facto cette personne dans notre avenir donc devant nous sur notre propre chemin (que nous ou lui en soyons conscient ou pas).
L’instant de la rencontre propose 2 hypothèses :
1. Celui vers lequel nous avons cheminé s’’arrête dans l’instant de la rencontre *1. devant nous sur notre chemin et nous offre ainsi une perception objective de l’existence même de ce chemin qui est déjà présent mais encore à parcourir de notre point de vue.
2. Celui vers lequel nous avons cheminé laisse échapper l’instant de la rencontre *2. et se retrouve derrière nous, nous obligeant à nous retourner et ne voir que notre chemin déjà parcouru.
Alors peut être ne pouvons nous rien pour notre propre amnésie tant que personne ne s’arrête devant nous sur notre propre chemin mais par contre, étant nous-même appelé à venir rencontrer un autre, nous pourrions tenter de nous tenir, le temps de cette rencontre dans l’à venir de son chemin à lui..
Chaque rencontre devient l’opportunité de retrouver, le temps d’un instant, la mémoire du sommet qui dès lors met en évidence objective la cause du chemin entamé.
1. Se tenir devant l’autre, sans préjugés, projections, souvenirs. Se tenir de l’autre coté du torrent, tendant la main à celui qui cherche à le traverser.
2. Se laisser envahir par les projections, par la nécessité d’avoir une réponse adéquate aux besoins et attentes de l’autre. Prévoir comment l’aider à traverser un torrent dont nous ignorons l’existence .
Je ne l’aurais pas mieux dit. Ce sera le sujet d’un chapitre consacré à la rencontre thérapeutique. Merci !
1. agir
2.réagir
Bonjour Guillaume,
Je suis de plus en plus impactée par cette formulation que vous proposez de considérer les choses à partir de leur finalité, ce que je pressentais sans savoir le formuler avec autant de clarté que vous le faites. Donc merci.
Quelques dernières petites choses après le remaniement de votre texte :
entre la naissance à la mort : entre la naissance et la mort (il me semble qu’on ne peut pas écrire entre qqc à qqc, mais entre qqc et qqc, non ?), autre formulation possible : qui se déploie de la naissance à la mort.
c’est à dire : c’est-à-dire
Et encore deux suggestions :
des amnésiques qui ne savent pas : des amnésiques qui ont oublié
le nord magnétique que nous repèrerons : que nous repérons
Tout de bon, et encore MERCI. Mathilde
Un tout grand merci, Mathilde. J’ai corrigé le texte, ajouté une remarque au dernier paragraphe et me penche désormais sur la suite.
Bonne journée.
Soyez tous remerciés pour vos commentaires ! Je me penche désormais sur la suite. Bonne journée à tous !