
LE SAVIEZ-VOUS ? LA DISTANCIATION SOCIALE N’EST PAS DUE À UN VIRUS !
- Posté par Guillaume Lemonde
- Catégories Actualité, Chroniques Contemporaines et Pensées, Relation thérapeutique, Santé et maladie
- Date 7 août 2020
 https://pixabay.com/fr/users/matryx-15948447/
https://pixabay.com/fr/users/matryx-15948447/
J’aimerais vous parler aujourd’hui de notre rapport à l’autre, de la distance sociale, mais aussi du vaccin qui va nous être imposé.
J’aimerais que vous puissiez réfléchir aux lignes qui vont suivre et à la conclusion de ce texte. J’ai conscience qu’il ne se lit pas en diagonale. Il demande un peu d’attention. Je serais heureux si vous pouviez partager, tout en bas de cette page, pour la communauté qui chaque jour plus nombreuse lit ces articles, vos réflexions sur le sujet.
***
J’aimerais commencer ce partage par un constat.
Ce constat, c’est que de ce côté du monde, nous avons perdu tout rapport à plus grand que nous-mêmes : nous en sommes arrivés à croire qu’il n’y a rien au-dessus de nous, seulement un ciel étoilé où nous envoyons des sondes en quêtes de mondes habitables.
Le cosmos, loin d’avoir comme pour les Anciens une action sur nos vies, a été relégué au rang de possibles possessions auxquelles certains rêvent. C’est nous qui désormais prétendons dominer l’univers, de loin pour commencer, avec nos télescopes, espérant planter un jour de petits drapeaux sur ces futures conquêtes.
Nous sommes seuls, seuls au monde, seuls responsables de nos vies. Du moins, nous le croyons. Ce qui nous arrive ne dépend plus que de nous. Rien au-dessus de nous ne nous destine à rien. C’est à nous de décider et aucune Grâce ne nous sera faite. L’instance à laquelle nous nous en remettions, il y a quelques siècles encore, semble n’être plus là pour personne. Si nous voulons le bonheur, il ne dépend que de nous de le vouloir. Si nous voulons trouver l’amour, la fortune, le plaisir, c’est à nous de faire l’effort.
Chacun d’entre nous est renvoyé à soi-même. Dans un grand mouvement de subjectivation, chacun se consacre à sa propre réalisation et à son épanouissement. On se recentre sur soi, on s’introspecte. C’est dans l’esprit du temps. La vacuité du Cosmos s’est emplie du désir de chacun de réussir sa vie. L’humanité s’est atomisée autour des valeurs que nous donnons individuellement à notre existence.

https://pixabay.com/fr/users/theartofsounds2001-4501413/
Ainsi, l’absence de transcendance a rendu indispensable la quête du bonheur individuel.
Une vie réussie n’est-elle pas une vie heureuse ? Les anciens Grecs se posaient déjà la question. Cependant, en perdant toute référence universelle, nous avons fait du bonheur le produit de notre seule volonté. Loin d’être reçu de plus haut, en mérite de nos vertus, le bonheur est tombé au niveau du bien-être et des plaisirs que nous pouvons nous accorder nous-mêmes.
C’est pour le bien-être que nos contemporains se démènent désormais. Ils rêvent d’une vie plus confortable, aspirent à ce que leurs désirs soient exaucés, même les plus fous.
***
NOUS AVONS FAIT DU BIEN-ÊTRE ET DU PLAISIR DE CHACUN, UNE FIN EN SOI, le Saint Graal d’une vie accomplie.
Il faudrait que le monde réponde à nos désirs et que le plaisir soit facile à obtenir… Il faudrait qu’il n’y ait pas de maladies, pas de souffrance… Seulement, le monde ne répond pas souvent aux désirs qui nous creusent.
Il y a de la frustration, de l’inconfort, de la peine, des émotions désagréables, des douleurs de l’âme, qui deviennent des douleurs du corps, à force de ne pas vouloir les ressentir. Nous sommes démunis devant ces phénomènes qui n’entrent pas dans nos plans.
Comme par exemple devant un virus qui fait parler de lui…
Alors nous espérons des moyens, des moyens pour retrouver le bien-être perdu.
 https://pixabay.com/fr/users/fotoblend-87167/
https://pixabay.com/fr/users/fotoblend-87167/
Si ces moyens pouvaient nous obtenir facilement ce bien-être perdu, histoire de ne pas ajouter à la frustration, s’ils pouvaient être simples à suivre et avoir des effets rapides, ce seraient mieux encore.
Comme un vaccin par exemple…
Mais il est important de comprendre qu’en refusant à tout prix l’inconfort de quelque souffrance que ce soit, en refusant par exemple le risque de tomber malade, c’est ni plus ni moins la réalité elle-même que l’on finit par refuser : car seule la réalité fait mal. Elle est rugueuse et solide. Elle présente des angles contre lesquels on se heurte.
En la refusant, on se réfugie dans le rêve et on rêve sa vie plutôt qu’on ne la vit.
Du coup, des marchands de rêves se présentent. Ils répondent à notre mal-être existentiel en nous promettant des guérisons miraculeuses, comme avec un vaccin, par exemple… et nous les croyons.
***
LES MIRACLES NE PEUVENT PAS S’ACCOMPLIR DANS LES RÊVES.
S’ils s’accomplissent, les miracles ne peuvent se rencontrer qu’au cœur de la réalité. Là où ça fait mal, là où l’on peut souffrir. Au moment même où l’on éprouve une souffrance.
(Ce qui ne signifie pas qu’il faille rechercher la souffrance, mais ne pas fuir la possibilité qu’elle puisse se présenter…)
En réalité, lorsqu’on essaie d’éviter une souffrance, on rend impossible qu’un miracle advienne. On pense la chose plutôt qu’on ne la vit. C’est ça que j’appelle rêver : être à côté de la vie par l’imagination ou la pensée, même la plus cartésienne. Cela revient au même : on fuit la réalité.
Le plus absurde est que dans cette vie rêvée, on pense pouvoir rationnellement contraindre les évènements en notre faveur. Pour que nous reprenions notre vie en main – comme on dit – les vendeurs de rêves nous murmurent que nous pourrions, avec des techniques, conjurer le mauvais sort et les influences néfastes. On se sent capable d’empêcher le temps de nous conduire là où l’on ne veut pas aller, capable de maîtriser l’avenir. Il n’y a pas d’obstacles dans les rêves, pas de contraintes. On se sent tout puissant.
Mais ce qui est propre à l’avenir, c’est justement qu’on ne peut pas le maîtriser, on ne peut pas le prévoir.
On ne prévoit que ce que l’on connait du passé et que l’on projette plus loin. L’avenir, ce qui advient, ce qui s’approche depuis l’autre côté, reste absolument mystérieux.
Ainsi, en faisant tout pour chasser toute forme de souffrance de notre vie, on chasse également le mystère. On se ferme à l’avenir.
***
ON NE PEUT PAS S’AFFRANCHIR DE LA POSSIBILITÉ DE SOUFFRIR.
En essayant de fuir le risque de souffrir, on refuse que certaines choses puissent ne pas dépendre de nous et que nous puissions ne pas les maîtriser.
D’ailleurs, c’est peut-être parce que nous ne pouvons pas percevoir, à travers l’avenir qui vient à nous, une volonté plus élevée que la nôtre, ainsi que les (réels) miracles qui peuvent l’accompagner, que nous refusons toute forme de souffrance.
Mais nous découvrirons un jour que nous n’avons pas à vouloir maîtriser la souffrance pour la faire disparaitre (puisque c’est impossible), mais à trouver, avec l’aide de plus grand que soi, comment ne pas nous laisser corrompre par la elle, ce qui est radicalement autre chose.
Et quand je dis, plus grand que soi, je veux dire tout ce qui n’est pas soi. Plus grand que soi commence par l’altérité. Car lorsque je m’ouvre à l’autre, sans chercher pour moi-même l’assouvissement d’un confort, d’un plaisir, d’une consolation, alors même que je souffre, je découvre en moi ce qui ne souffre pas !
***
PROBABLEMENT ÉTAIT-IL CAPITAL que nous en venions à repousser de toutes nos forces la possibilité de souffrir.
Probablement était-il capital que nous choisissions de prendre le bien-être et le plaisir comme des fins en soi. Que nous en venions à préférer l’illusion du rêve, plutôt que la réalité du monde[1].
Il était essentiel que nous en venions à refuser, avec la réalité, le temps qui passe, et que nous nous plongions dans l’assouvissement impatient de désirs égocentrés et dans d’éphémère impressions renouvelées de plaisir.
Nous avions à perdre la mesure des engagements de longue durée. Il fallait que la fidélité, l’effort ou le devoir, présupposant l’idée de prolongement dans le temps et de dépendance à l’égard d’un autre, deviennent des valeurs caduques[2]. La réalité de l’autre est pénible pour qui veut rêver.
Probablement était-il nécessaire que nous allions jusque-là.
Nous avions à être ramenés à rien d’autre qu’à nous-mêmes, de façon à ce que la réalité nous rattrape, à travers la souffrance.
 https://pixabay.com/fr/users/ramdlon-710044/
https://pixabay.com/fr/users/ramdlon-710044/
Car la souffrance qui nous isole aussi bien que la peur de souffrir, et qui conduit certains gouvernements à imposer la distanciation sociale, nous interroge du même coup sur le lien que nous entretenons avec le monde, les autres et ce qui nous dépasse.
Comme je le disais, c’est parce que nous sommes appelés à nous éveiller aux autres et à plus grand que nous-même, que nous nous trouvons démunis face à la souffrance.
Ainsi, démunis que nous sommes, nous prenons des mesures de toutes sortes pour éviter de souffrir. Comme par exemple les gestes barrières et la distanciation sociale… en attendant un vaccin.
Autrement dit, c’est parce que nous sommes appelés à nous éveiller aux autres et à plus grand que nous-même, que nous avons à vivre avec la distanciation sociale. (ce n’est pas à cause d’un virus, devenu d’ailleurs si peu virulent que les nouveaux cas dépistés ne s’accompagnent pas d’une augmentation des hospitalisations et des morts dans les mêmes proportions. On collecte les nouveaux cas dépistés, alors qu’il faudrait regarder combien il y a de nouveaux morts.)
Le virus n’est qu’un prétexte extérieur. L’épidémie est terminée en Europe et elle reprendra comme chaque année à l’automne.
La véritable raison de l’actuelle distanciation n’est donc pas à chercher dans ce qui s’est passé jusque-là. Elle est à chercher dans l’avenir : dans un éveil à venir, un éveil à l’autre et à plus grand que soi, un éveil que chacun est appelé à rendre présent.
La distanciation sociale est l’ombre portée de cet éveil à venir.
Et cet éveil se fait. Il se fera. C’est pourquoi il est probable que cette mesure sanitaire (?) nous accompagnera encore bien longtemps.
(Tandis que le vaccin qu’on nous promet, en se proposant d’empêcher la maladie, répondra à une logique court-circuitant cet éveil à venir.)
Voilà ce que je voulais vous transmettre aujourd’hui.
À méditer…
Si cet article vous parle, n’hésitez pas à le partager avec vos amis. Merci.
Bien à vous
Guillaume Lemonde
[1] Au point que certains rêvent de fuir la réalité de notre monde pour partir à la conquête de l’espace et de tout recommencer ailleurs.
[2] Julia de Funès, Le développement (im)personnel.
BLOG – DERNIERS ARTICLES MIS EN LIGNE
Médecin, chercheur, développe et enseigne la démarche Saluto dans ses différents champs d'application. Après des études de médecine à Lyon, il découvre la pédagogie curative et la sociothérapie, alliant la pédagogie et la santé. Pour lui, la question de toujours est d’offrir l’espace et les moyens permettant à chacun de devenir acteur de sa vie. Il ouvre un cabinet en Allemagne où il poursuit ses recherches dans le cadre de l’éducation spécialisée, puis en Suisse.
À partir de l’étude des grands chapitres de la pathologie humaine, il met en évidence quatre étapes de la présence à soi et au monde (1995) et découvre et développe à partir de cette recherche la Salutogénéalogie (2007) et la démarche Saluto (2014).
Il donne des conférences et des séminaires de formation pour enseigner cette démarche.
Il est auteur de publications faisant état de ses travaux.
Vous aimerez aussi
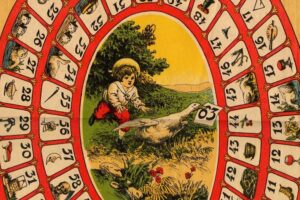
NOTRE VIE N’EST-ELLE QU’UNE SUCCESSION D’ÉVÉNEMENTS ?




13 Commentaires
Bonjour Guillaume,
Excellent article. En revanche, je n’arrive pas à saisir où tu veux en venir avec cette phrase:
“Autrement dit, c’est parce que nous sommes appelés à nous éveiller aux autres et à plus grand que nous-même, que nous avons à vivre avec la distanciation sociale.”
je n’arriva pas à saisir le rapport entre l’éveil à plus grand que soi et la distanciation sociale.
Si quelqu’un pouvait éclairer mes lanternes !
Bonjour Danilo, merci pour ta remarque. C’est effectivement un point délicat. Pouvais-tu comprendre que nous avons fait du bien-être une fin en soi (démunis que nous sommes face à la souffrance), car nous sommes renvoyés à nous-mêmes, seuls dans l’univers ?
Ainsi, la souffrance face à laquelle nous sommes démunis est à la mesure de la nécessité de redécouvrir que nous ne sommes pas seuls. Autrement dit, nous sommes appelés à nous éveiller aux autres et à plus grand que nous-mêmes.
En attendant nous prenons toutes sortes de mesures visant à calmer la peur de souffrir et de tomber malade.
Les mesures de distanciation sociale sont l’expression d’une nécessité à s’éveiller aux autres. Elles sont l’ombre projetée de cette nécessité.
Plus clair pour toi ?
Merci pour ces explications.
J’essaie de commenter. Ce sentiment de ne rien devoir à l’autre ou à plus grand que soi est une impasse absolue dans laquelle on peut rester bloqué si on en masque l’absurdité vaine en s’évadant dans le rêve, et en restant dans une relative inconséquence à l’égard de ce sentiment. Les prescriptions révoltantes des décrets cherchant à nous imposer la distanciation sociale nous placent de force dans un réveil vis à vis de la réalité des implications de ce sentiment. “Voilà ce que ça donne si on va au bout. C’est ça que tu veux ?” Ben non ! Il nous faut sans doute revoir la posture 😉
C’est bien ça ?
Effectivement. Et ce qui est central dans votre commentaire, c’est le “C’est ça que tu veux ?” Il y a une question qui se présente à chacun de nous. Il y a un choix à faire. Un choix de chaque instant, jamais définitif, à réactualiser toujours. Ce choix se donne dans le contexte de crise. Mais l’éveil n’est pas automatique : les crises n’éveillent pas les consciences. Elles proposent juste la possibilité du choix. On peut suivre ce qui est naturel en nous et continuer jusqu’à la prochaine crise. On peut s’ouvrir à autre chose. J’aimerais ajouter que cette possibilité de s’ouvrir à autre chose et de s’éveiller un jour au monde, est la raison dans l’avenir des crises qui se présentent aujourd’hui.
Merci pour cet article. Quelqu’un a proposé de modifier le terme et de parler de distance A-sociale. Qu’en pensez-vous ?
DISTANCE – SOCIALE est un anti-concept. (Comme on en trouve dans la nov-langue de 1984). On peut se distancier des personnes mais pas de l’élément social dans lequel on interagit. En soi, la distance n’est pas sociale. Ne pas interagir est asocial.
Chaque remède porte en lui la possibilité de déséquilibrer ce que l’on voulait soigner. Ainsi, la distanciation que certains imaginaient bénéfique pour la préservation de la société, porte en elle ce qui détruit la société. Cela est déjà bien visible dans les conséquences financières du confinement. Donc oui, distance a-sociale, serait plus juste.
Merci de votre précision
Cet article est passionnant et particulièrement touchant. Il reflète exactement toutes les contradictions et les déchirements que je ressens en moi depuis quelques temps. En réalité, l’être humain est doué pour expérimenter le côté sombre de toute chose avant de connaître le côté lumineux (que ce soit conscient ou inconscient). En voulant éviter la souffrance, nous nous maintenons en fait dans une sorte d’état de végétation (je ne trouve pas le bon mot pour exprimer ce que je ressens), nous préférons rester dans une “réalité” inconfortable mais que nous connaissons et répéter les erreurs du passé car nous avons l’impression (fausse) de maîtriser, plutôt que de faire confiance à ce qui nous dépasse pour appréhender l’avenir. Je ne sais pas si je suis claire, mais cela raisonne en moi très fort. Merci pour cet article, en effet, cela fait du bien de se rappeler que cela ne dépend pas (que) de nous. Personnellement, c’est cette foi et cette confiance qu’il me semble avoir perdues depuis trop longtemps (d’ailleurs à titre personnel je ne suis pas sûre de les avoir déjà expérimentées?)…
Merci Noémie pour ce partage. J’aime bien “état de végétation – ou état végétatif”. Nous suivons naturellement toutes sortes de mécanismes naturels bien connus aujourd’hui par la neuroscience, et qui nous poussent à vouloir toujours plus en faisant toujours moins d’effort (toujours plus de confort, de nourriture, d’information, etc.) Cela conduit aux extrémités que l’on connait aujourd’hui. Et même si nous mettons beaucoup d’énergie et de savoir-faire pour répondre à ces besoins profonds, ils ne sont que des besoins mécaniques (biologiques) qui nous dirigent. Nous sommes esclaves de notre nature. Et donc soumis à cet aspect végétatifs.
Cependant, il existe en nous un espace, un endroit silencieux, à partir duquel il est possible d’agir et non de réagir. Il est possible de traverser la peur (de manquer, de mourir, d’être blessé, etc.) en silence et de vivre cette absolue confiance.
Il me semble que la confiance est déjà là dans l’évidence qu’il existe quelque chose d’autre qui nous dépasse et que, de ce fait, même dans les crises, les choses sont comme elles doivent être. Elles sont comme offertes à notre choix de nous ouvrir à plus grand. Il me semble que cette évidence est chez toi et que la confiance, comme ressource importante, n’est jamais très loin.
Lu dans Wikipedia :
Dans l’étymologie latine, le verbe confier (du latin confidere : cum, « avec » et fidere « fier ») signifie qu’on remet quelque chose de précieux à quelqu’un, en se fiant à lui et en s’abandonnant ainsi à sa bienveillance et à sa bonne foi. Cette origine souligne les liens étroits qui existent entre la confiance, l’espoir, la foi, la fidélité, la confidence,. le crédit et la croyance.
Pour oser faire confiance, il faut à mon avis avoir pu ressentir, au moins une fois, que l’autre (ou l’Autre) est digne de la recevoir, et qu’on ne va pas être trompé.
La confiance est donc intimement liée à la foi.
Mais… en qui, en quoi sommes-nous prêts à croire ?
Merci Guillaume
Cela me renvoie à cette expression du Coran, où Dieu est défini comme “le Maitre de la présence et du mystère”