
QUAND LA MÉDECINE FAIT DISPARAITRE LE MALADE…
- Posté par Guillaume Lemonde
- Catégories Articles, Santé et maladie
- Date 5 novembre 2021

L’HUMAIN COMME UN FAIT EXTÉRIEUR
L’amphithéâtre de la faculté de médecine Alexis Carrel, avec ses 500 places en surplomb de l’estrade, nous rassemblait chaque après-midi après nos stages hospitaliers du matin. Des professeurs se succédaient pour nous parler de molécules et de conduites à tenir. Dans le secret de l’hémicycle, nous était confiée la somme énorme du savoir de nos pairs. Nous devenions médecins à travers un lent processus d’assimilation. L’amphithéâtre, tel un temple duquel nous sortirions un jour transformés, nous avait avalés pour plusieurs années. Il nous dépiautait de nos fantaisies et ne s’intéressait qu’à nos têtes. Il les voulait froides et précises. Rigoureuses et professionnelles. Dépouillés de sentiments, nous regardions l’humain tel un fait extérieur sur lequel nous nous penchions comme sur un gigot. Cela n’empêchait pas d’avoir du respect, de la bienveillance et de la compassion pour le monsieur qui se trouvait dans la chambre n°18 ou la dame du 23. Mais la qualité de la rencontre que nous pouvions avoir avec eux n’avait aucune incidence sur notre activité. Ce qui nous occupait, c’était la défectuosité corporelle qui les amenaient à l’hôpital. C’est cela que j’entends lorsque je dis que nous regardions les gens tels des faits extérieurs. Nous les rapportions à des normes générales.
Ainsi, les études de médecine nous ont conduits au cœur de la matière. Ce fut une lente descente au tombeau où gît le corps, sans âme, détaché de l’esprit. Ce point de vue d’amphithéâtre selon lequel l’humain est traité comme un fait extérieur, n’a pas varié depuis la fondation des premières universités au XIIIème siècle. Il s’est simplement affiné. Au XVIème siècle, l’anatomie mit à jour la structure corporelle de ce que l’on appellera bientôt l’homme-machine. Au XVIIème siècle, l’invention du microscope permit de découvrir les microbes qui corrompent l’homme-machine. Dans le même temps, on trouvait en Amérique du sud un moyen de lutter contre eux grâce à la quinine, ancêtre de la chloroquine. Au XVIIIème siècle, la vaccination enrichit l’arsenal thérapeutique. Il est juste de parler d’arsenal quand on regarde l’humain comme une mécanique. Il est essentiel d’en protéger les rouages et de combattre le monde extérieur comme on combat la rouille qui s’empare d’une horloge. Au XIXème siècle, le stéthoscope, l’anesthésie et la chirurgie aseptisée. Au XXème, l’ADN et tant d’autres choses à la gloire de la matière dont on cassait le code.
L’intérêt que la tête porte à la mécanique humaine et à ce qui peut la contraindre est allée encore plus loin au XXIème siècle, aboutissant à la biomédecine : une conception technologique de la vie ayant pour finalité pratique l’ingénierie du corps. Avec elle, le médecin a vocation à disparaitre. Il sera remplacé par des dispositifs dosant des biomarqueurs. Ceux-ci permettront la détection des altérations de l’ADN, de l’ARN ou des protéines. Ces caractéristiques moléculaires objectivement mesurables sont considérées aujourd’hui par un grand nombre de chercheurs comme l’essence même des maladies en gestation. Ainsi, paraphrasant Jules Romain, au XXIème siècle les bien-portants sont des malades qui s’ignorent. Non seulement les médecins disparaissent, mais les malades eux aussi sont escamotés. Ils s’éclipsent derrière des listes d’analyses effectuées en absence de tout symptôme. Ils sont asymptomatiques.
On peut déplorer cette évolution oubliant l’être humain et ne voyant à sa place qu’une mécanique anonyme. Mais il ne sert à rien de regretter la médecine d’antan. En considérant l’être humain comme un fait extérieur, au même titre qu’un minéral ou qu’une plante que l’on examine, elle portait en elle ce développement depuis le début. Nous n’assistons pas aujourd’hui aux errements d’une science devenue folle, mais à l’aboutissement d’un chemin nécessaire. Comment vous dire… C’est en allant conséquemment au bout d’une logique que l’on a parfois la chance de découvrir l’essentiel. En faisant disparaitre le médecin et le malade, la médecine offre à l’un comme à l’autre les conditions extérieures idéales pour qu’ils s’éveillent à ce qu’ils ont d’irremplaçable et d’unique.
L’HUMAIN COMME UN FAIT UNIQUE
En regardant l’humain comme un fait extérieur, on le confond avec ses symptômes que l’on juge d’après des normes extérieures. On se fiche de le connaitre, lui. On veut connaitre des choses sur lui, ses constantes corporelles, ses antécédents, les médicaments qu’il prend. Mais on ne le connait pas. On ne sait pas le regard qu’il porte sur sa vie. On ne s’intéresse qu’à sa maladie qui semble n’être qu’une panne à régler. Elle doit être supprimée. Quand on regarde les gens de l’extérieur, leurs expériences restent périphériques aux soins que l’on prodigue.
Pourtant, si l’on pouvait changer de point de vue et considérer les gens qui se présentent à nous dans ce qu’ils ont d’unique au monde, on comprendrait que la maladie avec laquelle ils ont à vivre est elle aussi unique au monde. La maladie qu’ils traversent ne se trouve pas dans les livres. Dans les livres, il n’y en a que la description extérieure. L’expérience, quant à elle, est la leur. C’est leur épreuve, leur Mont-Blanc à gravir. Même si le médecin s’évertue à calmer les symptômes les plus difficiles, ils ont quand même à traverser quelque chose et tous s’y prendront d’une manière unique.
Quand on regarde la maladie d’une façon extérieure, elle apparait comme la conséquence d’un disfonctionnement. Quelque chose s’est détraqué et on en subit les conséquences. C’est comme quand on a une dette à régler. On va consulter un expert qui mesurera l’ampleur du déficit et proposera des moyens pour le faire disparaitre. Il y aura des mesures à prendre, des mois de ceinture serrée, mais on y arrivera. Probablement. Cependant, et c’est bien connu dans les cas d’endettement, lorsqu’on rencontre vraiment la personne, on découvre qu’il n’y a pas que des raisons contextuelles ; des raisons que l’on peut décrire dans les livres et autour desquelles on élabore des protocoles. Il y a aussi une raison intime, une raison intérieure : par exemple pour telle personne, c’est l’ennui qui la pousse à consommer pour se divertir, ou à jouer à des jeux d’argent en espérant la fortune qui permettrait de quitter la routine. De là vient son endettement, de l’ennui qu’elle éprouve. Et cet ennui d’où vient-il ? Comment aider cette personne à découvrir qu’aucune minute ne ressemble à une autre ? Comment faire advenir chez-elle cette ouverture à la vie, si belle et riche toujours ? Ces questions sont fondamentales car c’est parce qu’elle aspire à découvrir cette ouverture à la vie qu’elle se perd dans les jeux d’argent et qu’elle s’endette.
Pour une autre personne, il en ira tout autrement : elle aura par exemple la sensation de ne rien valoir et cherchera à se mettre en valeur avec des vêtements chics et des voitures de luxe. Elle voudra être arrivé à un certain standing sans en avoir les moyens. Elle est tout aussi endettée que la première mais a une toute autre sensation. Et cette sensation viendra elle-même de ce qu’il est difficile pour cette personne d’avancer avec un projet sans se projeter impatiemment dans une réussite. Avancer pas à pas, avec persévérance. Ce talent encore à venir est, pour cette personne, ce qui cause aujourd’hui, par son absence, l’endettement dont elle souffre.
Pour une autre encore, il est tellement insupportable de savoir quelqu’un dans le besoin qu’elle donne sans compter et se retrouve démunie. Il lui manque la stabilité intérieure qui permettrait de s’ouvrir à quelqu’un sans s’oublier soi-même. Cette stabilité est le talent qu’elle cherche à son insu dans l’endettement qui la fait souffrir.
Extérieurement, c’est toujours le même symptôme : un endettement auquel on répondra avec un protocole standard, tout comme on répond par un protocole standard à une angine à streptocoque ou à une hypertension artérielle. Mais intérieurement, les possibilités de sensations qui président au problème sont aussi nombreuses qu’il y a de gens.
Agir sur la dette par un plan de redressement, c’est ce que l’on fait en médecine lorsque l’on prescrit un médicament pour qu’un symptôme disparaisse. Mais lorsqu’en rencontrant vraiment la personne qui se tient là, on comprend que la dette qui s’est formée n’est que la conséquence d’une sensation profonde, elle-même due à un talent qui se cherche, alors on progresse. On comprend que la maladie est non seulement la conséquence de cette sensation mais aussi ce qui permet de ne plus continuer à faire comme si cette sensation n’existait pas. Elle découle de la mise en échec de la stratégie que l’on avait adopté pour supprimer cette sensation. Avec l’endettement, on ne peut plus compenser la peur de l’avenir, ou l’impression de ne rien valoir, ou encore l’hypersensibilité au malheur des autres. Elles reviennent en force. On ne peut plus se les cacher.
Peut-être que cette métaphore financière permettra de saisir que, de la même manière, la maladie se propose comme la condition extérieure d’une guérison. Elle se présente au moment où une sensation que l’on essayait de soulager essaie de remonter à la lumière. Non pas que telle sensation provoque telle maladie… Établir une telle corrélation reviendrait de nouveau à regarder le malade de l’extérieur. En revanche, tel malade, en parlant de lui, évoquera d’une façon ou d’une autre la sensation fondamentale avec laquelle il a essayé de composer, au point de tomber malade. Comme le principal intéressé n’a pas conscience de cette sensation tellement bien connue qu’il n’a avec elle aucune distance, il s’agira d’apprendre à écouter et savoir quoi écouter.
En attendant, quand on rencontre vraiment les gens et que l’on essaie de les comprendre, les maladies apparaissent pour ce qu’elles sont : des tentatives de guérison. Des tentatives qui peuvent sembler maladroites ou décalées, mais des tentatives quand même. Aidez quelqu’un à résoudre ses dettes sans lui offrir l’espace dans lequel il pourra guérir de sa sensation profonde, les dettes reviendront bientôt. Il récidivera.
Les épreuves ne sont pas là pour être supprimées, mais traversées.
Ce qui est unique chez chacun d’entre nous, c’est un talent qui demande à devenir présent. Un talent qui permet de traverser l’épreuve ; un talent encore à venir et qui provoque, par son absence, une sensation profonde. Les aléas qui s’organisent en fonction d’elle, sont l’opportunité d’une tentative de guérison.
Si l’on parvenait à caractériser la sensation profonde que vit la personne qui se présente à nous, et à la soigner en offrant de quoi exercer le talent qui est appelé à devenir présent, alors les symptômes extérieurs pourraient disparaitre d’eux-mêmes. C’est en tout cas ce qu’il s’agit de bien garder en conscience.
Les médecins d’autrefois ont pris l’option de vouloir supprimer les épreuves et ils rêvent désormais de supprimer les maladies avant même qu’elles ne deviennent symptomatiques. Cependant, en supprimant l’épreuve, ont-ils conscience qu’ils suppriment également les conditions extérieures permettant d’apprendre à traverser le problème ? Ils ne voient pas l’être qui chemine avec la maladie. Ils œuvrent pour une médecine qui voudrait faire disparaitre les malades ; dépister avant même que la maladie n’apparaisse. Ils veulent une médecine sans médecins qu’ils remplaceraient par des algorithmes et des biomarqueurs, une médecine biotechnologique qui ne voit ni l’âme ni l’esprit et qui rendra un jour possible de remplacer le corps par une machine inoxydable. Quoi de plus logique lorsque l’on considère l’humain comme un fait extérieur ?
Les médecins d’aujourd’hui sont appelés à rencontrer l’être qui se tient devant eux, à le comprendre jusque dans la sensation la plus essentielle qu’il porte avec lui, et à tirer de cette compréhension, celle de la maladie ainsi que du remède qui lui répond. Les trois sont liés tellement intimement qu’ils ne font qu’un. La sensation du patient est de même nature que le remède que l’on pourrait lui proposer et que la maladie qu’il est en train de traverser. Autrement dit, tandis que la sensation s’épuise dans la maladie, le remède devrait pouvoir remettre l’être qui souffre, en phase avec sa sensation profonde et le talent encore à venir, auquel il aspire sans le savoir.
Guillaume Lemonde
BLOG – DERNIERS ARTICLES MIS EN LIGNE
Médecin, chercheur, développe et enseigne la démarche Saluto dans ses différents champs d'application. Après des études de médecine à Lyon, il découvre la pédagogie curative et la sociothérapie, alliant la pédagogie et la santé. Pour lui, la question de toujours est d’offrir l’espace et les moyens permettant à chacun de devenir acteur de sa vie. Il ouvre un cabinet en Allemagne où il poursuit ses recherches dans le cadre de l’éducation spécialisée, puis en Suisse.
À partir de l’étude des grands chapitres de la pathologie humaine, il met en évidence quatre étapes de la présence à soi et au monde (1995) et découvre et développe à partir de cette recherche la Salutogénéalogie (2007) et la démarche Saluto (2014).
Il donne des conférences et des séminaires de formation pour enseigner cette démarche.
Il est auteur de publications faisant état de ses travaux.
Vous aimerez aussi

LES VOYAGEURS DE LA STEPPE
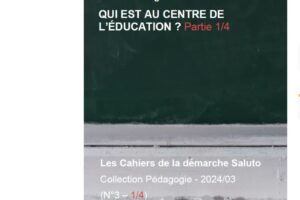
QUI EST AU CENTRE DE L’ÉDUCATION
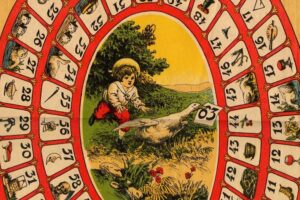

2 Commentaires
La prévention n’aurait alors pas de sens ?
En fait, il est possible d’entendre les tendances pathologiques dans ce qui s’exprime. La médecine préventive découle alors de la rencontre. Mais si le patient reste un fait extérieur, la prévention remplace la rencontre. Ce n’est pas la personne qui est là que l’on rencontre, mais les résultats des examens de médecine préventive (que l’on appelle aujourd’hui « médecine individualisée », mais qui n’a rien d’individuelle. Elle est juste un maillage plus fin des particularités biologiques de chacun.)