
AMOUR OU EMPATHIE ?
- Posté par Guillaume Lemonde
- Catégories Le Je, Présence et attention, Relation thérapeutique
- Date 25 décembre 2020
À la faculté de médecine, on ne parle pas d’amour. On parle d’empathie. Et j’ai très longtemps cru qu’il s’agissait de la même chose ; un synonyme grec pour remplacer un mot d’origine latine et faire plus savant. Mais je faisais erreur.
EMPATHIE
Le terme d’empathie désigne la capacité de comprendre les états émotionnels et les croyances d’autrui. Les comprendre tout en restant à distance[1]. Il désigne un processus cognitif permettant de cerner notre vis-à-vis tout en se défendant d’être touché par lui[2]. C’est froid, ce n’est pas engagé et cela permet de garder la tête claire. C’est l’attitude que l’on nous demande d’adopter durant les études de médecine. La seule officiellement acceptable pour garder un rapport professionnel adéquat.
AMOUR
Et à l’opposé, on confond l’amour avec cette chose sucrée que tout le monde redoute car elle brouillerait les consciences. Mais ce geste d’ouverture dans lequel nous nous perdons à nous-mêmes en souffrant avec l’autre, n’est pas celui de l’amour. C’est celui de la sympathie (souffrir avec).
Or il existe des relations qui ne se caractérisent ni par une compréhension distante des états émotionnels de l’autre, ni par un lien fusionnel dans lequel la conscience serait amoindrie. Il existe des relations tout à la fois engagées et éveillantes.
Ceci est incompréhensible si l’on s’en tient au plan psychique. Empathie et sympathie sont tellement à l’opposé l’une de l’autre qu’il n’est pas possible de suivre ces deux directions en même temps et de se lier totalement tout en restant totalement soi-même ; de s’engager complètement sans se perdre du tout. C’est un paradoxe insoluble à ce niveau.
Comment être complétement engagé, s’ouvrir à l’autre[3] mais sans se perdre[4] et être pourtant touché au point de constater que notre lien à nous-mêmes et au monde change[5] ? Ce paradoxe, c’est justement l’amour qui le résout[6]. Et ce qui en nous le permet ne peut donc pas être issu du psychisme : pour dépasser les mouvements paradoxaux de notre vie intérieure et atteindre cet équilibre, il faut nécessairement prendre de l’altitude et être engagé autrement que psychiquement, autrement que mentalement : ce qui offre à quelque système que ce soit d’être en équilibre ne peut pas se situer en son sein.
C’est à la Terre toute entière que se tient le funambule sur son fil.
C’est à la Terre toute entière que se tient le funambule sur son fil. Et cette présence qui permet d’aimer est pour notre vie intérieure tout à la fois le funambule sur son fil et la Terre à laquelle il se tient.
Cette présence, c’est tout à la fois nous-mêmes et c’est plus grand que nous-mêmes (le funambule et la Terre). C’est le Je suis [7]. Nous sommes seuls à pouvoir utiliser ce pronom pour nous-mêmes et pourtant, le Je suis dépasse largement la conscience que nous avons de nous-mêmes. C’est tout à la fois une expérience personnelle et universelle. C’est le cœur le plus essentiellement premier[8] de notre nature humaine.
Si cet article vous a plu, n’hésitez pas à le partager avec vos amis
Pour aller plus loin : le livre Découvrir la Salutogénéalogie, duquel est extrait ce passage.
IMAGE :
L’art au présent BELLINI Giovanni,1487 – La Vierge et l’Enfant entre Saint Pierre et Saint Sébastien (Louvre) – Detail
NOTES :
[1] Pour Freud, l’empathie (Mitgefühl) est une attitude de défense qui permet de rire d’une personne faisant des efforts démesurés pour réussir ce qui nous semble simple à réaliser (Freud S., Esquisse d’une psychologie scientifique in La naissance de la psychanalyse (1895), Paris, PUF, 1979). Pour lui, l’empathie est une mise à distance face au risque d’envahissement identificatoire (de Urtubey Louise, Freud et l’empathie, in Revue française de psychanalyse 2004/3 (Vol. 68)). Et c’est bien logique, si l’on y songe : l’appareil psychique freudien étant un système en vase clos, il ne peut ni se lier, ni donner de façon désintéressée. Il y aura toujours pour lui quelque inconsciente pulsion à satisfaire.
Dans la même veine, Geoffrey Miller explique dans The Mating Mind que l’empathie se serait développée parce que « se mettre à la place de l’autre » pour savoir comment il pense et va peut-être réagir constitue un important facteur de survie dans un monde où l’homme est sans cesse en compétition avec l’homme.
Avec Rogers, ce terme définit, en médiation, une attitude et un comportement consistant à exclure toute adhésion aux émotions exprimées par un tiers, à ne pas exprimer d’interprétation et donc, globalement, à ne pas s’identifier à l’autre. C’est donc là aussi un concept de distanciation. Et par cette distance, on espère éviter le parti pris sur ce qui est exprimé par l’autre : ne pas prendre les mots ou les états émotionnels comme des représentations certaines de l’expérience concrète vécue. (Cf. Pratique de la Médiation, Éd. ESF, de Jean-Louis Lascoux).
[2] « En toute rigueur, l’empathie émotionnelle peut ne pas être du tout dirigée vers le bien-être d’autrui à l’inverse de la sympathie. Ainsi faire acte de cruauté requiert une capacité empathique pour connaître le ressenti, en l’occurrence la souffrance, d’autrui afin d’en tirer un plaisir. » (Wispé, L. 1986. The distinction between sympathie and empathie. Journal of Personality and Social Psychologie, 50,2 : 314-321)
« En somme, l’empathie est un mode de connaissance ; la sympathie est un mode de rencontre avec autrui. » (Ibid. : 318)
[3] Si on ne s’ouvre pas, on est dans un geste d’antipathie (ne pas ressentir avec)
[4] Si on se perd en l’autre, on suit un geste de sympathie (ressentir avec)
[5] Ce mystère est évoqué par le renard au Petit Prince (de St Exupéry) lorsqu’il lui parle de la blondeur des blés et le rire des étoiles ; lorsqu’il lui explique que l’essentiel est invisible pour les yeux et que l’on ne voit bien qu’avec le cœur.
[6] Il ne peut pas y avoir de mécanisme psychologique expliquant l’amour. Car si on reste centré sur la psyché, l’autre reste forcement extérieur à nous et alors il nous faudra nous défendre d’être déséquilibré par lui. Une ouverture ne pourra donc constituer qu’une manœuvre dangereuse à laquelle nous consentirons dans la perspective d’un bénéfice secondaire. Il n’y a pas d’acte désintéressé à ce niveau de la compréhension de l’humain.
[7] Le Je, traduction de das Ich des philosophes allemands comme Fichte ou Hegel. À distinguer en français du Moi, qui n’est qu’un avatar freudien dans la psyché, ou encore du Soi jungien, sans caractère individuel.
[8]Pour Freud, l’instance première n’est pas le Moi mais le Ça. C’est le pôle pulsionnel de la personnalité, la partie la plus chaotique et la plus obscure. C’est entièrement le domaine de l’instinctif, du biologique qui ne connaît ni règle de temps ou d’espace, ni interdit. Totalement inconscient, il est régi et dirigé par le seul principe de plaisir. Du Ça serait issu le Moi.
Pour Freud, le Moi serait le produit du contact du Ça avec la réalité extérieure. Puis se développerait le Surmoi introjecté par le Moi qui fait se retourner l’énergie pulsionnelle contre lui-même. Le Surmoi est l’instance refoulante, le support de tous les interdits et des contraintes sociales et culturelles. Son activité est partiellement inconsciente. Il se constitue par intériorisation des exigences et interdits parentaux. Ainsi, pour Freud, le Moi n’est pas premier, mais n’est qu’un reflet sans consistance. Rien de plus que le produit des exigences du Ça et des interdits du Surmoi face au réel. Il est impuissant face à l’inconscient, puisque secondaire à lui. Et en plus il est perçu comme dangereux, puisqu’il participe aux mécanismes de défense interne et aggrave le refoulement que la psychanalyse voudrait contrebalancer.
Tag:Je suis
Médecin, chercheur, développe et enseigne la démarche Saluto dans ses différents champs d'application. Après des études de médecine à Lyon, il découvre la pédagogie curative et la sociothérapie, alliant la pédagogie et la santé. Pour lui, la question de toujours est d’offrir l’espace et les moyens permettant à chacun de devenir acteur de sa vie. Il ouvre un cabinet en Allemagne où il poursuit ses recherches dans le cadre de l’éducation spécialisée, puis en Suisse.
À partir de l’étude des grands chapitres de la pathologie humaine, il met en évidence quatre étapes de la présence à soi et au monde (1995) et découvre et développe à partir de cette recherche la Salutogénéalogie (2007) et la démarche Saluto (2014).
Il donne des conférences et des séminaires de formation pour enseigner cette démarche.
Il est auteur de publications faisant état de ses travaux.
Article précédent
GEORGES BERNANOS : « LE PESSIMISTE ET L’OPTIMISTE S’ACCORDENT SUR UN POINT… » LEQUEL ?
Vous aimerez aussi
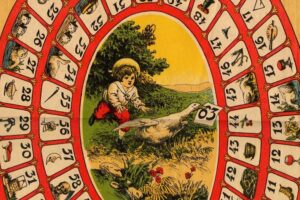
NOTRE VIE N’EST-ELLE QU’UNE SUCCESSION D’ÉVÉNEMENTS ?

MARIE MADELEINE SE TENAIT PRÈS DU TOMBEAU


2 Commentaires
Merci Guilaume! Au lendemain de Noël, cela résonne tellement vrai et beau. Amicalement.
Françoise Bloch : la langue française est ambigue pour parler de l’amour puisqu’elle n’utilise qu’un vocable pour désigner les différentes formes d’amour : celui dont vous parlez est l’agapé qui est à différencier de l’éros et de la philia. https://www.coaching-biblique.fr/eros-philia-agape.html.
Et si l’agapé était la forme la plus développée, le monde social serait fort différent !
Quelle serait donc la forme sociale qui mettrait au centre de son fonctionnement l’agapé ?