
LES TROIS VISAGES DE L’AMOUR : Éros, Philia, Agapé
- Posté par Guillaume Lemonde
- Catégories Chroniques Contemporaines et Pensées, Exercices pratiques, Le Je, Philosophie, Présence et attention, Relation thérapeutique
- Date 4 décembre 2020

Lorsque nous disons « Je t’aime », que disons-nous en fait ? Les anciens Grecs avaient bien noté que les expressions de l’amour se situent à des degrés différents. Ils décrivaient en l’occurrence trois visages de l’amour qu’ils nommèrent Éros, Philia et Agapé…
ÉROS
Éros, l’amour du nouveau-né qui est dans la dépendance du lien. Il est dans la nécessité de satisfaire ses besoins élémentaires. C’est l’amour du besoin innocent qui, avec l’émergence de la conscience et des stratégies qu’elle permet, perdra son innocence tout en continuant de réclamer satisfaction. L’amour sensuel, charnel, devient sexuel. L’ivresse d’un « coup de foudre » induit un fort désir de l’autre.
Avec Éros, c’est la satisfaction de certains besoins qui nous attire les uns vers les autres. Nous avons besoin les uns des autres. Besoin d’être aimé. Mais du coup, en restant avec Éros, le partenaire devient un objet de satisfaction, et cet amour, conditionné par la satisfaction, prend fin lorsque le besoin est rassasié.
AGAPÉ
À l’exact opposé de cette forme charnelle, on trouve l’amour-dévotion. Cet amour, Agapé, est celui qui donne et se sacrifie. C’est un amour affranchi de la chair et qui se situe au-delà de l’émotionnel. Il est altruiste, spirituel. Il se donne « gratuitement », de manière désintéressée, sans attendre de retour. Mais il a besoin de se donner pour être. Il a besoin de l’autre pour se manifester ! Il a besoin d’aimer quelqu’un.
Nous avons donc le besoin d’aimer avec Éros et le besoin d’aimer avec Agapé. D’un côté recevoir (un recevoir qui devient prendre) et de l’autre donner.
Agapé est tout aussi unilatéral qu’Éros.
En effet, dérober ce que l’autre possède est tout aussi déséquilibré que de tout lui donner.
Autant Éros, à force de vouloir satisfaire ses besoins, finit par prendre les allures d’un prédateur, d’une bête… Autant Agapé, à force de se donner prend l’allure d’un ange vide. Vide car à un moment donné, il n’y a plus rien à donner. On connait le burnout qui touche les acteurs de la relation d’aide…
Et d’ailleurs, à vouloir faire l’ange, on fait la bête, disait en substance Pascal. Il y a dans ce don de soi impossible, un égoïsme qui se cache : la bonté qui se donne, satisfait autant celui qui donne, que la satisfaction charnelle satisfait celui qui prend.
Alors, entre l’ange et la bête, l’humain se cherche.
Quel est le bon équilibre ? Comment trouver la balance ?
Entre Éros et Agapé, Aristote suggéra un secours de Philia :
PHILIA
L’amour qui prend appui sur des plaisirs partagés, des échanges, de la solidarité, de la complicité. Nous ne pouvons aimer que ce à quoi nous nous sentons liés.
Il est vrai que le besoin d’être aimé et le besoin d’aimer se trouvent dans le partage en balance, mais ce visage de l’amour est tout aussi conditionnel que les deux autres, puisqu’il est fondé sur des activités partagées. Tant que ces activités durent et que chacun obtient un bénéfice à être avec l’autre, cela peut continuer. Mais quand les avantages qu’offrent la relation ne sont plus au rendez-vous, elle prend fin.
En somme, ni Éros, ni Agapé, ni Philia ne sont des amours libres.
Ils dépendent des circonstances.
– Éros dépend de la personne qui peut lui donner quelque chose de satisfaisant,
– Agapé dépend de celle pour laquelle il peut continuer d’exercer son don de soi (Éros et Agapé forment des couples dépendants où l’un est dans la position enfantine de recevoir, tandis que l’autre joue les sauveurs et veut tout bien faire pour son partenaire. Ça peut fonctionner. Deux Éros ensemble, ou deux Agapés, ça sera encore autre chose…)
– Philia dépend des relations de partage qu’il souhaite équilibrées entre donner et recevoir. (C’est d’ailleurs un sujet fréquent dans les amitiés : quelqu’un pourra se plaindre d’être toujours celui qui prend des nouvelles de l’autre et décider de cesser d’appeler pour voir à quel moment l’ami va se réveiller et prendre des nouvelles à son tour…)
LA LIBERTÉ ET L’AMOUR
Si ce sont les circonstances qui le détermine, l’amour qui relie les êtres n’est pas fondé en lui-même. Il n’est pas lui-même présent. Ce qu’on observe à travers Éros, Agapé et Philia, ce sont trois visages de l’amour, ses trois masques devrait-on peut-être dire. Mais sous le masque, où se trouve l’acteur qui pourrait aimer quelles que soit les circonstances ? L’acteur qui pourrait avoir besoin d’être aimé, tout en traversant la frustration de ne pas l’être ? L’acteur qui pourrait avoir besoin d’aimer, tout en traversant la frustration que ce don ne soit pas voulu ou reçu ? Aimer sans condition…
Bien-sûr, les attentes que nous pouvons avoir sont essentielles : sans attentes, sans désirs, il ne saurait y avoir de plaisir et sans plaisir, le monde qui nous entoure nous resterait inconnu. L’autre nous resterait inconnu… Désirer retrouver quelqu’un, c’est s’ouvrir à ce que ce quelqu’un pourrait nous révéler de lui-même.
Mais en voulant être satisfaites, les attentes, dérobent à l’autre ce que pourtant il nous tend. Là où un cadeau est offert, elles se réjouissent d’un butin à dérober.
Alors comment désirer sans dérober ? Comment ne pas tendre la main vers le fruit que l’on convoite, sans pour autant cesser de le désirer ?
Comment tenir dans l’absence de ce que l’on désire ?
Par quel miracle pourrions-nous ne pas combler ce manque et faire de ce vide une caisse de résonance qui permettrait à l’autre d’offrir sa musique inconnue de nous. Si on lui dérobe sa partition, on ne pourra interpréter que ce que nous savons déjà. Si on le laisse jouer, un univers incomparablement plus grand que tout ce que l’on pouvait imaginer, se révélera.
Comment être sans attentes, tout en restant absolument plein de désirs ?
En fait il s’agirait ni plus ni moins d’apprivoiser le vide, le manque.
Ne pas vouloir les faire disparaitre, mais les traverser.
Découvrir cet endroit qui connait le désir, mais qui ne se projette pas dans la représentation de la satisfaction du désir.
Apprivoiser la solitude… Une seule chose est nécessaire : la solitude… disait Rilke.
Ce qui nous fait souffrir, ce n’est pas le désir que certains ascètes ont cru devoir éteindre, mais l’idée que l’on se fait du temps qui reste jusqu’à ce qu’il soit satisfait. Et Dieu sait que la souffrance peut être grande. Mais il est essentiel de la vivre cette souffrance, pour qu’en même temps il devienne possible de découvrir ce qui en nous ne souffre pas.
Lorsque l’on découvre un jour que l’idée du temps qui reste jusqu’à ce que la satisfaction soit possible, creuse le manque, on découvre en même temps que l’attention que l’on pourrait porter à ne pas se projeter plus loin que maintenant, vient dans ce creux, et l’éclaire. Cela ne fait pas disparaitre le manque, mais cela permet de ne pas se confondre avec lui.
Ainsi, en restant présent à cette souffrance, sans se projeter dans l’espoir d’une satisfaction, on la traverse. Et la souffrance devient simple douleur, celle d’un désir encore inassouvi devant lequel, ou au cœur duquel, il est possible de se tenir. En restant au présent, on se tient au cœur du monde, en lien avec ce qui est et non avec ce que l’on voudrait qui soit.
Et l’être aimé qui nous manque devient par là-même présent dans son absence.
D’ailleurs, même si l’être aimé est présent physiquement, il devient pour nous, par cette attention que l’on porte aux désirs insatisfaits, réellement présent, au point que l’on peut enfin le percevoir, le rencontrer pour qui il est et non pour qui on aimerait qu’il soit.
Cette qualité de présence qui n’attend rien, tout en désirant plus que tout, c’est l’amour. Et cela n’a rien à voir avec Agapé. Certains ont cru voir en la figure de Christ une résurgence de l’Agapé. Mais le Christ, qui certes se donne à l’humanité sur la Croix, le fait, lui, en traversant la souffrance. Il est la présence qui se tient au cœur du désir.
Il est au présent et non dans la perspective de ce que ses actes pourraient avoir comme effets.
Éros séduit pour obtenir du plaisir. Il dépend de l’autre.
Agapé se donne pour obtenir le plaisir de l’autre. Il dépend de l’autre.
Philia partage pour le plaisir d’une contrepartie. Il dépend de l’autre.
L’amour, quant à lui, est activement engagé maintenant, pour rien d’autre que d’être engagé maintenant. Il est sans attente, n’attend pas de rétribution, de récompense… Il est en lien avec ce qui est et non avec ce que le désir aimerait qui soit, libre du désir. Non qu’il ne le connaisse pas, mais il le traverse. Il n’est pas au-delà de la frustration, mais au coeur de la frustration.
Le désir est la caisse de résonance dans laquelle l’autre et le monde entier viennent résonner. Ainsi, l’amour se donne à l’autre tout en recevant. Il reçoit en donnant. Il n’y a pas d’ordre logique à ce qui se passe alors, car au présent, il n’y a ni avant ni d’après.
À ce sujet, je vous laisse relire ici le magnifique témoignage que m’offrit Line avant de mourir.
 Saint Paul, par Rembrandt
Saint Paul, par Rembrandt
L’équilibre à trouver entre Éros et Agape se fait extérieurement avec Philia. Il se fait par en-dedans quand l’amour est fondé en lui-même.
Il ne s’agit pas de trouver une moyenne, un juste milieu entre donner et recevoir, mais de vivre en même temps les deux gestes.
C’est comme lors d’un rapport sexuel : plutôt que de se masturber à deux avec Éros, ou de se donner à un devoir conjugal dans lequel on s’annule avec Agapé, on peut donner et recevoir en même temps.
À ce sujet, connaissez-vous le magnifique livre de Jacques Lusseyran : Conversations amoureuses ?
Il ne s’agit pas de trouver une moyenne, un juste milieu entre donner et recevoir, mais de vivre en même temps les deux gestes.
VIVRE EN MÊME TEMPS LES DEUX GESTES
Pensez à la personne que vous aimez (ou que vous aimeriez, s’il n’y a actuellement personne…). Dites-vous : Je l’aime. Ressentez : Je l’aime. Vivez avec : Je l’aime !
· Et dans ce « Je l’aime » distinguer d’abord : J’ai besoin d’être aimé et plonger dans ce besoin bien légitime.
Que ce besoin soit assouvi dans votre vie ou qu’il ne le soit pas, il n’en reste pas moins que vous faites avec cette première proposition une certaine expérience. Ressentez ce que cela fait. Rester avec ça un moment. N’allez pas juger ce que vous ressentez. Vous passeriez à côté de l’expérience. Il s’agit de se lier avec ce qui est et ce qui est se vit dans le sentiment lorsque vous vous dites : J’ai besoin d’être aimé.
· Dans un deuxième temps, dites-vous : J’ai besoin d’aimer.
J’ai besoin d’être là pour quelqu’un. Dans cette deuxième proposition, plongez également. Laisser vivre les sentiments qui viennent, les sensations qui se réveillent. Laissez-les être.
Vous avez vécu deux expériences. L’une s’appelle Éros. La seconde s’appelle Agape.
Il est très important de prendre le temps qu’il faut pour bien sentir les deux. Peut-être ne sont-ils pas sur un même niveau d’intensité… Ce n’est pas grave. Ce n’est pas la quantité qui compte, mais la qualité de l’expérience.
· À présent, prenez un moment pour laisser résonner les deux ensemble.
J’ai besoin d’aimer et j’ai besoin d’être aimé.
Cela ne se fait pas dans la tête. Dans la tête on comprend les choses et on en fait la moyenne. Dans la tête, on conçoit les bons procédés de Philia. Donner alterne avec recevoir.
Non, désormais, ça se fait dans le cœur. J’ai besoin d’aimer et j’ai besoin d’être aimé…
Si vous avez bien plongé dans chacun des deux, alors l’endroit à partir duquel vous allez pouvoir tenir ces deux expériences non pas en les alternant mais en même temps, c’est l’endroit à partir duquel vous aimez véritablement.
Voilà ce que j’avais à partager aujourd’hui. Revenez dans les commentaires partager à votre tour, s’il vous plait, ce que vous aurez remarqué. Vos expériences sont précieuses pour tous et je vous en remercie par avance.
Bien à vous
Guillaume Lemonde
BLOG – DERNIERS ARTICLES MIS EN LIGNE
Médecin, chercheur, développe et enseigne la démarche Saluto dans ses différents champs d'application. Après des études de médecine à Lyon, il découvre la pédagogie curative et la sociothérapie, alliant la pédagogie et la santé. Pour lui, la question de toujours est d’offrir l’espace et les moyens permettant à chacun de devenir acteur de sa vie. Il ouvre un cabinet en Allemagne où il poursuit ses recherches dans le cadre de l’éducation spécialisée, puis en Suisse.
À partir de l’étude des grands chapitres de la pathologie humaine, il met en évidence quatre étapes de la présence à soi et au monde (1995) et découvre et développe à partir de cette recherche la Salutogénéalogie (2007) et la démarche Saluto (2014).
Il donne des conférences et des séminaires de formation pour enseigner cette démarche.
Il est auteur de publications faisant état de ses travaux.
Article suivant
TRISTAN BERNARD : « LES OPTIMISTES ET LES PESSIMISTES ONT UN DÉFAUT EN COMMUN… » LEQUEL ?
Vous aimerez aussi
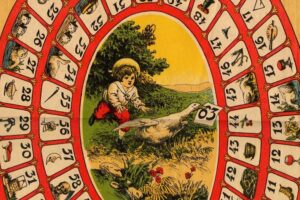
NOTRE VIE N’EST-ELLE QU’UNE SUCCESSION D’ÉVÉNEMENTS ?

MARIE MADELEINE SE TENAIT PRÈS DU TOMBEAU




6 Commentaires
Merci Guillaume. Oui, bien sûr, il y a différentes formes d’amour que vous décrivez très bien mais il y a une autre norme sociétale, celle de la justice dont le principe est l’équivalence et la réciprocité. Je vous conseille à ce propos la lecture du livre de Luc Boltanski ” l’amour et la justice comme compétences”, 1990 Metaillé.
Et s’agissant du don (que j’ai étudié pendant des années !) il est très rarement inconditionnel contrairement à ce que l’on en pense spontanément. Le don est au service de la relation et rend inséparables objet et sujet, c’est à dire la matérialité de ce qui est donné et la qualité de la relation : il est ouverture à la profonde altérité de l’autre.
Ce type d’échange (par don) a une temporalité longue (contrairement au marché qui en a une très courte et s’emploie à séparer sujet et objet au point que les sujets deviennent des objets !) et son principe dynamique est la dette de gratitude. Donner c’est prendre le risque de la relation dont le retour (qui a une temporalité longue et fait une sorte de boucle sans fin) nous confirme que le don a bien comblé l’attente de l’autre. La dette bien entendu est le plus souvent tue en régime d’amour mais réémerge en régime de conflit. Cf Bloch, Buisson, la circulation du don entre générations ou comment reçoit-on. Communications, 1994, n° 59 (et les nombreux articles que j’ai publiés seule ou collectivement sur le don et la transmission intergénérationnelle que je tiens à la disposition de qui est intéresséE )
Ça me parle beaucoup, Françoise. Se pourrait-il que le don, qui est au service de la relation, soit d’autant mieux à ce service que le donateur n’attende pas de retour (à la différence du marché qui attend un retour rapide sur investissement) ? La gratitude qui vient en retour n’est-elle pas le résultat d’une dette du seul point de vue de celui qui a reçu le don ? Celui qui donne, tout en pouvant se réjouir de cette manifestation de gratitude, donne-t-il vraiment s’il attend cette gratitude comme un dû ? J’ai l’impression qu’il y a à cet endroit un point important: Si le donateur, en droit d’attendre une expression de gratitude, ne l’attend pas, alors la gratitude sera pour lui non pas un dû mais un nouveau don. Tout le monde donne finalement, si bien que la rencontre reçoit elle-même de quoi grandir et dépasser la somme des deux. Qu’en pensez-vous ? Je serais très heureux de pouvoir lire les articles que vous avez publiés à ce sujet ! Avec gratitude !
Je le trouve magnifique votre texte. Ça donne envie de vous dire merci. Pour l’énergie qui se déploie de cette expérience. Parce qu’à mon sens, quand on trouve cet endroit dont vous parlez ; où l’amour peut exister en tant que tel, c’est une énergie infinie qui se manifeste.
C’était vraiment très beau. Merci encore.
Bonjour Françoise, Ce sujet m’intéresse, notamment la question de l’égoïsme dans le démarche du don… en fait je me suis toujours demandé ce qui motivait Vraiment le don…
Bien cordialement
Je comprends bien que ça vous parle. De facto, selon moi et nous, la dynamique du don (dans nos sociétés dites modernes) ne réside pas dans celui qui donne mais dans celui qui reçoit. Ce n’est en aucun cas une “économie comptable” . En gros, le donataire – celui qui reçoit – s’est-il senti reconnu et considéré dans ce qu’il a reçu comme un sujet à la fois semblable et autre ? L’échange par don est donc une intersubjectivité et la dynamique oblative fait s’enchainer des séquences de don et contre-don qui souvent se superposent faisant de cet échange un échange sans fin. L’échange par don sollicite la mémoire et en cela c’est juste “l’autre” de l’économique, c. à d. du marché qui lui n’a pas de mémoire ! je vous envoie, sur votre adresse email pour ne pas surcharger le commentaire, un texte pour commencer et une modeste contribution à un débat solidaire rédigée en 2009 à propos de croissance et décroissance : ” Les trois sortes de circulation des biens (et des services) et leurs principes différents : le marché, les services publics et le don” Mais ce débat est passionnant et pourrait se prolonger bien entendu car voici des années que je travaille là-dessus même si je suis retraitée ! Juste une remarque à cette étape : le don est de plus en plus contaminé par les catégories marchandes et par le refus de considérer ce que l’on doit aux autres !
Bonne question, Franck. “qu’est ce qui motive le don ?” Je me suis déjà prononcée sur la dynamique du don le 12 février et ceci en fonction de nombreux travaux de recherche effectués pendant une vingtaine d’années où nous avons recueilli des récits de vie dans l’intergénérationnel. Le don est au service de la relation et c’est selon la qualité de cette relation qu’il prend toute sa signification faisant se superposer les positions de donateur et de donataire. Donner c’est se défaire d’une relation d’obligation passée pour en ouvrir une autre, donnant à cet “échange” bien singulier, le sens d’une boucle sans fin. Et contrairement à ce que l’on pense, la dynamique réside dans l’esprit de celui ou celle qui reçoit et non dans celui qui donne.