
L’HOMME-MACHINE et la relation d’aide
- Posté par Guillaume Lemonde
- Catégories Chroniques Contemporaines et Pensées, Le Je, Philosophie, Présence et attention, Relation thérapeutique
- Date 17 juillet 2020
Préambule : La nature de l’aide que nous apportons à quelqu’un, que ce soit dans un cadre thérapeutique, pédagogique ou autre, dépend nécessairement des représentations que nous nous faisons de l’univers en général et de la nature humaine en particulier.
***
L’HOMME-MACHINE[1] est le nom qu’il est possible de donner à l’une de ces représentations que nous nous faisons de la nature humaine.
Elle n’a sérieusement plus été nommée ainsi depuis le XVIIIème siècle, mais elle est quand même devenue la plus courante de toutes. Elle est celle que l’Université de médecine a fait sienne depuis que les universités existent et elle déborde aujourd’hui très largement l’Université.
L’Homme-machine, c’est l’Homme qui, telle une machine, est déterminé par une condition initiale. Or, comme la plupart du temps nous nous tournons vers le passé pour comprendre les conditions initiales (les causes) des problèmes que nous rencontrons, nous puisons la plupart du temps à ce cadre représentatif.
Et nous le faisons sans trop réaliser ce que cela implique.
Ce que cela implique, c’est que l’humain devient inconsistant.
En effet, ce qui est déterminé par le passé ne peut être que le produit de cette antériorité, jouet d’un déterminisme aux multiples visages. Il n’est que le produit de ce qui l’a précédé, le produit d’une hérédité, le produit d’une histoire familiale, mais aussi le produit d’une culture, d’une éducation. Il n’est pas fondé en lui-même.
 Et cela a une conséquence fondamentale, énoncée par Spinoza. Il l’écrit en préface de l’Éthique :
Et cela a une conséquence fondamentale, énoncée par Spinoza. Il l’écrit en préface de l’Éthique :
« Les hommes se croient libres parce qu’ils sont conscients de leurs désirs mais ignorants des causes qui les déterminent. »
De fait, si nous sommes le produit de conditions initiales, alors il n’y a pas de libre-arbitre. Nos actes sont conditionnés par ce qui s’est passé avant. Ils dépendent d’une certaine hérédité, d’un certain équilibre hormonal, d’une certaine éducation, etc. Bref, ils dépendent d’une antériorité, quelle qu’elle soit.
Lorsque nous cherchons dans le passé les causes des problèmes que nous rencontrons, nous adoptons une représentation du monde dans laquelle la nature humaine est inconsistante. Elle est le produit de ce qui était avant et déterminée par cette antériorité au point de ne pas pouvoir avoir de libre-arbitre. Elle est soumise au contexte tout puissant dont elle dépend.
Si nous avons confiance, c’est à condition que tout se soit bien passé jusque-là. Si nous pouvons nous engager, c’est à condition qu’il n’y ait pas d’obstacle. De même, si nous pouvons avoir du temps, c’est à condition qu’il n’y ait plus rien à faire. Et si nous pouvons découvrir une certaine stabilité intérieure, c’est à condition qu’on nous fiche la paix.
Dans ces conditions, aider consistera à essayer de comprendre au mieux les conditions initiales et à les lever ou les compenser, si c’est encore possible.
Ainsi, les analyses chromosomiques, tout comme certaines investigations psychologiques, bien que sur des plans différents, s’intéressent à l’Homme-machine du simple fait qu’elles cherchent à comprendre les problèmes qui se présentent à partir d’une antériorité.  Elles transposent à l’humain les lois du monde physique, conformes aux considérations physiques de Laplace qui écrivait en 1814 au sujet de l’Univers lui-même : « Nous devons (…) envisager l’état présent de l’univers comme l’effet de son état antérieur, et comme la cause de celui qui va suivre. »[2]
Elles transposent à l’humain les lois du monde physique, conformes aux considérations physiques de Laplace qui écrivait en 1814 au sujet de l’Univers lui-même : « Nous devons (…) envisager l’état présent de l’univers comme l’effet de son état antérieur, et comme la cause de celui qui va suivre. »[2]
***
Pourtant, n’est-il pas possible d’éprouver de la confiance alors que tout semble contraire ?
N’est-il pas possible d’avoir du courage alors que des obstacles se dressent ? C’est même à ça qu’on reconnait le courage. N’est-il pas possible d’aimer sans attendre rien en retour ?
Lorsqu’on a peur, n’est-il pas possible de se tenir devant cette peur sans essayer de la calmer à tout prix ? De même, n’est-il pas possible de ne pas se laisser entrainer par la haine qui mécaniquement nous pousserait à l’assouvir ?
Ces expériences contredisent les mécanismes psychiques de l’Homme-machine. Elles n’ont rien de logique.
Bien-sûr, ce sont des expériences et tant qu’on ne les a pas éprouvées au plus intime, on reste aveugle à leur qualité. À défaut de les vivre, on croit les expliquer par d’autres antériorités, comme par exemple par un Sur-moi assez puissant pour nous contraindre à ne pas suivre les mécanismes psychiques attendus.
 Et l’on en vient à affirmer avec Freud, abaissant l’humain à un appareil psychique en vase clos[3], que l’amour n’existe pas[4], ou avec Spinoza, que la liberté n’est qu’une illusion.
Et l’on en vient à affirmer avec Freud, abaissant l’humain à un appareil psychique en vase clos[3], que l’amour n’existe pas[4], ou avec Spinoza, que la liberté n’est qu’une illusion.
L’amour se voit remplacé par de la bienveillance, la liberté par du consentement,
et le soin que l’on apporte vise à supprimer les conditions initiales à l’origine du désordre : supprimer le gène défectueux, le déséquilibre hormonal perturbant, le lien relationnel pesant, la croyance limitante, l’influence environnementale délétère, etc. On supprime la peur avec des médicaments.
Comme il n’est pas fondé en lui-même, l’Homme-machine semblera toujours être victime du monde (que ce soit son monde intérieur ou le monde extérieur). Il est déresponsabilisé du simple fait qu’il n’est qu’un produit.
Victime du monde, il en aura peur et mettra en place des stratégies pour s’éloigner de ce qui le contraint. Ou peut-être voudra-t-il supprimer cette contrainte, expression plus ou moins forte de la haine. La peur et la haine sont les expressions de l’Homme-machine et bien des approches thérapeutiques s’appuient aujourd’hui sur ces principes. Qu’il suffise de penser à la peur des virus et à tout ce qui se met en place à leur sujet. Cette peur est celle que l’Homme-machine ressent vis-à-vis du monde.
Si l’on pouvait découvrir en soi l’endroit à partir duquel il n’est pas besoin de répondre à la peur en la calmant, et à la haine en l’assouvissant,
on découvrirait du même coup comment être fondé en soi-même. On se trouverait dans un temps où il n’y a pas d’avant et d’après qui compte. On serait présent, capable d’agir et non de réagir, capable de ne pas suivre les enchaînements mentaux qui voudraient s’imposer.
On serait créateur dans la vie et non pas un simple automate biologique et psychique.
Comment fait-on ça ? Comment exerce-t-on ça ?
Quelles sont les ressources spécifiques à découvrir pour y parvenir ? Et comme il n’y a pas d’antériorité contraignante à cet endroit, la question peut se poser dans l’autre sens : quelles ressources spécifiques découvre-t-on en y parvenant ?
Ces ressources sont-elles dépendantes des problèmes rencontrés, ou spécifiques à chacun indépendamment des problèmes ?
Ces questions, et bien d’autres, sont au cœur de la démarche Saluto.
Elles demanderont d’autres développements.
Guillaume Lemonde
Si cet article vous plait, partagez-le !
Merci
[1] L’Homme-Machine est un ouvrage de Julien Offray de La Mettrie publié anonymement à Leyde en 1748. La Mettrie considère que l’esprit doit être considéré comme une émanation de la fine organisation de la matière dans le cerveau humain : l’Homme n’est donc qu’un animal supérieur (comme l’automate de Vaucanson). La Mettrie étend à l’Homme le principe de l’Animal-machine de Descartes et rejette ainsi toute forme de dualisme, au profit du monisme, comme le fait la médecine d’aujourd’hui.
[2] « Nous devons donc envisager l’état présent de l’univers comme l’effet de son état antérieur, et comme la cause de celui qui va suivre. Une intelligence qui pour un instant donné connaîtrait toutes les forces dont la nature est animée et la situation respective des êtres qui la composent, si d’ailleurs elle était assez vaste pour soumettre ses données à l’analyse, embrasserait dans la même formule les mouvements des plus grands corps de l’univers et ceux du plus léger atome : rien ne serait incertain pour elle, et l’avenir comme le passé serait présent à ses yeux. Pierre-Simon Laplace, Essai philosophiques sur les probabilités, Courcier, 1814, p. 2-3.
[3] De La science des rêves, entre 1900 et 1915, jusqu’à la deuxième topique dès 1920.
[4] Pour Freud, l’empathie (Mitgefühl) est une attitude de défense qui permet de rire d’une personne faisant des efforts démesurés pour réussir ce qui nous semble simple à réaliser (Freud S., Esquisse d’une psychologie scientifique in La naissance de la psychanalyse (1895), Paris, PUF, 1979). Pour lui, l’empathie est une mise à distance face au risque d’envahissement identificatoire (de Urtubey Louise, Freud et l’empathie, in Revue française de psychanalyse 2004/3 (Vol. 68)). Et c’est bien logique, si l’on y songe : l’appareil psychique freudien étant un système en vase clos, il ne peut ni se lier, ni donner de façon désintéressée. Il y aura toujours pour lui quelque inconsciente pulsion à satisfaire.
BLOG – DERNIERS ARTICLES MIS EN LIGNE
Médecin, chercheur, développe et enseigne la démarche Saluto dans ses différents champs d'application. Après des études de médecine à Lyon, il découvre la pédagogie curative et la sociothérapie, alliant la pédagogie et la santé. Pour lui, la question de toujours est d’offrir l’espace et les moyens permettant à chacun de devenir acteur de sa vie. Il ouvre un cabinet en Allemagne où il poursuit ses recherches dans le cadre de l’éducation spécialisée, puis en Suisse.
À partir de l’étude des grands chapitres de la pathologie humaine, il met en évidence quatre étapes de la présence à soi et au monde (1995) et découvre et développe à partir de cette recherche la Salutogénéalogie (2007) et la démarche Saluto (2014).
Il donne des conférences et des séminaires de formation pour enseigner cette démarche.
Il est auteur de publications faisant état de ses travaux.
Vous aimerez aussi
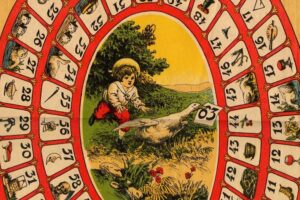
NOTRE VIE N’EST-ELLE QU’UNE SUCCESSION D’ÉVÉNEMENTS ?

MARIE MADELEINE SE TENAIT PRÈS DU TOMBEAU



1 commentaire