
VICTIME-SAUVEUR-PERSÉCUTEUR… COMMENT FAIRE ?
- Posté par Guillaume Lemonde
- Catégories Exercices pratiques, Le Je, Présence et attention, Relation thérapeutique
- Date 8 janvier 2021
Cet article évoquant le triangle « victime-sauveur-persécuteur » du point de vue de la démarche Saluto, est dédié à Philippe Ruby qui m’a suggéré le sujet. Merci à lui !

Le triangle victime-sauveur-persécuteur est une figure de l’analyse transactionnelle[1] qui a été proposée par Stephen Karpman en 1968 dans son article Fairy Tales and Script Drama Analysis. Il est également appelé le triangle dramatique. Ce triangle est d’ailleurs d’autant plus dramatique que l’on n’en sort pas aisément.
En effet, pour sortir de son rôle, la victime n’a a priori le choix que de devenir un sauveur ou un persécuteur, le persécuteur, un sauveur ou une victime et le sauveur, une victime ou un persécuteur. La distribution des rôles change, mais la même histoire se rejoue sans fin.
Karpman remarque que si une personne endosse l’un de ces rôles (par exemple celui de la victime), elle conduit l’autre à jouer un rôle complémentaire (celui du sauveur ou du persécuteur). C’est une sorte de jeu de chaises musicales avec deux ou trois personnages et trois chaises.
IL Y A DANS CETTE DYNAMIQUE INFERNALE UNE SORTE DE NÉCESSITÉ MÉCANIQUE
C’est une nécessité mécanique car chacun est amené à jouer un rôle selon ce que l’autre joue. Le choix de la distribution des rôles est donné par l’autre, et puisqu’il est conditionné par l’autre, c’est un choix de dupe.
On peut dire que les protagonistes sont, les uns pour les autres, les accessoires d’un jeu, plutôt que des partenaires. Il serait d’ailleurs plus exact de ne pas parler d’un jeu, car rien n’est libre ici dans ce conditionnement. Les acteurs ne font que réagir (à leur insu) à ce que l’autre détermine chez eux.
Un jeu conditionné n’est pas un jeu.
Il n’y a pas de place à la créativité dans le conditionnement. Il n’y a que des nécessités. C’est pourquoi le triangle de Karpman décrit les relations humaines prises dans le champ des nécessités.
Il décrit ce que les relations humaines deviennent lorsque les humains se laissent déterminer par ce qui les entoure. Lorsqu’ils oublient d’être acteur de leur vie.
Lorsqu’ils oublient leur autonomie sociale, leur autonomie affective…
Tout l’enjeu du triangle de Karpman est donc de découvrir l’endroit à partir duquel on cesse de réagir au décor pour enfin agir librement dans la vie.
Cet endroit existe-t-il ?
Avons-nous un libre-arbitre ? Ne sommes-nous pas, à notre insu, toujours en train de réagir à ce qui se propose ? Le triangle de Karpman n’est-il pas la seule réalité possible avec laquelle il s’agit de s’accommoder au mieux en le reconnaissant et en pouvant ainsi agir en connaissance de cause ? Je laisse pour l’instant ces questions ouvertes et poursuit avec une sorte de parabole, celle de l’acteur sur la scène d’un théâtre.

L’HISTOIRE DE L’ACTEUR SUR LA SCÈNE DU THÉÂTRE.
Un acteur se trouve sur la scène d’un théâtre. Il doit jouer son rôle bientôt. Mais l’éclairage le dérange au point qu’il ne s’imagine pas pouvoir jouer dans de telles conditions. Il va donc se plaindre auprès de l’éclairagiste qu’il tiendra pour responsable de son éventuelle mauvaise prestation d’acteur. L’éclairagiste, se sentant un peu coupable, se fait sauveur de l’acteur car il est disposé à l’aider.
Puis l’acteur va trouver le costumier qui a cousu un costume trop terne. L’acteur veut quelque chose qui le mette mieux en valeur. Le costumier qui trouve que cet acteur est un peu trop “m’as-tu-vu” se sent en position de force et explique qu’il ne peut pas reprendre le costume. Il se fait persécuteur de l’acteur.
L’acteur va se plaindre auprès du metteur en scène. Il va ensuite voir l’accessoiriste pour revoir le mobilier. Bref, l’acteur s’occupe avec toutes sortes de choses. Il passe des jours, jusqu’au lever de rideaux, à s’occuper du décor. Il se fait lui-même tour à tour victime, saveur, persécuteur de ceux qu’il rencontre, selon les circonstances.
Et quand les rideaux s’ouvrent enfin sur le public, il remarque que tout ce qu’il a fait jusque-là, et qui lui a couté beaucoup d’énergie, n’était pas une aide pour cet instant précis !
Pour être acteur, il doit trouver en lui la ressource qui lui permette de se lancer quel que soit l’éclairage, quels que soient les accessoires, les partenaires de jeu et les costumes.
L’acteur ne savait pas que l’essentiel était de trouver la ressource intérieure lui permettant de se lancer quel que soit l’état du décor !
Ce n’est pas au décor et aux accessoires de déterminer le jeu de l’acteur, mais à lui de jouer avec eux.
Ainsi, avec le triangle de Karpman, on observe ce que font les protagonistes lorsqu’ils oublient de jouer leur jeu véritable. Ils ne font que réagir au décor proposé par les autres.
Au moment où il se lance dans son jeu, un acteur renonce à s’occuper de ce qui le dérange. Il trouve en lui la ressource qui ne dépend de personne d’autre que de lui, la ressource qui lui permet de ne pas être chamboulé, bousculé, mis à terre, renversé par ce qui l’entoure. Il est en lien avec ce qu’il entoure, ouvert à ce qu’il entoure et pourtant absolument pas confondu avec ce qui l’entoure. Ouvert sans se perdre, fermé sans perdre le lien.
Cette ressource, c’est la stabilité intérieure. C’est par elle que l’on sort du triangle dramatique de Karman.
Cette stabilité lui est nécessaire comme au funambule qui se lance sur son câble. Comme au jeune cycliste qui se lance sans les petites roues de son vélo… Elle permet l’autonomie affective. Elle permet l’autonomie sociale.
LA STABILITÉ INTÉRIEURE
La stabilité est une ressource par laquelle un équilibre est trouvé entre l’ouverture au monde et la fermeture. Comment s’ouvrir sans se perdre en l’autre et se fermer sans perdre le lien avec l’autre ? La stabilité intègre les deux mouvements en même temps. Elle ne provient pas de la moyenne des deux. Elle est bien plus comme l’axe de la balance entre les deux plateaux libres d’osciller comme ils le veulent.
Comment exercer cette stabilité ? Je laisse cette question ouverte avant d’y revenir plus tard.
LE TRIANGLE VICTIME-SAUVEUR-PERSÉCUTEUR PEUT SE LIRE À PARTIR DE CETTE RESSOURCE MANQUANTE
Quatre étapes sont à considérer :
 1- Tout d’abord, lorsque cette stabilité manque encore, on est balloté par les sentiments qui s’ouvrent ou se ferment à l’autre selon que l’autre montre de la sympathie ou de l’antipathie. On voudrait que les relations soient agréables car les sentiments qui se retournent bousculent trop fortement. Ils font mal…
1- Tout d’abord, lorsque cette stabilité manque encore, on est balloté par les sentiments qui s’ouvrent ou se ferment à l’autre selon que l’autre montre de la sympathie ou de l’antipathie. On voudrait que les relations soient agréables car les sentiments qui se retournent bousculent trop fortement. Ils font mal…
Pour ne pas avoir mal, à ce stade, on quémande de l’attention. On peut même vouloir susciter de la pitié ou essayer de culpabiliser. Cette première étape, est celle de la victime qui n’est finalement victime que de son manque de stabilité intérieure.
Le sauveur qu’elle cherche est quelqu’un qui serait capable de lui témoigner des sentiments toujours orientés du côté de la sympathie. Et le persécuteur qu’elle montre du doigt n’est que le reflet dans le monde extérieur de la vulnérabilité à laquelle la soumet son instabilité.

2- Blessée, ou de peur de l’être, la victime (victime de son manque de stabilité) est sur le qui-vive. Elle devient très occupée à faire en sorte que ceux qui sont autour d’elle se sentent bien. En effet, du fait de son instabilité, lorsqu’elle s’ouvre aux autres, elle se perd en eux et ressent trop fortement leur mal-être. Elle est en sympathie, ce qui signifie « souffrir avec ».
Elle vient donc en aide à ceux qui l’entourent et se change en sauveur. Cette deuxième étape est celle du sauveur, qui n’est finalement le sauveur que de sa propre vulnérabilité. Le sauveur voudrait faire disparaitre la souffrance. Il voudrait s’empêcher de souffrir lui-même.
Pour ce faire, certaines personnes « montent dans leur tête » et rationalisent ce qui leur arrive. 1+1=2. C’est bien plus rassurant de réfléchir à la souffrance que de l’éprouver. Sur ce chemin, on devient technique, analytique, froid, efficace, pragmatique, « professionnel »…
La tête propose une pseudo stabilité qui remplace celle qui manque intérieurement. C’est un peu comme si un marin instable sur son bateau s’accrochait au bastingage. Ainsi, la tête et les réflexions qu’elle permet, s’offrent comme un bastingage auquel on s’accroche.
Autant la victime est dans l’épreuve née du manque de stabilité, autant le sauveur compense ce manque de stabilité en empêchant la souffrance comme il le peut.
3- Toutes les connaissances et les observations que le sauveur accumule pour que son entourage ne souffre pas (et donc pour ne pas souffrir lui-même) ont cependant une limite… Ce ne sont jamais que des échafaudages construits par la nécessité de se protéger. Ils sont conditionnés par la vulnérabilité première née du manque de stabilité. Ils ne sont donc pas stables eux-mêmes et il y aura forcément des situations qui mettront ces échafaudages à mal.
À ce moment-là, soit le sauveur fait tout pour renforcer l’échafaudage, en essayant de repenser la situation sous un nouvel angle ou de remanier son mode d’action, soit tout s’écroule et l’échafaudage mental qui permettait de ne pas souffrir doit être remplacé par autre chose.
Cette étape ne figure pas dans le triangle dramatique de Karpman (qui serait alors un carré…).
Elle est pourtant CENTRALE car elle propose la possibilité d’un renoncement : renoncer tout à la fois au renforcement de l’échafaudage mental et au remplacement de celui-ci par autre chose. Elle offre donc une porte de sortie à cet enchainement dramatique tel que décrit par Karpman. C’est à cet endroit que l’adulte libre, celui qui est acteur de sa vie, peut intervenir. C’est à cet endroit que la stabilité intérieure (telle qu’elle va être décrite un peu plus loin) prend pied dans ce jeu dramatique.
(Un champ de recherche pourrait s’ouvrir à ce sujet en collaboration avec des personnes pratiquant l’analyse transactionnelle : l’identification de ce point de retournement et sa caractérisation, selon le type d’épreuve que vit la victime, est au coeur même de la démarche Saluto. Les deux approches pourraient donc bénéficier l’une de l’autre).
Cependant ce renoncement ne peut venir que de la découverte de la stabilité intérieure. Et tout à la fois, s’exercer à ce renoncement permet de découvrir cette stabilité…
En tout cas, sans cette stabilité, la nécessité veut que pour ne pas tomber, le sauveur devenu impuissant à se sauver de son hypersensibilité cherche autre chose pour ne pas souffrir.
 4- Pour ne pas souffrir, le sauveur, qui jusque-là essayait de tranquilliser, de calmer (voir d’anesthésier) les sentiments, va désormais agir tout différemment. Comme il ne peut plus anesthésier la vie des sentiments, car il est débordé par eux, il va se donner du lest et laisser passer ceux qu’il vit comme positifs pour repousser les autres. Si le partenaire est en sympathie pour lui, il laisse faire. Sinon il repousse. Il repousse tout ce qu’il ressent de sentiments négatifs. Ainsi, le partenaire est acceptée tant qu’il est conforme à cette exigence. Mais l’exigence est impossible à tenir… (et le partenaire est d’autant plus repoussé, rabaissé, qu’il montre des sentiments négatifs dus justement à ce traitement. Un cercle vicieux qui est le propre de ce jeu dramatique).
4- Pour ne pas souffrir, le sauveur, qui jusque-là essayait de tranquilliser, de calmer (voir d’anesthésier) les sentiments, va désormais agir tout différemment. Comme il ne peut plus anesthésier la vie des sentiments, car il est débordé par eux, il va se donner du lest et laisser passer ceux qu’il vit comme positifs pour repousser les autres. Si le partenaire est en sympathie pour lui, il laisse faire. Sinon il repousse. Il repousse tout ce qu’il ressent de sentiments négatifs. Ainsi, le partenaire est acceptée tant qu’il est conforme à cette exigence. Mais l’exigence est impossible à tenir… (et le partenaire est d’autant plus repoussé, rabaissé, qu’il montre des sentiments négatifs dus justement à ce traitement. Un cercle vicieux qui est le propre de ce jeu dramatique).
Cette étape est celle du persécuteur, qui n’est finalement le persécuteur que de sa propre incapacité à se défendre de sa vulnérabilité : en effet, les jugements qu’il porte sont d’abord et avant tout destinés à lui permettre de ne pas subir ses propres sentiments. C’est parce qu’il est instable dans ses sentiments que le persécuteur maintient le partenaire dans la stabilité d’un mauvais traitement.
Ce jeu, extériorisé peut tout à fait être intériorisé. Lorsque l’on ressent par exemple de la culpabilité à ne pas aimer quelqu’un (ne pas aimer son enfant, etc.), on se trouve dans un processus d’auto-persécution. La culpabilité permet de ne pas sentir la balance des sentiments déstabilisante. On se reproche le manque de stabilité intérieure. Et le reproche permet de ne pas la vivre.
De même le perfectionnisme qui nous conduit à n’avoir aucune indulgence avec ce que l’on produit et qui nous déçoit.
COMMENT EXERCER CETTE STABILITÉ ?
La stabilité est au présent tandis que les sentiments se vivent dans une alternance chronologique. À un moment on aime puis à un moment on n’aime pas. À un moment on se sent perçu, puis à un moment on ne se sent pas perçu… À un moment on a envie d’aider puis à un moment, on n’a pas envie d’aider. Cela balance, cela s’alterne.
La stabilité se découvre lorsque l’on est présent et non plus dans le fil chronologique du temps. Elle se découvre donc en éprouvant chacune de ces alternances en même temps. La stabilité est une expérience non-duelle.
Il est possible de procéder ainsi :
Je prends d’abord un moment pour vivre : Je me sens aimé, perçu, etc. Comment ça me fait lorsque je me le dis ? Je reste avec ça un moment…
Puis un moment pour vivre : Je ne me sens pas aimé, perçu, etc. Comment ça me fait lorsque je me le dis ? Je reste avec ça un moment…
Ayant pris le temps de vivre ces deux expériences, je prends enfin un moment pour les laisser résonner toutes les deux en même temps. C’est intellectuellement impossible à faire, mais dans les sentiments cela ne pose pas de problème : c’est comme écouter une note de musique, puis une autre, puis de les laisser résonner toutes les deux ensemble en soi.
Il est important toutefois que l’on n’essaie pas de compenser une des deux expériences qui serait vécue trop négativement, par l’autre… Et si l’une est beaucoup plus forte que l’autre, il est important de mettre toute son attention à ce que les deux résonnent au même niveau.
C’est comme lorsqu’on entends quelqu’un jouer au piano un Do bien fort, puis, quelques instants plus tard, un Mi plus légèrement. On peut, quelque soit l’intensité de chacune des notes, les laisser résonner et entendre l’intervalle qu’elles forment. C’est la même chose ici.
« J’aime cette personne », puis « je n’aime pas cette (même) personne », puis les deux en même temps…
“Je me sens perçu”, puis “je ne me sens pas perçu”, puis les deux en même temps…
Cet exercice, à répéter chaque jour, permet de découvrir la stabilité qui offre de ne pas rester dans la nécessité mécanique du triangle dramatique victime-sauveur-persécuteur. Cet exercice permet de ne pas être dans le triangle de Karpman. Il permet de découvrir cet endroit à partir duquel on est autonome relationnellement, socialement.
La compréhension des mécanismes de ce triangle dramatique de Karpman permet une orientation précieuse. Elle permet de voir le décor de la scène sur laquelle nous sommes appelés à jouer notre rôle. Elle met en lumière les accessoires à disposition et le costume que l’on porte. Et puis, à un moment, il faut se lancer et jouer son rôle d’acteur, indépendamment des accessoires et du costume que l’on porte. La vie nous y conduit de toute façon. Il y a ce point de renoncement que je décrivais plus haut. Il est important que le thérapeute, l’analyste, le reconnaisse, car c’est un cadeau qui s’offre.
C’est le moment où il est donné de découvrir que notre libre arbitre découle d’un choix, d’un renoncement. Celui de renoncer à se protéger de sa vulnérabilité en jouant à la victime, au saveur et au persécuteur, mais au contraire de la vivre, cette vulnérabilité, en intégrant les extrêmes comme il vient de l’être proposé.
Au plaisir de lire vos commentaires.
Guillaume Lemonde
[1] L’analyse transactionnelle a été créée en 1958 par le médecin psychiatre et psychanalyste Éric Berne. Elle postule des « états du Moi » (Parent, Adulte, Enfant), et étudie les phénomènes intrapsychiques à travers les échanges relationnels de deux personnes ou plus, appelés « transactions ».
BLOG – DERNIERS ARTICLES MIS EN LIGNE
Médecin, chercheur, développe et enseigne la démarche Saluto dans ses différents champs d'application. Après des études de médecine à Lyon, il découvre la pédagogie curative et la sociothérapie, alliant la pédagogie et la santé. Pour lui, la question de toujours est d’offrir l’espace et les moyens permettant à chacun de devenir acteur de sa vie. Il ouvre un cabinet en Allemagne où il poursuit ses recherches dans le cadre de l’éducation spécialisée, puis en Suisse.
À partir de l’étude des grands chapitres de la pathologie humaine, il met en évidence quatre étapes de la présence à soi et au monde (1995) et découvre et développe à partir de cette recherche la Salutogénéalogie (2007) et la démarche Saluto (2014).
Il donne des conférences et des séminaires de formation pour enseigner cette démarche.
Il est auteur de publications faisant état de ses travaux.
Vous aimerez aussi
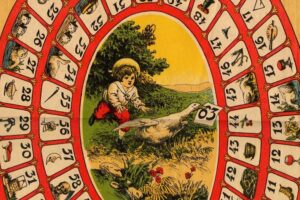
NOTRE VIE N’EST-ELLE QU’UNE SUCCESSION D’ÉVÉNEMENTS ?

MARIE MADELEINE SE TENAIT PRÈS DU TOMBEAU


7 Commentaires
Guillaume merci. Je suis très touché de cette analyse.., un carré, quelle bonne idée ! Ça donne une place au « stop assertif ».
Faudrait-il que votre étude soit certes associée aux recherches d’experts expertes en AT, mais aussi mêlée aux possibles des niveaux de conscience de la spirale dynamique ?
Par ex, une personne en DQbleu, qui croit incarner la vérité absolue -et qui donc l’incarne « de bonne foi systémique » va avoir besoin de sauver. Tant qu’il lui faudra expérimenter ce niveau bleu je crois que qu’elle va tourner en triangle sans pouvoir faire le petit pas de côté de votre carré.
Aux plaisirs d’en parler ?
Encore merci de cette super analyse, carrément rêve-évolutionnaire (-:
Philippe bonjour ! Merci pour ton message. C’est un grand plaisir pour moi d’échanger ainsi.
Il n’est pas possible de le montrer ici, mais avec cette “dynamique carrée” de la saluto (qui en fait est plus visuelle sur un cercle), les places de ce que l’AT nomme l’enfant adapté ou rebelle, le parent normatif ou nourricier, et l’adulte (tout comme les pointes du triangle de K), prennent une perspective nouvelle. Ce point assertif que je nomme ressource de renfort, et à laquelle on en amené à renoncer, m’apparait aujourd’hui dans ma pratique, un point d’approche thérapeutique essentiel pour l’accompagnement.
Bien sûr que j’aimerais en parler avec toi. Quand ? Un zoom ? À bientôt !
Volontiers pour un zoom Guillaume. Avec joie !!! J’aimerais parler avec toi de ce point d’accompagnement ; mêler nos expériences sur la légitimité (et les erreurs) de nos accompagnements… surtout au niveau DQ bleu.
Et, puisque tu m’encourages à écrire et que d’autres nous lisent / participent à la conversation – merci à vous (-;
Je crois qu’une personne coincée en DQBleu est comme hameçonnée par une morale qui ne lui appartient pas, mais qui est sa morale fondamentale, une espèce de pulsion qui jaillit des tripes – parfois de façon dramatique.
Je crois que c’est en DQ bleu que l’accompagnement du Parent (garant des valeurs) fonde un Adulte un jour responsable, libre, apprenant… Sachant utiliser son libre arbitre – pour être acteur de sa vie.
Bleu est donc un niveau d’existence (et d’exigence !!!) fondamental, qui permet à l’Enfant de devenir plus libre (de se rebeller ou se soumettre… mais aussi de vivre et laisser vivre et passer les choses).
Je crois que lorsque DQbleu est « bien » transmis, c’est à dire dans l’amour (donc aussi dans l’ouverture au futur) il facilite la mise en place des graines « éthique ».
Un futur qu’il nous faudra (et pas que les thérapeutes) accompagner… à évoluer. (??)
J’aimerais terminer par un sourire aux mamans (suffisamment bonnes dirait Winnicott ?). Des mamans pas toujours facile à aimer et qui, en bleu, ont un rôle si important – qui mériterait l’accompagnement de toute une société plus assertive ?
(-;
Encore une chose au sujet de ton exemple d’une personne croyant incarner la vérité absolue et qui ne pourra pas faire son petit pas de côté pour sortir du triangle de K : par nature, ce point de bascule, ce moment assertif se présente toujours de nouveau. La personne dont tu parles ne le reconnaitra probablement pas et se crispera sur ses positions… Mais lorsqu’un thérapeute sait l’entendre, peut le reconnaitre et sait quoi en faire, alors il a la possibilité d’offrir l’espace qui permette justement ce pas de côté.
Bonjour Guillaume, quelle surprise de lire ces mots qui devancent les miens! Cela correspond exactement au chemin que je suis en train de faire: le plus j’ai accès à cette stabilité intérieure, le moins je suis coincée dans les rôles du triangle. L’exercice proposé est un plus: faire résonner les contraires: le coeur s’unifie et fait naître ou renforce l’unité, source de cette stabilité?
Bonjour Geneviève, oui cet exercice offre un cadre pour qu’advienne cette stabilité. Et c’est d’autant plus fort qu’on le fait pour le faire et non pour obtenir un résultat. C’est une expérience que de rester avec ces contraires qui résonnent. Et cette expérience est paisible et stable.
Merci Guillaume pour la réponse. Oui, cette expérience nous emmène vers un endroit précieux! Tout en moment présent, en sensation intime…
Y être, s’en aller, y aller: les joies du surf intérieur!