
LE MAL ET SA BANALITÉ
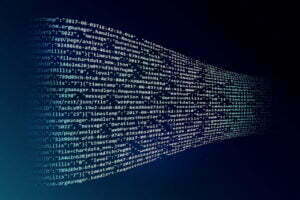
LE MAL ET SA BANALITÉ
Lorsque j’étais étudiant, j’ai pu entendre un professeur nous dire de ne jamais nous lier avec nos patients, faute de quoi nous perdrions en objectivité. Vos sentiments auront raison de vous, disait-il en substance. Ils vous brouilleront l’esprit. Sachez garder une distance professionnelle… Sans doute que ce professeur avait de bonnes raisons de nous donner un tel conseil. Il ne savait peut-être pas comment s’ouvrir à quelqu’un sans se perdre. Il est vrai que ce n’est pas une chose aisée, aussi vrai qu’il est difficile de rester en soi sans perdre pour autant l’engagement que l’on peut avoir pour la personne avec qui on se trouve.
Ce professeur voulait une médecine objective comme peut l’être une science.
Il voulait une médecine scientifique alors que la médecine n’est pas une science et qu’il serait bon de se le remémorer de temps à autres. La médecine est une pratique qui s’appuie sur des données de la science, mais qui a aussi une bonne part d’empirisme. Quand on fait réagir une substance avec une autre dans un tube à essais, dans de même condition de pression et de température, on obtient le même résultat à chaque fois. On peut aisément objectiver le processus et sa résultante.
Mais quand on donne un médicament à quelqu’un, on a aucune idée a priori du résultat. La connaissance qu’on en a ne peut être que statistique. En ce qui concerne les diagnostics, c’est la même chose. La complexité de la nature humaine ne se laisse pas réduire à une mécanique analysable aisément. Pourtant, ceux qui veulent faire de la médecine une science pensent y parvenir en collectant des données. Ils supposent qu’ils pourront alimenter des logiciels crachant facilement le diagnostic que le médecin n’aurait pas fait. Il est certain que dans bien des cas leur machine fonctionne. Mais la question n’est pas de savoir si la machine fonctionne : elle est de savoir si les êtres sont réductibles à des normes statistiques.
Peut-on réduire un phénomène quel qu’il soit à une somme ?
Peut-on normaliser le réel ?
Lorsque l’on essaie de le faire, on ne rencontre plus l’autre mais la norme à travers laquelle l’autre se trouve classé. C’est la norme qui devient importante et non plus la rencontre particulière que l’on peut offrir à celui qui a besoin de soins. Le cas particulier n’existe plus. L’autre n’existe plus. Seule la norme compte, organisant le réel d’après des critères finis et forcément bien plus étroits que lui. En s’appuyant sur la norme, on passe à côté de la variété et de l’unicité de chacun.
Il n’y a plus d’effort à faire pour aller vers l’autre. Là où j’aurais dû quitter ce que je connais pour découvrir qui il est, il est ramené à la norme. Il n’y a plus de processus de rencontre, de pas à faire en sa direction, pas d’apprivoisement. Il n’y a plus de chemin de découverte, ni même de chemin de pensée. La norme devient le critère, fini, abouti, total, indiscutable, à travers lequel le monde est analysé.
Son caractère indiscutable en fait un potentiel instrument totalitaire.
Si vous sortez d’une norme, on vous demande de tout faire pour corriger le tir. Rester dans la moyenne et suivre les mesures et les bonnes pratiques. D’ailleurs, vous le ferez de vous-même pour rester conforme, ne pas vous mettre au ban de la société. Vous éternuerez dans votre coude et mettrez votre masque.
Le problème n’est évidemment pas la norme en soi.
Il existe un code de la route, un code pénal, des contrats de travail et autres normes qui encadrent nos actions… Le problème survient lorsque la norme remplace la pensée car alors la pensée se trouve réduite à des slogans, des phrases toutes faites. Elle est remplacée par du jugement. Elle est sans profondeur, forcément, puisqu’elle reste à la surface du phénomène ; puisqu’elle est une non-pensée focalisant sur des critères jugés importants mais qui ne peuvent refléter le réel, plus grand que la somme de ses parties. Bref, une non-pensée efficace à mettre en œuvre des protocoles exacts.
Les êtres, passés au crible de la normalité, sont annulés en tant qu’êtres.
Ils ne sont que des cas classés selon les critères du moment. Ils sont gérés comme des objets et c’est là que se manifeste le mal : dans la non-rencontre qui réduit un être à une norme.
Avons-nous conscience que le mal est à l’œuvre exactement à cet endroit-là ?
Hannah Arendt parlait de la banalité du mal. Non que le mal soit banal ou qu’il faille le banaliser, mais le mal est tout puissant dans notre impuissance à penser le réel. Il se loge dans notre tendance à réduire le réel à des jugements, à une moyenne, à ne le voir qu’à travers cette moyenne aveugle aux cas particuliers. “Banal” signifie “trivial”, “ordinaire”. La réalité est tout sauf triviale et ordinaire quand on peut la penser dans sa profondeur, c’est-à-dire lorsque l’on essaie d’approcher sa qualité plutôt que de collecter des quantités d’informations.
La norme est issue d’une représentation quantitative du monde. Tandis que la qualité a une profondeur, la quantité n’en a pas. Jamais l’amoncellement des choses, des chiffres et des données n’aura de profondeur, puisque l’on n’attend pas du résultat d’une moyenne d’être plus que ce qu’elle mesure. Or chaque être est plus que la somme de ses parties.
Les personnes qui appliquent les directives à la lettre, se laissant guider par ces directives, participent à leur insu à cette maladie sociale de déshumanisation. Elles appliquent, sans penser à mal, des normes qui passent à côté de la rencontre, faisant de l’autre un objet à gérer. Elles deviennent à leur insu des clowns monstrueux (Arendt) :
Dans ce qui nous occupe aujourd’hui, ces personnes gèrent avec rigueur le bon port du masques par les élèves dans les écoles. Elles ne rencontrent pas les élèves qui n’en peuvent plus de porter des masques. Elles gèrent les doses de vaccin à administrer et les courbes démographiques, sans rencontrer les gens concernés. Certaines de ces personnes disent qu’il faut pourrir la vie des non-vaccinés de façon à ce qu’ils se vaccinent enfin… Ce qui est puni par le code pénal français sous le terme d’extorsion[1] devient normal dans ce monde normatif.
Chacun devient un objet que l’on juge en fonction de sa compliance à une norme.
J’ai entendu un médecin dire d’un malade du coronavirus, que c’était bien fait pour lui s’il était malade: il n’avait qu’à se faire vacciner !
Vous êtes gros ? Bien fait pour vous ! On vous interdira l’entrée du fast-food ! Vous êtes alcoolique ? Vous aurez à payer vous-même vos soins. Vous fumez trop ? Vous paierez la chimio de votre cancer du poumon. Vous avez le SIDA ? Vous n’aviez qu’à faire attention !
Bien-sûr, bien des gens trouvent que cela va trop loin…
Mais plutôt que de se mettre à penser la réalité, ils discutent de l’ampleur des mesures et de leur nature. Ils vont même protester contre certaines d’entre-elles, mais ils restent à la surface du problème.
Le seul vrai débat serait de savoir si l’on accepte de se laisser diriger par une norme (que cette norme concerne la couleur de la peau, la religion, la pensée politique ou le statu vaccinal. Accepte-t-on le principe même d’un laissez passer délivré en fonction de ces critères-là ?)
Veut-on d’un monde dans lequel on juge des gens en fonction d’une norme raciale, ethnique, politique, religieuse, biologique, sanitaire,… (ce qui est un pléonasme, puisque l’on juge toujours en fonction d’une norme), ou veut-on rencontrer l’autre dans ce qu’il a d’unique ?
Le mal que l’on fait aux gens à les réduire à une norme sans pouvoir les rencontrer est absolu en soi. C’est un absolu, car l’être unique de chacun est un absolu et c’est à lui que l’on s’en prend par ces pratiques. Et ce mal se répand comme un champignon (Arendt): il se répand à la surface du réel, focalisant notre attention sur cette surface, là où la pensée ne parvient plus à se tenir dans la profondeur des paradoxes et la nuance des résultats de ses recherches.
Notre responsabilité est donc de penser le réel. Écouter ce qui se dit et essayer de penser ce qui se dit. Remarquer au bout d’un moment qu’il n’est parfois pas possible de penser ce qui se dit car cela ne procède pas d’une pensée mais de jugements. Remarquer que notre tête est parfois paralysée par des informations contradictoires, tandis que nos sentiments sont aveuglés par la peur et la haine; peur de tomber malade et haine des autres qui ne comprennent pas que l’on a peur pour soi ou pour ses proches.
Notre responsabilité est de nous ouvrir aux autres, à ceux qui ne pensent pas comme nous, surtout à ceux qui ne pensent pas comme nous… Aller vers ce qui est différent et finalement vers l’altérité, car personne n’est semblable à un autre; écouter ce qui se dit et ce qui se pense. Écouter ce qui a peur en chacun. Écouter ce qui essaie de traverser cette peur.
Notre responsabilité est de ne pas saturer l’espace de la rencontre avec nos propres peurs et nos propres haines. Exercer la stabilité intérieure, la profondeur face aux perceptions, l’engagement, la confiance (à ce sujet, je vous renvoie aux formations Saluto).
Guillaume Lemonde
[1] Article 312-1 / Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 – art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
L’extorsion est le fait d’obtenir par violence, menace de violences ou contrainte soit une signature, un engagement ou une renonciation, soit la révélation d’un secret, soit la remise de fonds, de valeurs ou d’un bien quelconque. L’extorsion est punie de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende.
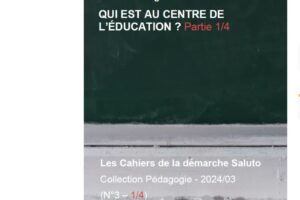
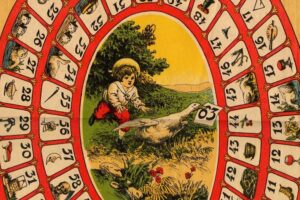


1 commentaire
Vous exercez une compréhension et une lucidité exemplaire dans vos écrits, ce que j’apprécie beaucoup, car c’est si difficile à trouver de nos jours !