
LA DÉMARCHE SALUTO EN QUELQUES DATES
- Posté par Guillaume Lemonde
- Catégories Articles, Au sujet de la Saluto
- Date 17 septembre 2021
 À quel moment se situe la naissance de la démarche Saluto ? De quand date-t-elle ?
À quel moment se situe la naissance de la démarche Saluto ? De quand date-t-elle ?
Lorsque je me pose ces questions, des étapes cruciales me reviennent en mémoire.
Au cœur de cette aventure, il y a essentiellement une question posée à Madame M. Glöckler, médecin, à cette époque responsable de la section médicale de la société anthroposophique et à Monsieur J. Berron, médecin, lui aussi. C’était en 1995. Je portais cette question depuis mes 18 ans et le début de mes études de médecine.
Je leur demandais à tous deux comment faire pour identifier pour chaque déséquilibre pathologique, les ressources que pourraient exercer les patients eux-mêmes, de façon à ce qu’ils s’engagent dans le processus thérapeutique. La prescription de substances, se substituant au travail intérieur, me semblait faire l’épargne de quelque chose d’essentiel. La réponse donnée fut d’étudier une conférence de Rudolf Steiner adressée à de jeunes médecins. Dans cette conférence, celui-ci explique que l’on peut, en observant la vie des sentiments des gens que nous rencontrons, mettre en évidence des déséquilibres pathologiques, avant même qu’ils ne s’expriment dans le corps.
Cette conférence m’a accompagnée 12 ans, douze années pendant lesquelles j’ai étudié systématiquement les déséquilibres caractéristiques des grandes familles de pathologies humaines : les maladies allergiques et d’intolérances, les maladies déformantes ou sclérosantes, les maladies inflammatoires et les maladies tumorales.
Parallèlement je pratiquais six exercices complémentaires à la méditation. Ces six exercices qui m’accompagnèrent au quotidien depuis 1993, furent l’objet d’une conférence en 2002. J’exposais dans le déroulé de ces six exercices, le résultat de mes recherches et en donnais pour la première fois un exposé. Cette conférence fut retranscrite et me fut envoyée pour relecture. Je relus la conférence et l’augmentais. Cela allait devenir un livre intitulé les Pas du Randonneur. C’était un livre d’étude, un livre bourré de références, sans doute difficile à lire, mais qui avait l’avantage de décrire quatre processus d’un point de vue pour moi à l’époque nouveau, celui de l’avenir.
Les pathologies s’expliquent en effet depuis le passé quand on regarde comment un facteur pathogène fait dérailler la mécanique. Elles s’expliquent depuis l’avenir quand on découvre qu’une ressource essentielle, encore à venir, pourrait être exercée et saisie afin de guérir. Et c’est parce que l’on cherche à rendre présente cette ressource que l’on tombe malade. En fait la maladie est une tentative de guérison. Elle est un essai de rendre présent ce qui ne l’est pas encore.
Et puis il y a 2007.
2007, c’est la fin de la rédaction des Pas du Randonneur, que j’allais publier en mars 2008. Et c’est également l’année de cette incroyable aventure bourguignonne racontée dans Découvrir la Salutogénéalogie ; une expérience intime qui m’a fait mettre en rapport ces quatre processus pathologiques avec les quatre fonctions grands-parentales. Cette mise en relation n’avait plus rien à faire avec la pensée, l’étude, la recherche. Ce fut une expérience directe, fondée en elle-même, ne nécessitant plus aucune référence sur laquelle s’appuyer.
À cette époque commença un chemin de recherche qui n’avait plus besoin de se référer à une source conceptuelle. C’est comme si la source se trouvait désormais devant et qu’il était nécessaire d’en dégager l’accès.
Je venais de découvrir, avec les fonctions grands-parentales, des processus thérapeutiques associés et pouvais offrir aux patients un champ d’exercices permettant de s’engager eux-mêmes dans un processus thérapeutique. Les résultats furent saisissant.
Il me restait toutefois à mieux percevoir quelle fonction grand-parentale était à solliciter pour telle ou telle personne. J’avais besoin de pouvoir poser un diagnostic sans ambiguïté. Il reposait à l’époque plus sur un faisceau d’impressions que sur des faits transmissibles et reproductibles. Autrement dit, la question qui se posait encore et toujours était de savoir comment lire dans la vie des sentiments le déséquilibre. C’était la question de 1995 à laquelle je n’avais pas encore répondu.
Cyr Boé m’a beaucoup aidé à ce sujet. Je lui exposais un jour l’état de mes recherches, les processus pathologiques et les fonctions grands-parentales associées. Il m’écouta et il me dit reconnaitre dans ces quatre fonctions grands-parentales, quatre arcanes du jeu du tarot de Marseille, avec lesquelles il s’était longuement occupé dans sa jeunesse. Je me souvenais que C.G. Jung s’était occupé lui aussi du Tarot de Marseille et souriait à ce clin d’œil. Je venais, la même semaine, de finir de lire la biographie du psychiatre zurichois.
Je laissais donc Cyr me parler de ces arcanes et remarquais qu’elles n’étaient pas seulement ressemblantes avec ce qui m’occupait, mais qu’étonnamment elles décrivaient la même réalité. Je ne connaissais rien à ce tarot, mais reconnaissais dans ce que Cyr me racontait des différentes cartes, les épreuves et ressources spécifiques de chacune des quatre fonctions-grands-parentales (déjà exposées dans les pas du Randonneur). Il compléta pour moi le tableau d’une grande ressource que je n’avais à cette époque pas encore perçue.
Nos échanges furent nombreux. Je lui rapportais quasi quotidiennement les fruits de mes observations et de mes recherches et l’écoutais commenter mes apports à travers le tarot, comme un écho de ce que je portais, avec d’autres mots. Ce partage avait l’effet d’un miroir. Il créait un intervalle dans lequel de nouvelles compréhensions survenaient. Il me parlait en images et j’essayais de distinguer dans l’intervalle qui se formait entre ces images et mes perceptions, les concepts qui voulaient bien se montrer.
Les premiers cours de Salutogénéalogie – le nom m’était venu en août 2008, comme réponse à la psychogénéalogie qui prend un point de vue différent du mien – eut lieu avec Cyr à Yverdon-les-Bains en 2013. J’avais entre temps plus de 500 cas cliniques venant corroborer mes recherches. Ces cas attestaient d’un diagnostic de fonction grand-parentale-ressource et d’effets thérapeutiques patents.
Dans les cours, certains de ces cas anonymisés furent exposés et éclairés de grandes images décrivant ces quatre processus. En fait, à travers ces cas, pour les rendre intelligibles, Cyr et moi en étions encore à décrire les cartes du tarot sans les nommer. Mais en devenant, dans un premier temps, la représentation à travers laquelle je cherchais le concept que je pourrais mettre en relation avec ce que ce que vivaient les patients, le tarot était tout à la fois une aide et un biais : je n’étais jamais sûr à 100% de ce que j’avais perçu, car ce n’est pas la chose en soi que je percevais alors mais la ressemblance que cette chose présentait avec le référentiel qui me servait de béquille.
Nous connaissons le même biais lorsque nous nous aventurons à vouloir reconnaitre le tempérament d’un enfant. Nous reconnaissons ce que nous avons compris de la chose et non la chose en soi. Comme nos observations collent plus ou moins bien avec ce que nous en savons, nous en restons à des hypothèses, des spéculations plus ou moins affirmées.
Bref, il me manquait une démarche phénoménologique.
En 2014, le concept devint enfin visible.
J’ai raconté comment cela s’est passé dans Les Paysages de nos Quêtes. Je pouvais enfin me détacher de la précieuse béquille qu’avait constitué le tarot de Marseille et commencer à directement entendre les ressources à venir dans ce que les personnes témoignaient d’elles-mêmes. Et du même coup, le décor et ses multiples ressources, ainsi que l’agencement des ressources à venir, devinrent de plus en plus clairs.
Dès lors, il n’était plus nécessaire de s’en tenir à des fonctions grands-parentales. La Salutogénalogie s’intéressant aux relations transgénérationnelles du point de vue de l’avenir, apparaissait soudain comme un domaine spécifique d’une démarche bien plus large. La démarche Saluto était née, pouvant s’appliquer à la famille par la Salutogénéalogie, mais aussi à l’éducation par la Saluto-éducation, à l’accompagnement biographique par la Salutobiographie, aux entretiens thérapeutiques… Bref, à la rencontre dans toutes les formes qu’elle peut prendre.
Cyr et moi avions jusque-là écouté les témoignages que les gens voulaient bien offrir d’eux-mêmes, à partir de leur ressemblance avec le jeu du tarot – un peu comme on peut comprendre quelqu’un à partir de son habit… Nous nous en étions tenu à un monde d’apparence et étions passé à côté de la rencontre avec celui qui porte l’habit. Désormais il était possible de me détacher de ce jeu de ressemblance et de percevoir directement l’essentiel. Un chemin phénoménologique était ouvert.
Toinon Folque, qui avait participé au deuxième cours de Saluto, reconnut l’importance de l’écoute. Comment entendre les ressources à venir, si l’on plaque sur l’écoute tout ce qui nous habite ? Comment faire silence et entendre l’essentiel ?
En 2016,
la question des ateliers d’écoute est arrivée par elle.
Ces ateliers étaient des moments d’exercices à l’écoute, essentiels dans la démarche Saluto. Tout aussi essentiels que d’apprendre à reconnaitre les ressources à venir, puisque l’un ne va pas sans l’autre. Ils se sont métamorphosés pendant le confinement en atelier par visio conférence et perdurent depuis. Ils ont lieu chaque semaine pour tous ceux qui ont suivi la formation en Saluto.
En 2020,
la fin d’un cycle de deux années de formation a été l’occasion de faire le point sur le chemin parcouru et de constater que la démarche Saluto vit désormais chez de nombreuses personnes.
Elle est passée dans le monde. Elle fructifie le travail pédagogique de pédagogues, la rencontre psychothérapeutique de thérapeutes, l’approche transgénérationnelle, la démarche artistique d’artistes, le travail d’accompagnement biographique, devenant Salutobiographie.
Il y a eu déjà 12 promotions (dont 2 allemandes) dans 5 pays différents et de nouveaux cours sont en préparation, trouvant une forme toujours plus proche de ce que je voudrais transmettre : l’art de la rencontre, l’espace que l’on peut offrir pour que la rencontre se donne.
Avec la démarche Saluto, la question de 1995 a trouvé sa réponse dans une pratique permettant de ne pas projeter sur l’autre un bagage personnel, mais d’ouvrir les sens à ce qui est et non à ce que l’on croit reconnaitre.
Guillaume Lemonde
.
Médecin, chercheur, développe et enseigne la démarche Saluto dans ses différents champs d'application. Après des études de médecine à Lyon, il découvre la pédagogie curative et la sociothérapie, alliant la pédagogie et la santé. Pour lui, la question de toujours est d’offrir l’espace et les moyens permettant à chacun de devenir acteur de sa vie. Il ouvre un cabinet en Allemagne où il poursuit ses recherches dans le cadre de l’éducation spécialisée, puis en Suisse.
À partir de l’étude des grands chapitres de la pathologie humaine, il met en évidence quatre étapes de la présence à soi et au monde (1995) et découvre et développe à partir de cette recherche la Salutogénéalogie (2007) et la démarche Saluto (2014).
Il donne des conférences et des séminaires de formation pour enseigner cette démarche.
Il est auteur de publications faisant état de ses travaux.
Vous aimerez aussi
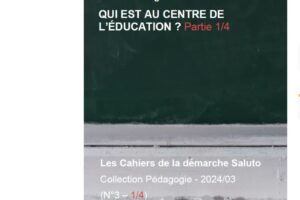
QUI EST AU CENTRE DE L’ÉDUCATION
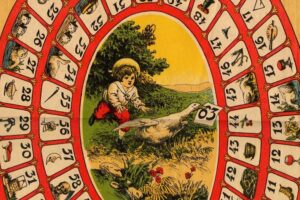
NOTRE VIE N’EST-ELLE QU’UNE SUCCESSION D’ÉVÉNEMENTS ?

 À quel moment se situe la naissance de la démarche Saluto ? De quand date-t-elle ?
À quel moment se situe la naissance de la démarche Saluto ? De quand date-t-elle ?