
LES LIMITES DE LA SAGESSE ET DE LA PUISSANCE
L’originalité de la démarche Saluto est de donner les moyens de percevoir l’origine des difficultés rencontrées, non dans des causes passées à résoudre, mais dans la nécessité de faire advenir des ressources permettant de jouer librement avec ce qui se présente. Caractériser, identifier ces ressources fondamentales encore à venir et permettre d’exercer à les rendre présentes, est au centre de son expertise.
La sagesse, qualité de quelqu’un qui fait preuve d’un jugement droit, sûr, averti dans ses décisions et ses actions, est ce qui nous permet de nous approcher de la cause des causes – que cette cause soit sur un plan spirituel ou matériel – et de connaitre la conséquence des actes que l’on pose. Ainsi, il est possible de parler d’une sagesse médicale, lorsque l’on considère toutes les connaissances que la médecine a recueillies. Plus nous sommes sages, plus nous sommes en mesure d’identifier les causes qui se trouvent en amont des premières causes évidentes, et nous pouvons supposer les conséquences les plus éloignées.
La puissance est ce qui nous permet d’agir sur ces causes. Plus nous sommes puissants, plus nous pouvons interférer dans cet enchainement pour l’infléchir dans une direction souhaitée.

Photo : Quentin Verwaerde Tintoret, 1518-1594, Portrait d’un sculpteur (Ascagne, dit “aux christs”), Alte Pinacothek, Munich
D’ailleurs, divers degrés de sagesse et de puissance forment chaque compétence professionnelle, chaque savoir-faire. On peut être très sage et peu puissant, savoir et percevoir beaucoup de choses mais se sentir incapable de faire bouger quoique ce soit quand il le faudrait. On peut être très puissant mais peu sage et faire de grands dégâts que l’on regrette ensuite.
– Sans doute, et j’ai connu un homme qui prouvait, par bonnes façons, qu’il ne faut jamais dire : une telle personne est morte d’une fièvre et d’une fluxion sur la poitrine, mais : elle est morte de quatre médecins et de deux apothicaires. [1]

Photo de : Le Médecin malgré lui
Mais quoi qu’il en soit, du fait même qu’elles sont dépendantes de la recherche de causes et d’effets, notre sagesse et notre puissance sont vouées à rencontrer des obstacles :
Il y aura toujours en amont une cause que l’on n’aura pas vue et qui nous rattrapera au point que la situation qui posait problème se représentera. Il y aura toujours en aval une conséquence liée à cette cause première et que l’on n’aura pas prévue et qui confluera avec celles que l’on voulait combattre. Nous pouvons atténuer, renforcer, accélérer ou ralentir un instant le cours des évènements, mais fondamentalement, de notre action elle-même déterminée par un enchainement de causes et d’effets, ne peut surgir quoique ce soit d’autre que ce que ces causes qui nous dépassent auront déterminé.
J’aimerais illustrer ce point par un exemple vécu :
Les premières années de pratique médicale furent l’occasion de mettre en œuvre ce savoir-faire. Je maîtrisais les protocoles hospitaliers. Lorsqu’un enfant présentait une bronchite surinfectée, un antibiotique devait être prescrit. Les résultats étaient rapides. Mais certains enfants revenaient chaque mois, abonnés à leur traitement durant tout l’hiver. J’avais dû oublier un paramètre. Il devait y avoir une cause à prendre en compte en amont de l’évidente cause bactérienne.
Ce que j’avais omis, c’était que les bactéries prospèrent lorsque l’immunité est trop faible pour les combattre. J’avais identifié la présence de bactéries, mais oublié ce qui causait cette présence infectieuse. J’avais même omis de prendre en compte, en amont de cette cause-là, un enchainement causal qu’il aurait été théoriquement possible de remonter à l’infini.
Comme l’antibiotique arrivait en bout de chaine, son action était soumise aux causes qui se trouvaient en amont. Il en faisait donc le jeu et contribuait lui aussi à affaiblir un peu plus l’immunité déjà fragile. J’appris, peu de temps après, qu’effectivement les antibiotiques abiment ce lieu essentiel de l’apprentissage immunitaire qu’est la flore intestinale. Ainsi, même en traitant très efficacement une infection avec un antibiotique, je favorisais par la même occasion une rechute ou une autre pathologie.
Si j’ai pris le temps de vous raconter cette histoire de bactéries et d’antibiotique, c’est parce qu’elle fut décisive pour comprendre qu’il y aura toujours, en amont des causes que l’on peut déterminer, d’autres causes que l’on n’aura pas prises en compte. Elles resteront actives et nous rattraperont, au point que la situation qui posait problème se représentera. De même, il y aura toujours, en aval, une ultime conséquence liée à ces causes premières et que l’on n’aura pas prévue. Elle confluera avec celles que l’on voulait combattre.
Nous pouvons atténuer, renforcer, infléchir, accélérer ou ralentir le cours des évènements, mais fondamentalement, temps que notre action s’appuie exclusivement sur la compréhension des causes et la tentative de changer les conséquences qui ne nous vont pas, elle demeure prisonnière des enchainements de causes à effets. Elle ne peut faire surgir quoique ce soit d’autre que ce que ces causes qui nous dépassent auront déterminé.
***
Notre savoir-faire est efficace pour la mécanique du quotidien.
Par mécanique j’entends l’automatisme de nos comportements, celui qui ne requière rien de plus que de réagir perpétuellement à ce qui se passe. Nous sommes soumis à quelque chose et agissons en conséquence, plus ou moins sagement, plus ou moins puissamment. Mais si nous voulons, plutôt que de réagir, agir, si nous voulons rendre possible quelque chose qui soit absolument nouveau, inédit, inespéré, bref, si nous voulons rendre possible un réel changement, nous avons à opposer à ce que nous dictent notre sagesse et notre puissance, une présence capable d’y renoncer : nous avons à suspendre un instant les automatismes qui nous conduisent à chercher dans ce que l’on sait déjà, de quoi comprendre ce qui se présente. Nous avons à faire silence. Cela nous permettra peut-être de percevoir la situation telle qu’elle est et non telle que l’on croit qu’elle est, ou que l’on aimerait qu’elle soit.
De même, si nous pouvions arrêter un instant de compter sur les effets que nos actes pourraient avoir, nous agirions peut-être pour ce que requière la situation qui se présente et non pour la projection d’un effet désiré.
Renoncer à savoir, renoncer à pouvoir, ne serait-ce qu’un instant et nous tenir devant la peur de ne pas savoir ni de pouvoir. Renoncer à chercher de quoi calmer cette peur.
Quand ils se présentent malgré nous, de tels moments sont impossibles. Comment se tenir démunis de la sorte, lorsque les moyens essentiels pour aider un proche, un malade, un mourant, nous manquent amèrement ? Nous avons tous connus de ces moments d’impuissance ou rien de ce que nous savons ne peut aider d’aucune façon. Ces moments sont impossibles et pourtant ce sont les seuls où tout soit possible. En avons-nous conscience ? Si quelque chose survenait en ces instants, cela se donnerait comme un cadeau que l’on découvrirait alors qu’on ne le chercherait pas. Un cadeau offert à notre impuissance la plus absolue et qui se déroberait à tout ce que l’on entreprendrait pour savoir comment le trouver et avec quel moyen y parvenir.
Ce cadeau on le reçoit en renonçant à le chercher. Il se donne lorsque l’on fait silence !
Et l’on s’aperçoit alors d’une chose extraordinaire : c’est qu’il est tout à la fois ce qui se donne et ce qui, dans le silence et le renoncement, permet qu’il se donne.
Si nous voulons rendre possible un réel changement
Si nous voulons rendre possible du nouveau, de l’inédit, de l’inespéré, bref, si nous voulons rendre possible un réel changement, nous avons à opposer à ce que nous dictent notre sagesse et notre puissance, une présence capable d’y renoncer un moment. Nous avons à suspendre un moment les mécanismes naturels qui nous conduisent à chercher dans ce que l’on sait, de quoi comprendre ce qui se présente. Cela pourrait nous permettre de percevoir la situation telle qu’elle est maintenant et non d’après les ressemblances que nous croyons trouver entre elle et les expériences passées…
De même, nous avons à mettre en veilleuse les représentations que nous avons des effets que nos actes devraient avoir. Cela nous permettrait d’agir maintenant pour la situation et non pour la projection d’un effet désiré.
Bref, nous avons à nous tenir devant la peur de ne pas savoir et la peur de ne pas pouvoir et à renoncer de chercher de quoi la calmer.
Pour y parvenir, un retournement doit s’opérer :
– La volonté,
qui se dispense naturellement en puissance, plutôt que de se projeter dans le monde pour y trouver satisfaction, se recentre au présent en exerçant la stabilité, la profondeur, le courage et la confiance, nécessaires pour se tenir dans la peur de ne pas savoir et la peur de ne pas pouvoir, sans y succomber. Ces quatre ressources sont à rapprocher des quatre vertus dont parle Platon dans La République. On en a d’ailleurs fait des vertus cardinales (de carduus, le pivot en latin), car elles permettent de faire pivoter la situation, de retourner la situation et de faire survenir du nouveau, de l’inédit, de l’inespéré.
Remarque : les exercices proposés lors des cours de Saluto, vont dans ce sens.
– La pensée
qui nécessite naturellement de prendre du recul afin d’identifier la cause des phénomènes qui se présentent, s’ouvre à l’extérieur afin caractériser ce qui se présente. Ce n’est plus tant le pourquoi qui compte, mais le comment. Plutôt que de puiser en notre bagage des raisons et des solutions, nous nous ouvrons à ce qui nous entoure en caractérisant ce qu’offrent les perceptions. C’est ainsi que la connaissance, y compris la connaissance de soi, passent par une ouverture à l’altérité et à plus grand que soi. La connaissance fait place à un réel étonnement et, en s’appliquant à caractériser de la sorte ce qui se présente, la pensée devenant libre de s’exercer au présent (le comment est au présent, et non le pourquoi qui cherche dans le passé des explications) permet de découvrir, dans ce que la rencontre a d’unique, un lien immédiat avec ce qui est universel. Une vérité immédiate s’exprimant à travers ce qui est unique et personnel. C’est ainsi que l’on peut se lier à la personne que l’on rencontre indépendamment des raisons qui nous poussent à être ensemble et des désirs que chacun projette sur cette rencontre.
Remarque : l’attention que l’on porte, lors des cours de Saluto, à reconnaitre les motifs universels qui appartiennent à l’avenir et ceux qui appartiennent au passé, dans ce que dit quelqu’un que l’on rencontre, va dans ce sens.
***
Voilà pour aujourd’hui. Si cet article vous a intéressé, je vous remercie de le partager avec vos amis. Et merci pour vos commentaires en bas de page. Ils seront enrichissants.
[1] Molière, L’amour médecin.

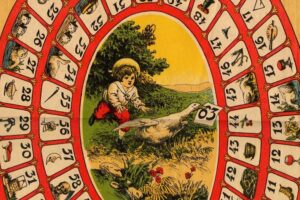


4 Commentaires
Bonjour Dominique et merci pour cette réflexion qui ne peut que faire écho à nos propres constatations de praticien! Actuellement médecin retraitée je me suis très rapidement aperçue que dans le domaine de l’infectiologie une infection ne recquierait que rarement une antibiothérapie qui abîmait chaque fois le terrain et diminuait l’immunité, en dehors du fait avéré de la sélection de germes résistants; un autre point important est l’accompagnement psychologique du traitement d’un épisode infectieux. Avez vous remarqué qu’une simple angine guérissait plus rapidement si vous aviez pris le temps d’écouter le mal être souvent à l’origine de cette contamination? Mal être intervenant lui même dans la qualité de l’immunité.. le fait de n’avoir pas pris le temps d’écouter entraine souvent soit une efficacité de nos traitements, soit une rapide récidive…
Un mystère se donne dans la rencontre comme une grâce qui nous est faite… Quand le médecin se focalise sur la suppression des symptômes pathologiques, il oublie le malade qui fait chemin avec son problème. Il veut supprimer l’épreuve, là où la guérison nécessiterait de la traverser. Il y a dans la volonté de suppression des symptômes, l’aspiration à y parvenir le plus vite possible; tandis que l’aide à traverser l’épreuve se déploie dans le temps long de la rencontre. Merci Dominique pour votre message.
Dans ce renoncement, on acquiert une sérénité bienfaisante, pour soi et pour l’entourage !
Oui, Monique. Ce renoncement est celui que notre présence à l’autre permet.