
ON EST ADULTE QUAND ON A PARDONNÉ À SES PARENTS
- Posté par Guillaume Lemonde
- Catégories Biographie et Histoire, Chroniques Contemporaines et Pensées, Philosophie, Présence et attention, Relation thérapeutique, Relations transgénérationnelles, Temporalité
- Date 11 juin 2021
L’originalité de la démarche Saluto est de donner les moyens de percevoir l’origine des difficultés rencontrées, non dans des causes passées à résoudre, mais dans la nécessité de faire advenir des ressources permettant de jouer librement avec ce qui se présente. Caractériser, identifier ces ressources fondamentales encore à venir et permettre d’exercer à les rendre présentes, est au centre de son expertise.
« On est adulte quand on a pardonné à ses parents. »
Cette sentence serait de Johann Wolfgang Goethe[1]. Récemment, je lisais les commentaires que bon nombre d’internautes ont laissé à son sujet et remarquait la difficulté qu’elle procure à certains. Dans le cas extrême d’un inceste, disait une personne assez remontée contre une telle affirmation, on ne peut pas pardonner ! Est-on alors condamné à rester enfant ? Une autre personne écrivait : pour pardonner, il faut qu’il y ait eu une faute. Mais là, je ne vois pas en quoi la faute des parents serait nécessaire pour devenir adulte…
Manifestement, cette phrase de Goethe ne laisse pas indifférent. Ou du moins sa traduction, tirée de je ne sais où. Je n’ai effectivement pas réussi à trouver la phrase originale en allemand et donc encore moins le contexte dans lequel cette phrase se trouve (si vous savez d’où cette phrase est tirée, merci de l’indiquer dans les commentaires).
À défaut de connaitre le contexte, je ne vais donc pas m’aventurer à chercher ce que Goethe voulait dire d’une façon si lapidaire. Je vais juste essayer d’exprimer comment je comprends cette phrase.
***
« On est adulte quand on a pardonné à ses parents. »
Cette phrase peut se lire depuis le passé ou depuis l’avenir.
Depuis le passé :
Lire cette phrase depuis le passé, c’est la lire d’après le point de vue chronologique habituel : le temps s’écoulant depuis le passé vers le futur, il enchaine des causes passées à des effets ultérieurs. De ce point de vue, la phrase « On est adulte quand on a pardonné à ses parents », signifie que l’on pardonne à ses parents et donc on devient adulte. Il y a un rapport de causalité. Le fait d’être adulte, dans ce cas, est le développement du pardon que l’on accorde. Si l’on ne pardonne pas, on ne devient pas adulte. D’où la protestation de certains internautes qui trouvent que la barre est placée un peu trop haut dans des cas extrêmes, comme dans celui d’un inceste, par exemple.
En fait, regarder la vie depuis le passé, c’est-à-dire en considérant qu’aujourd’hui est la résultante d’hier, nous conduit à considérer notre existence comme non fondée en elle-même. Elle dépend de paramètres nous échappant absolument : elle dépend de notre éducation, de notre biologie, et donc de nos parents et des aïeux qui ont transmis leur patrimoine génétique.
Ajoutez à cela qu’il faudrait pardonner afin de pouvoir être adulte, et vous obtenez une vie à laquelle il est impossible de présider. En effet, même le pardon, dans un tel cas-là, est conditionné par ce qui s’est passé avant et ne dépend pas de nous. Il dépend de l’ampleur de la faute à pardonner. Petite faute : le pardon est encore possible. Grande faute : le pardon est impossible.
Depuis l’avenir :
Que serait un pardon s’il était conditionnel ? Que serait un pardon s’il n’était possible qu’à la condition que la faute à pardonner ne soit pas trop importante ? Ce ne serait pas un pardon !
Le pardon ne peut pas s’expliquer depuis le passé. Tout comme il est absurde d’expliquer que l’on a du courage à la condition qu’il n’y ait pas d’obstacles, ou confiance à condition que tout aille bien… On a du courage, ou on n’en a pas ! De la confiance, ou on n’en a pas ! Quelle que soit la faute, quand on pardonne, c’est entièrement ou pas du tout.
Ainsi, ce qui en nous peut pardonner ne peut pas être conditionnel. Cela n’est pas un développement du passé. Cela n’est pas chronologiquement compréhensible. Cela vient d’ailleurs. Cela transcende toute chronologie.
Et ce qui n’est pas chronologique, dans notre perception chronologique du temps, nous apparait comme venir de l’autre côté, de l’avenir : cela advient. Cela surgit et on a le choix de le rendre possible, ou de le laisser passer. Et quand ce choix se présente, il s’impose comme une évidence librement consentie. Pardonner s’impose comme une évidence librement consentie.

Nous connaissons tous ces moments où nous avons le choix de suivre nos inclinations, nos peurs, nos aversions, nos désirs de vengeance, ou de ne pas les suivre.
Gandhi parlait à ce sujet d’une mécanique de l’âme (voir l’article Êtes-vous pour ou contre ?) que l’on suit ou que l’on renonce à suivre. La mécanique de l’âme est ce qui se fonde dans le passé et réclame un dédommagement. Cette mécanique dira : œil pour œil et dent pour dent. Ne pas suivre la mécanique de l’âme, nécessite un renoncement. Un renoncement qui n’est le développement de rien, mais qui procède d’un choix le rendant possible. Le choix de renoncer.
Ce à quoi il s’agit de renoncer, c’est avant tout à suivre le besoin de compensation. Quelle que soit le reproche que l’on puisse faire à ceux qui nous ont précédés, nous avons le choix de renoncer à une compensation et de donner le meilleur de nous-mêmes dans le contexte que nous avons à disposition.
Quand un acteur sur la scène d’un théâtre souffre de ne pas avoir les bons accessoires, il peut soit aller se plaindre au costumier et à l’accessoiriste et passer des années à se plaindre, soit improviser avec ce qu’il a à disposition. Plutôt que de repousser ce qui ne lui va pas, il peut décider de s’y lier et d’improviser avec.
C’est cela que je comprends dans la phrase « On est adulte quand on a pardonné à ses parents. ». Cette phrase renvoie au plus intime d’un choix qui ne se discute pas en fonction des circonstances propres à chacun. Elle nous appelle juste à devenir responsable de notre vie, c’est-à-dire de ce que nous allons faire de ce qui nous a été donné de vivre.
Pour en savoir plus, lire l’article : C’est moi qui suis responsable de ce qui m’arrive.
***
Friedrich Schiller, le grand ami de Goethe, avait écrit en 1794, dans les Lettres sur l’éducation esthétique de l’Homme : L’Homme n’est pleinement Homme que lorsqu’il joue.
Cette phrase a pour moi la même signification que celle de Goethe.
Vous trouverez un article à ce sujet en suivant ce lien.
Si cet article vous a parlé, partagez-le avec vos proches.
Les commentaires sont bienvenus.
Bien à vous,
Guillaume Lemonde
[1] Extrait de la fiche Wikipédia : Johann Wolfgang von Goethe, né le 28 août 1749 à Francfort et mort le 22 mars 1832 (à 82 ans) à Weimar, est un romancier, dramaturge, poète, théoricien de l’art et homme d’État allemand. L’œuvre littéraire de Goethe comprend aussi bien de la poésie, que du théâtre, de l’épopée, de l’autobiographie, une théorie littéraire ainsi que des écrits scientifiques, Goethe étant passionné entre autres par l’optique, la géologie et la botanique. De plus, sa correspondance est d’une grande importance littéraire. Son roman, Les Souffrances du jeune Werther le rendit célèbre en Europe. Napoléon lui a demandé audience lors de l’Entrevue d’Erfurt. Avec Schiller et avec Herder et Wieland, il incarne le classicisme de Weimar. Son Faust est reconnu comme l’une des œuvres les plus importantes de la littérature de langue allemande.
Médecin, chercheur, développe et enseigne la démarche Saluto dans ses différents champs d'application. Après des études de médecine à Lyon, il découvre la pédagogie curative et la sociothérapie, alliant la pédagogie et la santé. Pour lui, la question de toujours est d’offrir l’espace et les moyens permettant à chacun de devenir acteur de sa vie. Il ouvre un cabinet en Allemagne où il poursuit ses recherches dans le cadre de l’éducation spécialisée, puis en Suisse.
À partir de l’étude des grands chapitres de la pathologie humaine, il met en évidence quatre étapes de la présence à soi et au monde (1995) et découvre et développe à partir de cette recherche la Salutogénéalogie (2007) et la démarche Saluto (2014).
Il donne des conférences et des séminaires de formation pour enseigner cette démarche.
Il est auteur de publications faisant état de ses travaux.
Article suivant
JEAN DE LA FONTAINE : "on rencontre sa destinée par des chemins qu'on prend pour l'éviter"
Vous aimerez aussi
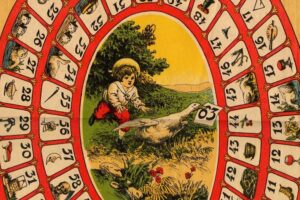
NOTRE VIE N’EST-ELLE QU’UNE SUCCESSION D’ÉVÉNEMENTS ?

MARIE MADELEINE SE TENAIT PRÈS DU TOMBEAU



1 commentaire
Merci pour cette fenêtre ouverte sur…la liberté