
L’ÉCOLOGIE ET LA MÉCANISATION DE L’ÂME
- Posté par Guillaume Lemonde
- Catégories Articles, Chroniques Contemporaines et Pensées, Démarche Saluto, Droit et société, Pédagogie, Temporalité
- Date 11 novembre 2022
L’écologie et la mécanisation de l’âme
En matière d’écologie il est assez commun d’entendre qu’il faudrait sensibiliser les populations aux gestes écocitoyens et que si tout le monde triait ses bouteilles et baissait le chauffage, la planète irait mieux… Nous allons voir que non seulement cette démarche est un leurre, mais encore qu’elle entretient le problème écologique.
Notons d’abord que la sensibilisation est une pratique qui attend que les gens se conforment à ce qu’on leur demande de faire. On attend qu’ils réagissent conformément à ce qui a été dit, qu’ils soient de bons citoyens respectueux des lois et des bonnes pratiques. Il y a les bons élèves et les mauvais élèves. Ceux qui ne trient pas leurs emballages en plastique sont des gens mal élevés. S’ils étaient à l’école, ils auraient une mauvaise note.
Évidemment, pour qu’une vie en société soit possible, chacun à des règles à respecter. Ce serait sinon le chaos. Par exemple, si l’on ne pouvait compter sur le fait que les gens se conforment au code de la route, la conduite automobile serait impossible.
Mais ceci étant dit, si l’on réduit la vie en société à l’observance de règles, que la raison ne peut d’ailleurs qu’approuver, une pathologie se met en place. Une pathologie due au manque d’une autre chose pourtant essentielle ; une autre chose que nous évoquerons tout à l’heure.
Cette pathologie se met en place déjà à l’école lorsque la pédagogie est focalisée sur la seule attente que les enfants se conforment à ce que nous attendons d’eux.
Là aussi, il est évidemment qu’à certains moments il est important que les enfants puissent faire exactement ce que nous attendons d’eux, mais imaginons que cette attente serait l’objectif pédagogique unique. Imaginons que pour nous un enfant bien élevé serait celui qui répondrait au doigt et à l’oeil à ce que nous disons, tout comme plus tard le bon citoyen qu’il sera devenu devra respecter les lois et les règles. Alors ayons conscience que si tel était le cas nous nous comporterions avec lui comme avec une machine ; au sens où c’est le propre d’une machine de répondre fidèlement à ce qu’on lui demande de faire.
Une pédagogie qui attend de l’enfant qu’il réponde toujours mieux aux consignes, a pour objectif ce que l’on pourrait nommer la mécanisation de l’âme. Elle attend que les enfants fonctionnent. On leur donne des instructions et ils doivent les suivre.
De même, la sensibilisation citoyenne s’appuie sur la mécanisation de l’âme qui est elle-même, comme nous allons le voir, la raison pour laquelle existe un grave problème écologique.
Comme il est attendu qu’un stimulus entraine une réponse, la mécanisation de l’âme induit un rapport au temps linéaire.
Pour l’âme mécanique tout est orienté des causes vers leurs conséquences. Une cause entraine une conséquence. C’est la base même de la logique. Et bien évidemment ce n’est pas la logique qui entraine la mécanisation de l’âme, mais la mécanisation de l’âme qui fait que seule la logique va compter pour elle.
L’âme devient rationnelle en se mécanisant et seul compte pour elle ce qu’elle conçoit par l’entendement.
Comme elle se trouve dans un monde de causes à effets, ce qu’elle va entreprendre est également là pour avoir un certain effet. Bref, pour elle, tout ce qu’elle fait doit servir à quelque chose. Cela doit la servir elle ou servir la collectivité, peu importe, mais servir à quelque chose. Être utile…
Pour son profit, le monde pourrait donc être amélioré. Pour l’âme mécanique, le monde n’est donc pas parfait. D’ailleurs, comment le serait-il puisqu’il n’est pour elle qu’une mécanique réductible à des lois mathématiques et physiques ? Aucune machine n’est parfaite. Toute machine peut être améliorée, augmentée, recréée…
Je dépose ici une première conclusion :
lorsque l’on attend des gens qu’ils se conforment à ce qu’on leur demande et que cette attente est le seul liant social que l’on puisse identifier, alors le monde et l’homme lui-même sont réduits à des machines imparfaites qu’il s’agit de perfectionner.
Une politique écologique basée exclusivement sur des bonnes pratiques écocitoyennes à respecter, induit un rapport au monde tel que celui-ci apparaît comme mécanique que l’on pourrait perfectionner et donc imparfaite. C’est un monde sans âme dont parle une telle écologie. Un monde que l’on ne peut pas aimer.
De la même manière et pour la raison exposée à l’instant, une pédagogie qui insiste sur les performances, qui demande aux enfants d’avoir de bonnes notes et qui va les classer selon leur rapidité d’assimilation des données transmises en cours, les conduit à percevoir le monde comme imparfait. Il semble n’être qu’une machine détraquée qu’il faudrait perfectionner pour qu’elle nous serve mieux.
Quand une machine est imparfaite, on la perfectionne pour que l’on puisse en tirer meilleur profit. On attend d’une machine que l’on puisse en profiter.
Et c’est là que la mécanisation de l’âme induit le problème écologique. En cherchant à maximiser les profits, tout comme d’ailleurs on cherche à ce que les enfants maximisent leur capacité d’apprentissage, on teste les limites de la machine. On essaie de les repousser.
En testant les limites des enfants, on les épuise. Ils ont besoin de vacances pour se reposer de l’école. En testant les limites de la planète, elle s’épuise elle aussi. Les ressources sont spoliées sans vergogne et les cycles naturels sont perturbés par tout ce qu’elle doit assimiler de déchets.
Une deuxième conclusion est la suivante :
comme les bonnes pratiques de triage que l’on demande aux gens de respecter font appel à la mécanisation de leur âme, elles puisent à la même origine que ce qui nous conduit à épuiser la planète vue comme une machine à notre service. Et comme elles sont de même nature, elles en font le jeu. Elles ne sont qu’un levier de plus pour essayer de préserver tout un système d’exploitation au plus près de son équilibre. Bref, on doit suivre ces bonnes pratiques écocitoyennes pour que surtout rien ne change dans notre rapport au monde.
Une véritable écologie demande donc tout autre chose que le seul respect de bonnes pratiques (individuelles, industrielles)…
Les bonnes pratiques sont importantes, mais elles ne sont pas au coeur de l’écologie. Elles ne devraient être que la conséquence d’une chose essentielle qui manque. Cette chose essentielle serait d’offrir aux gens la possibilité d’éprouver que la planète n’est pas une mécanique mais un être vivant. Et de façon à ce que cela ne reste pas une idée abstraite, il faudrait dès l’école développer un rapport au monde qui ne soit pas mécaniste, c’est-à-dire qui ne soit pas dans l’attente que les actes que l’on pose aient forcément un résultat tangible et prévisible.
On devrait par exemple interroger la pertinence de continuer de noter les élèves. Interroger les programmes et la façon de les concevoir.
La pensée mécaniste essaie de comprendre les lois du monde et les met à l’épreuve. C’est important de le faire. Mais quand elle s’intéresse à un élément du monde, une mouche par exemple, elle en analyse les parties, les place sous le microscope. Elle met la mouche à distance et ne s’intéresse qu’à sa mécanique biologique. Elle ne la voit pas autrement que morte puisque mécanique et cela ne la dérange pas de la couper en morceau pour mieux la comprendre.
Quand j’essaie de comprendre quelqu’un, je ne le coupe pas en morceaux, je l’écoute. Je tais les avis préconçus que je peux avoir, je fais silence au-dedans. Je ne me place pas dans un temps linéaire qui me conduirait à croire que cet entretien doit servir à quelque chose. Je me place au présent de l’entretien, sans attente particulière et j’écoute. Je tiens en conscience ce qui m’est dit. Je ne focalise pas sur un aspect de ce qui est dit, mais je tiens l’ensemble. Plutôt que d’uniquement mettre mon interlocuteur à distance par l’analyse de ce qu’il me dit, j’en goûte également la profondeur.
À l’école, regarder une mouche dans son contexte plutôt que sous un microscope, regarder comment elle bouge, comment elle se nourrit, etc. Même si cela ne sert à rien pratiquement… Même si l’on ne voit pas ce que l’on fera de tout ça, observer et retrouver cette mouche dans une poésie de Baudelaire, dans un texte médiéval, dans une fable de La Fontaine… Voir, percevoir, éprouver les liens entre les champs cognitifs.
Lorsque j’étais enfant, le paysan de mon village, avant de semer, arpentait son champ lentement.
Il regardait le ciel, se penchait pour prendre un peu de terre dans sa main rugueuse et la goûtait. Il goûtait sa terre et se remettait à marcher. Puis, après un moment, il commençait son ouvrage. Il prenait le temps d’être avec ce qu’il faisait, d’être avec la terre.
Prendre le temps de percevoir les liens qui unissent les aspects du monde plutôt que de focaliser sur un élément qui nous serait intéressant. Prendre le temps de ne rien attendre et de rencontrer ce qui se trouve là, tout autour.
Une pédagogie qui permet de tisser des liens entre les choses plutôt que de faire des enfants de petits experts utilitaristes, est à la base de l’écologie. La nature n’est pas un ensemble d’objets posés les uns à côtés des autres et qu’il faudrait gérer. Elle n’est pas réductible à un ensemble de ressources exploitables. Elle est profonde. Elle est profonde car elle est vivante et elle est vivante car elle a une âme. Une mécanique n’a aucune profondeur et ce qui n’a aucune profondeur est déjà mort (par exemple, un esclave, pour l’esclavagiste est un outil de travail. Il n’a pour lui aucune profondeur. Il n’est pas, à ce titre, un être vivant). Un être vivant a de la profondeur et l’on peut le rencontrer.
Comme on ne peut pas prévoir ce que la rencontre offrira (on ne peut prévoir que le fonctionnement d’une machine), ce qui arrivera est sans attente. Plutôt que d’escompter un intérêt, on deviendra disponible aux cadeaux qui seront faits.
Le paysan de mon enfance travaillait dur et recevait la récolte comme un cadeau. Nous fêtions les maïs de la fin de l’été, tous assis autour de la remorque pleine d’une belle récolte.
Les véritables actes écologiques ne s’inscrivent pas dans une mécanique sociale où chacun devrait remplir son rôle de rouage. Ce n’est pas le nombre des bons élèves qui fait l’écologie. Ce n’est pas quand chacun fait sa part, surveillant que l’autre fera bien la sienne. Ils s’inscrivent en revanche complètement dans l’attention que l’on porte aux choses et au monde. Dans l’attention que l’on porte à ce que l’on fait et dans le lien que l’on soigne avec tout cela.
La question écologique est d’abord un appel à la présence.
Tandis que les océans sont empoisonnés et que les forêts sont arrachées, tandis que l’eau, l’air, la terre sont salis, l’attention que nous offrons à ce que nous faisons est le coeur même de l’écologie. Mais à quoi cela servira-t-il, me direz-vous, d’offrir cette attention à l’ouvrage que l’on est en train de réaliser, alors que des questions plus urgentes comme la déforestation, menace la planète entière ? À rien, vous répondrai-je. Cela ne sert à rien, car l’écologie n’est pas là où ce que l’on fait sert à quelque chose de raisonnablement utile. Cela ne sert à rien, mais cela nous offre de percevoir le monde autrement que mécaniquement et de poser des actes en conséquence. Les réels gestes écologiques sont portés par cette expérience plutôt que par des consignes assénées par des médias. Ils sont portés par une école qui s’adresse aux enfants non pas comme des mécaniques à programmer mais comme des êtres à qui l’on essaie d’offrir le cadre idéal pour advenir à eux-mêmes et que l’on va aimer comme ils sont à chaque étape du chemin.
Le paysan de mon enfance faisait fonctionner son exploitation. Il avait besoin d’un certain rendement, mais il ne lui serait jamais venu à l’idée d’abimer ses sols pour avoir plus de rendement. Tout simplement parce qu’il aimait la terre qu’il cultivait, il aimait ce lieu.
Guillaume Lemonde
Médecin, chercheur, développe et enseigne la démarche Saluto dans ses différents champs d'application. Après des études de médecine à Lyon, il découvre la pédagogie curative et la sociothérapie, alliant la pédagogie et la santé. Pour lui, la question de toujours est d’offrir l’espace et les moyens permettant à chacun de devenir acteur de sa vie. Il ouvre un cabinet en Allemagne où il poursuit ses recherches dans le cadre de l’éducation spécialisée, puis en Suisse.
À partir de l’étude des grands chapitres de la pathologie humaine, il met en évidence quatre étapes de la présence à soi et au monde (1995) et découvre et développe à partir de cette recherche la Salutogénéalogie (2007) et la démarche Saluto (2014).
Il donne des conférences et des séminaires de formation pour enseigner cette démarche.
Il est auteur de publications faisant état de ses travaux.
Article précédent
EXISTE-T-IL UN MOT DÉSIGNANT LE TALENT D’AVANCER AVEC UN PROJET SANS SE PROJETER DANS LE RÉSULTAT ?
Vous aimerez aussi

DE PTOLÉMÉE À COPERNIC

LES VOYAGEURS DE LA STEPPE
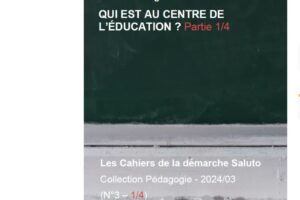


3 Commentaires
Merci Guillaume je lis toutes les semaines avec intérêt tes considérations. J’ai lu récemment un projet d’Emmanuel Macron. je t’envoie le lien je pense que ça peut t’intéresser
« 1 milliard d’arbres d’ici 2030 » pour faire face aux conséquences du réchauffement climatique. Une « politique du chiffre néfaste » : mieux vaut préserver les vieilles forêts. (https://reporterre.net/Planter-1-milliard-d-arbres-la-fausse-solution-du-gouvernement)
Merci pour cet article qui a vocation à clarifier les choses.
L’écologie tient aujourd’hui le haut du pavé, elle représente sans conteste le camp du bien dans une société de plus en plus injonctive.
Comme vous le démontrez, cette forme de démarche pour l’écologie entraîne une mécanisation de l’âme, partant de causes identifiées jusqu’à des conséquences salutaires.
Cette écologie raisonnable qui devient mécaniste, injonctive, utilitariste, dirigiste n’est pas l’écologie des êtres vivants. Elle déconnecte les liens entre le corps, l’âme et l’esprit. Elle nous réduit en réduisant nos liens aux autres, aux animaux, aux étoiles, aux arbres, etc..
Si cet aspect utilitariste et réductionniste n’est pas pris en conscience, si nous nous coupons de la perception d’un sens profond de la vie, d’une perfection et d’une intelligence de ce qui est, alors l’écologie qui devait être une recherche d’un meilleur équilibre entre l’homme et son environnement ne devient-elle pas progressivement le meilleur outil d’un pouvoir qui tente de nous soumettre à un modèle matérialiste, d’une société dite progressiste où dominent les techno-structures pour des humains augmentés par les robots?
L’écologie prescrite aujourd’hui dans les plus hauts sommets des dirigeants mondiaux n’est-elle pas cet outil au service d’une oligarchie qui cherche à conforter sa mainmise sur le monde et à en percevoir les intérêts escomptés?
Bonjour Guillaume
Ton texte me ramène à une lecture de F. Lenoir citant Spinoza qui distingue la loi divine « innée à l’âme humaine et comme inscrite en elle », qui conduit à la béatitude, de la loi religieuse (aujourd’hui la « religion écologiste »), qui vise à éduquer l’homme par des commandements en vue de la pratique de l’amour et de la justice.
… imposer une sorte de « servitude volontaire »-« faire que les hommes n’agissent jamais suivre leur propre décret, mais toujours sur le commandement d’autrui »- afin de favoriser la vie sociale ( plus globalement environnementale aujourd’hui)
Merci pour tes invitations
Christelle