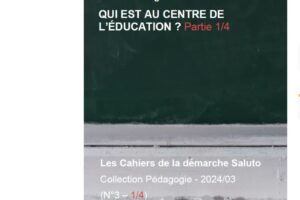MÉDECINE DURE OU MÉDECINE DOUCE ? LE FAUX DÉBAT
- Posté par Guillaume Lemonde
- Catégories Articles, Le Je, Santé et maladie, Temporalité
- Date 16 juillet 2021
L’originalité de la démarche Saluto est de donner les moyens de percevoir l’origine des difficultés rencontrées, non dans des causes passées à résoudre, mais dans la nécessité de faire advenir des ressources permettant de jouer librement avec ce qui se présente. Caractériser, identifier ces ressources fondamentales encore à venir et permettre d’exercer à les rendre présentes, est au centre de son expertise.
 MÉDECINE DURE OU MÉDECINE DOUCE ? LE FAUX DÉBAT
MÉDECINE DURE OU MÉDECINE DOUCE ? LE FAUX DÉBAT
L’éternelle opposition… Il y aurait d’un côté la médecine dure, celle des hôpitaux, de la chimie et du scalpel, celle des études en double aveugle et des données quantifiables. De l’autre la médecine douce dispensant des granulés sucrés et des tisanes. Si le dur rassure les uns par son sérieux, il inquiète les autres du fait de sa froide technicité. Si le doux rassure les sensibles, il inquiète les gens raisonnables qui n’y voit que charlatanisme pour âmes crédules.
Mais cette façon de classer les approches médicales reste extérieure à l’essentiel. Elle est purement quantitative, dressant une échelle allant de zéro intervention physique, restant dans le feutré de la caresse et dans le subtil de dilutions infinitésimales, à un maximum de gestes invasifs et délabrant. Vu comme ça, au zéro de l’échelle, on ne va pas si mal. C’est quand de vraies maladies se déclarent que l’on passe aux choses sérieuses et que l’on va dans le dur.
Bref, du point de vue de la médecine dure, la médecine douce serait pour les gens qui s’écoutent trop et se sentent malades alors qu’ils ne le sont pas réellement. Certains en voudront pour preuve que lorsque ceux-ci tombent malades pour de vrai, ils s’arrêtent de bricoler et passent aux choses sérieuses.
TENTATIVES DE FAIRE CONVERGER LES TENANT DE TELLE OU TELLE APPROCHE THÉRAPEUTIQUE
Lorsque certaines initiatives essaient de faire converger les tenant de telle ou telle approche thérapeutique, elles suivent à leur insu cette représentation quantitative. Certes, entre tenants du dur et du doux, on y cultive la volonté de se comprendre et c’est une belle chose en soi de ne pas en rester à ce que les études universitaires auront pu transmettre de dédain pour le non-conventionnel. Des échanges de fond peuvent enfin se faire. C’est assez nouveau. On n’aurait pas imaginé ça il y a vingt ans.
Toutefois, en collant à cette approche quantitative de ce qui différencie le dur du doux, les échanges de fond peuvent passer à côté de l’essentiel. Les thérapeutiques alternatives, tout en bas de l’échelle, en sont réduite au rôle de la cerise dont on veut bien orner le gâteau (le Sunday) sans fondamentalement changer le goût de la pâtisserie.
En restant soumise à cette échelle quantitative, la réelle volonté de se rencontrer en restera sans doute à la description des moyens diagnostiques et thérapeutiques pour lesquels on veut bien montrer de la tolérance et même de l’intérêt. Mais chacun continuera d’admettre que la médecine des doux est là pour la convalescence et qu’elle laissera sa place au sérieux du dur quand il le faudra.
Dans bien des pays, on distingue une assurance de base pour le sérieux et une complémentaire pour la cerise du gâteau.
En Suisse, la médecine homéopathique, la médecine d’orientation anthroposophique, la médecine traditionnelle chinoise et la phytothérapie sont reconnues par l’assurance de base suite à un référendum d’initiative populaire. Cette promotion sur l’échelle du sérieux a des avantages certains : les patients ont plus de facilité de soin, plus de remboursements, plus de choix de services. Elle a aussi l’inconvénient de devoir soumettre les prestations à un contrôle quantitatif de soins alors que ce n’est pas toujours en économisant du temps que l’on permet la santé.
ET LÀ SE TROUVE LE POINT TROP OUBLIÉ : LA SANTÉ.
Le sujet de la santé est au cœur des luttes intestines qui secouent la médecine. Tandis que l’on oppose la médecine dure à la médecine douce, la médecine conventionnelle aux médecines « alternatives » (alternatif comme l’est un second choix), voire « complémentaires » (comme la cerise complète le gâteau), ou même « parallèles » (parallèles qui ne se rencontrent jamais), on oublie de parler de la santé.
Ce qui peut unir tout le monde, ce pour quoi tout le monde veut œuvrer, c’est la santé. De la même façon, ce qui désunit tout le monde, ce sont les représentations que chacun se fait de la santé.
Ces représentations sont à examiner de près, car en fait, c’est sur ce point essentiel que se différencient réellement les approches médicales. C’est ce point qui rend souvent la convergence de leurs actions difficiles voire impossible.
Qu’est-ce que la santé ? Est-ce l’absence de maladie ? Autre chose ?
Quand quelqu’un vit une difficulté, qu’elle soit corporelle, psychique, spirituelle, comment fait-on pour que cette personne retrouve la santé ? En faisant disparaitre ce qui dérange ? En cherchant les moyens permettant de traverser l’épreuve ?
La santé peut être regardée selon deux points-de-vue (qui ne devraient pas s’exclurent l’un l’autre):
1- Faire disparaitre l’épreuve
Un problème se présente. On se tourne vers le passé à la recherche des causes qui pourraient en être à l’origine. Cela permet d’agir dessus pour en supprimer les effets. On a un diagnostic et on met en place une thérapeutique pour améliorer le pronostic.
Que la médecine soit « dure » ou « douce », « conventionnelle » ou « complémentaire », si elle suit ce chemin, elle adopte le point de vue selon lequel la santé dépend de la disparition du problème. La santé a été corrompue par quelque chose, que ce soit une cause génétique, infectieuse, toxique, énergétique, transgénérationnelle, psychologique, ou ce que vous voudrez. L’objectif suivi est de lever l’obstacle et de supprimer le problème.
Ce point de vue est celui de la pathogénèse.
Selon le point de vue de la pathogenèse, on cherche ce qui est venu perturber la santé du patient: le facteur pathogène est l’acteur de la maladie dont le patient est victime. Il convient donc de connaitre ce facteur pathogène. Plus on est fin dans la découverte des causes et mieux on pourra le faire. On aura besoin de moyens diagnostiques spécifiques et précis.
L’atteinte étant plus ou moins grande, la maladie plus ou moins prononcée, le symptôme plus ou moins grave, ce point de vue suit des considérations quantitatives.
Les façons de procéder seront donc classées en fonction de leur puissance d’action, de leur rapidité d’effet, et donc de leur efficacité. De ce point de vue il est donc légitime de classer les approches sur une échelle allant du doux au dur et à l’invasif.
**
2- Aider à traverser l’épreuve
Tout en considérant le facteur pathogène, certains n’oublieront pas qu’un obstacle ne constitue une épreuve que pour celui qui n’a pas les moyens de le franchir.
Autrement dit, l’obstacle n’est une épreuve que relativement aux ressources de celui qui le rencontre. Lorsque l’on comprend cela, on peut envisager la santé d’une autre façon : on la considérera comme ce qui est porté par la possibilité de traverser l’épreuve.
La santé n’est alors pas seulement vue comme un état perturbé par un facteur pathogène, mais comme résultant d’un processus s’expliquant avec un obstacle. Ainsi, le patient entre dans l’équation avec tout ce qui fait qui il est. Il a des ressources à découvrir pour traverser sa maladie. Cette maladie n’est plus un item générique mais un phénomène unique, puisque né de la rencontre d’un être unique, à un moment particulier de sa vie, avec une épreuve particulière.
La maladie, en exprimant la difficulté que le patient a de franchir un obstacle, devient par la même occasion l’opportunité de découvrir ce qu’il faut pour le traverser. Elle est pour lui l’occasion d’une maturation, d’un devenir. Cette maturation se fait sur à tous les plans. Corporel (immunologique, par exemple), psychique, spirituel.
Ainsi, du point de vue de la salutogenèse, la maladie n’est pas une panne, mais une tentative de guérison.
Par exemple,
quand il y a un virus dans l’air, tandis certains cherchent à supprimer le virus, d’autres perçoivent que cette épidémie est l’occasion d’une croissance immunitaire, mais aussi d’une maturation sur d’autres plans, que ce soit le plan psychique ou le plan spirituel. Cette épidémie est par exemple l’occasion d’apprendre à traverser la peur et d’exercer la confiance en la vie, l’engagement pour les autres…
Tout en protégeant ceux qui sont dans un danger important (pathogénèse), les thérapeutes, les médecins envisageront qu’il est également possible de faire un chemin à travers l’infection. Les gros moyens de réanimation tout comme ceux qui offrent le cadre permettant de se saisir en soi de ce qui faut pour rencontrer ce qui arrive sans être terrassé, seront alors en première ligne. La médecine dure et la médecine douce se retrouvent dans ce qui permet de dégager le terrain pour qu’advienne ce qui doit advenir. Offrir à la personne de passer à travers la crise (qu’elle soit corporelle, psychique, spirituelle).
Quand une fièvre se présente, il y aura toujours des gens qui voudront faire disparaitre la fièvre coûte que coûte dès qu’elle dépasse 37,8°C. D’autres accompagneront le malade à travers la fièvre.
Dans la vie, c’est en traversant une épreuve que l’on découvre en quoi l’épreuve était nécessaire pour exercer ce qui permettait de la traverser.
On découvre alors qu’elle est le sol sur lequel on s’appuie pour faire advenir une ressource nouvelle. En médecine, c’est la même chose.
Quand on ne pense qu’à vouloir supprimer les obstacles, on ne permet pas aux ressources manquantes d’advenir. On se prémunit d’un problème tout en devenant dépendant de ce qui a permis d’enlever le problème (par exemple on devient dépendant d’un médicament ou d’un vaccin auquel on doit recourir sans fin).
Voyez cet enfant apprenant à marcher… Supprimez lui la possibilité de tomber, supprimez l’épreuve de la chute en le laissant dans un tintébin, jamais il ne marchera de lui-même. Il restera dépendant de son tintébin.
De même, à un moment ou à un autre, on enlèvera les petites roues qui maintiennent le vélo. L’enfant risquera de tomber mais ce risque à travers lequel on accompagnera l’enfant, lui permettra de découvrir l’équilibre.
L’obstacle est le point d’appui pour une ressource nouvelle. Il est l’opportunité d’une maturation. Cela ne se fait pas automatiquement, puisque ce n’est pas l’obstacle qui permet la maturation, mais il est le champ d’expérience nécessaire à la maturation.
De ce point de vue, la médecine, même si elle utilise des granulés et des tisanes, n’est pas forcément douce. En fait, les termes de médecines douces, complémentaires ou parallèle, n’ont pas leur raison d’être ici.
On devrait parler tout simplement de salutogenèse.
La salutogenèse s’intéresse non pas à ce qui est l’origine des maladies, mais à ce qui est à l’origine de la santé. Et cette origine se tient en une maturation à favoriser, une ressource à venir.
La santé n’est pas, de ce point de vue l’absence de maladie, mais ce qui permet de traverser la maladie.
En lisant ces lignes, ceux qui adoptent le point de vue pathogénique seront pris dans un paradoxe intenable pour eux, celui d’entendre que l’on puisse être en parfaite santé, même pendant une maladie symptomatologiquement expressive.
Il y a de bonnes grippes (celles qui sont traversées sainement) et de mauvaises grippes (ou le malade semble ne plus avoir de ressources pour traverser la maladie).
Le rôle du médecin, du thérapeute, c’est de faire la différence entre les deux et d’adapter le traitement en fonction.
DONC ATTENTION DE NE PAS OPPOSER SALUTOGENÈSE ET PATHOGENÈSE
Tant que l’on peut supprimer le facteur pathogène, fort d’une technique efficace, on risque d’oublier l’être qui fait chemin avec la maladie. Et c’est au moment où l’on ne croit plus rien pouvoir faire que l’on baisse les bras et que l’on renvoie le patient chez lui. On invente les soins palliatifs…Mais ils ne sont palliatifs que du point de vue de la pathogenèse. Du point de vue de la salutogenèse, ce sont des soins essentiels. Soudain on prend conscience que l’épreuve est un champ d’expérience nécessaire à la maturation intérieure.
En fait, la qualité que l’on offre à la rencontre dans un service de soin palliatif, devrait se retrouver dans tous les services de médecine. Connaitre la maladie et le facteur pathogène à combattre et connaitre la personne qui chemine avec cette maladie, pour elle unique et nécessaire à une maturation intérieure. Comme l’épreuve dépend de la ressource que cette personne recherche, on aura également conscience que les épreuves rencontrées sont potentiellement à la hauteur des ressources qui sont en train d’advenir. Mais parfois l’épreuve semblera trop grande et l’on fera en sorte d’en atténuer la difficulté.
Le point de vue de la salutogenèse implique la notion de risque…
Notion difficile à une époque où même une simple fièvre, pourtant salutaire pour la défense immunitaire, peut faire peur ; et où l’on verra bientôt des enfants jouer à la balançoire munis d’un casque de protection…
Pourtant, en cherchant le risque zéro, on supprime le terrain sur lequel on peut découvrir de quoi prendre pied dans la vie.
La conséquence est que l’on retire à celui qui chemine, sa santé. Les mesures qui cherchent à atteindre le risque zéro, fragilisent la santé.
La recherche de risque zéro et un aveuglement à l’égard de l’être qui chemine. Partout où l’on cherche le risque zéro, on ne voit qu’un contexte où circule une foule anonyme.
MÉDECINE DOUCE, MÉDECINE DURE… LE DÉBAT N’A PAS LIEU D’ÊTRE.
La question est plutôt de savoir si, en se tournant vers le passé pour comprendre d’où vient le problème qui dérange, on n’oublie pas de se tourner aussi vers l’avenir, vers ce qui advient ; vers l’être en devenir qui s’approche de lui-même en traversant ce problème.
Cela demande d’avoir une perception de ce qui est sain en l’être et qui demande à advenir (cela n’est pas du tout enseigné dans les facultés de médecine). Cela demande à considérer la maladie non comme une simple panne mais aussi comme une tentative de guérison : une tentative de se proposer de quoi traverser quelque chose de nécessaire pour trouver ce qui manquait.
Et le rôle du thérapeute est alors de dégager le chemin pour que ce qui est sain puisse advenir et se révéler.
Aussi, chaque problème rencontré dans la vie, loin d’être une simple panne, témoigne, parfois jusque dans la chair, qu’un être en devenir s’approche de lui-même. Ce n’est pas juste une jolie formule. Cela demande un diagnostic particulier et thérapeutique adaptée. Cela demande un apprentissage permettant de proposer le cadre favorisant ce qui est en train d’advenir (c’est le sujet des formations Saluto), de façon a ce que soit rendue possible une réelle guérison et non pas simplement un contrôle thérapeutique du symptôme problématique.
Ainsi, chaque problème, chaque maladie est tout à la fois une panne qu’il s’agit de résoudre (ce qui est bien enseigné à la faculté de médecine) et l’opportunité d’une croissance intérieure (permettant la guérison). Se tenir dans cet intervalle paradoxal permet d’approcher l’essence de la santé et de dépasser les débats stériles au sujet des pratiques médicales. Débats qui témoignent tout à la fois d’une médecine malade de ne pouvoir se tenir dans un tel paradoxe mais aussi d’une tentative de guérison de la médecine.
Guillaume Lemonde
BLOG – DERNIERS ARTICLES MIS EN LIGNE
Médecin, chercheur, développe et enseigne la démarche Saluto dans ses différents champs d'application. Après des études de médecine à Lyon, il découvre la pédagogie curative et la sociothérapie, alliant la pédagogie et la santé. Pour lui, la question de toujours est d’offrir l’espace et les moyens permettant à chacun de devenir acteur de sa vie. Il ouvre un cabinet en Allemagne où il poursuit ses recherches dans le cadre de l’éducation spécialisée, puis en Suisse.
À partir de l’étude des grands chapitres de la pathologie humaine, il met en évidence quatre étapes de la présence à soi et au monde (1995) et découvre et développe à partir de cette recherche la Salutogénéalogie (2007) et la démarche Saluto (2014).
Il donne des conférences et des séminaires de formation pour enseigner cette démarche.
Il est auteur de publications faisant état de ses travaux.
Article précédent
J.W. VON GOETHE : « Mon application à voir les choses comme elles sont… »
Vous aimerez aussi

DE PTOLÉMÉE À COPERNIC

LES VOYAGEURS DE LA STEPPE