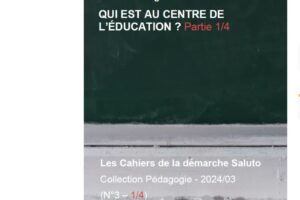LA MORT ET LA SOURCE DE LA VIE
LA MORT ET LA SOURCE DE LA VIE
Une revue médicale fait écho des dernières recherches au sujet du vieillissement cellulaire. En quelques lignes il nous est expliqué que nous sommes en bonne voie de savoir comment régénérer indéfiniment les cellules souches. Cela pourrait permettre de repousser la mort ad aeternam. Mais tandis que l’article se montre très positif à ce sujet, j’imagine quant à moi un monde où personne ne mourrait. Qu’arriverait-il si cela se réalisait ? À quoi ressemblerait une existence sans fin ?
L’expérience est intéressante : déplaçons la fin de l’existence à l’infini. Prenons le temps d’imaginer la mort toujours plus loin, en un point que jamais on n’atteint. Ce faisant, nous assistons à quelque chose de curieux : le mouvement qui mène à la mort s’étire et il s’étire tant et si bien qu’il ralentit. C’est mathématique. Quand la fin est lointaine, le vieillissement devient lent. Lorsqu’elle est à l’infini, il s’arrête. Il n’y a plus de transformation possible, plus de métamorphose. Si on fait disparaître la mort, le temps de la vie se fige. Est-il encore mesurable avec une montre ? Rien n’est moins sûr, car tandis que la conscience de l’immortel s’étire sur un temps infini, les mouvements de l’aiguille au cadran de sa montre s’accélèrent d’un même infini, au point de se dérober au regard. Le temps n’a plus de réalité pour un observateur immortel. Attendre cinq minutes ou un siècle ne fait pas de différence à la mesure de l’éternité.
Ainsi, la mort engendre le temps tel que nous le connaissons.
D’une manière plus nuancée, disons que ce qui se manifeste à travers la mort est à l’origine du temps tel que nous en faisons l’expérience. Une telle découverte mérite d’être méditée. Ce n’est pas commun de voir la mort à l’origine du temps et de comprendre que c’est parce que nous sommes mortels que le temps existe tel que nous le connaissons. D’autant qu’avec le temps, c’est également la vie qui est rendue possible. N’est-ce pas dans la durée que se manifestent les transformations et les métamorphoses ?
Alors envisageons la mort comme ce qui rend possible le temps et la vie et allons plus loin.
Il faut bien reconnaître que si ce qui agit à travers la mort se tient à l’origine du temps, cela prend la fonction d’un principe quasi divin ou pour le moins – en sortant d’un vocable religieux – d’un principe fondamental qui dépasse de beaucoup l’événement final de l’existence. Cela ne peut pas se résumer au trépas, de même que la vie ne se résume pas à la fécondation.
Ce qui agit à travers la mort est donc à la fin de tout, mais aussi au début de tout puisqu’à l’origine du temps. C’est l’Alpha et l’Oméga ; le souffle qui fait croître et décroître toute chose et qui porte toutes les métamorphoses, comme nous le disions déjà. C’est le « Meurs et Deviens » du célèbre poème de Goethe « Bienheureux désir ».
Ainsi, depuis le moment de notre trépas, ce qui agit à travers la mort est actif à chaque instant de notre vie. Mais cela nous pose une question de plus : comment cela peut-il agir maintenant depuis un moment situé plus tard ? Comment une cause peut-elle être postérieure à ses effets ? En fait, ce paradoxe se résout lorsque l’on s’ouvre à la possibilité que ce qui agit à travers la mort puisse pénétrer notre existence selon un temps inversé ; selon un courant temporel qui s’en vient vers nous depuis l’avenir plutôt que d’aller logiquement du passé vers le futur.
En français, nous avons deux mots pour distinguer ces deux temporalités.
Nous parlons de futur lorsque nous prolongeons ce que nous connaissons selon la flèche du temps. Le futur est donc ce que nous pouvons prévoir. On parle, par exemple, des futurs époux. On peut prévoir qu’ils vont se marier puisqu’ils ont publié les bans de mariage. À l’inverse, nous parlons d’avenir (littéralement « ce qui advient ») lorsque nous évoquons un temps qui s’en vient à nous, un temps qui s’approche de nous, tel un fleuve dont nous remonterions le courant. L’avenir ne suivant pas un enchainement logique de causes à effets, est imprévisible. Nul ne connaît ni le jour ni l’heure.
Autant nous pouvons prévoir avec certitude que nous mourrons – la mort biologique est dans notre futur comme une chose que nous pouvons prévoir. Autant ce n’est pas en la prévoyant que nous en ferons l’expérience. Le futur n’est qu’une projection, un pronostic s’appuyant sur une espérance de vie à évaluer. Il n’est qu’une abstraction née d’un jeu de probabilités. Mais depuis l’avenir, c’est concrètement que ce qui agit à travers la mort s’en vient. Cela agit selon un courant traversant toute notre existence depuis le dernier souffle jusqu’au premier. Ce courant inversé du temps, la nature nous en offre une image lorsque l’on pense aux saumons remontant un fleuve jusqu’à sa source. À chaque instant, l’eau qu’ils rencontrent est de la source qui s’approche d’eux. Et cette source où ils viennent mourir est en même temps celle où ils sont nés. Ils sont avec elle tout au long de leur voyage.
De même nous pouvons rencontrer, grâce à ce qui agit depuis l’avenir à travers la mort, la source de la vie à chaque instant de notre existence ; et c’est elle que nous rejoignons au moment du décès. C’est pourquoi, si nous ne pouvions plus mourir, nous perdrions en même temps que le temps d’un voyage sur la Terre, (temps qui se muerait en une immobile perpétuité), la vie telle que nous la connaissons. Nous serions, tels des morts-vivants, ni vivants, ni morts ; les hôtes obscurs d’une Terre ténébreuse (Goethe « Bienheureux désir » in Le divan oriental).
Supprimez la mort et vous tarissez en chacun la source, c’est à dire l’endroit d’où tout émerge.
Vous retirez à chacun un accès à l’origine du monde. Sans la mort, personne, à aucun moment de son existence ne pourrait plus être relié à rien. Non seulement le monde disparaîtrait pour nous, mais nous serions également dans une solitude sans nom. Un monde où l’on ne mourrait pas, serait un enfer. Un enfer glacial, où personne se serait en mesure d’aimer.
Les essais d’empêcher le vieillissement dans l’espoir d’abolir la fin de l’existence, sont probablement voués à l’échec. La mort n’est pas l’aboutissement d’une sénescence. Ce n’est qu’en apparence, sur le plan matériel seulement, que les dysfonctions organiques conduisent au trépas. En réalité, il conviendrait d’opérer un retournement intérieur et de considérer ce mystère depuis un point de vue placé dans l’avenir tout en regardant à rebours. On s’apercevrait que, depuis l’heure du trépas, agit dans toute l’existence ce qui permet la vie dans toutes ses métamorphoses.
Il existe des recherches pleines de promesses a priori, des recherches tellement intéressantes et qui, pour ne rien gâcher, rassurent les peurs qui nous habitent, en promettant de les faire disparaitre. Telles sont celles qui tentent d’abolir la Mort. Beaucoup de gens fondent de grands espoirs dans ce qui pourrait être découvert. Cela conduira d’ailleurs probablement à de nombreuses applications médicales. Mais les chercheurs n’ont pas à s’en préoccuper. A-t-on demandé à Marie Curie de prévoir Hiroshima ? Mendel n’est pas non plus responsable des manipulations du génome humain que le XXIème siècle connait. Les chercheurs font de la recherche fondamentale et savent que, de toute façon, à partir de n’importe quoi de bon, on peut faire quelque chose de mauvais. Pourtant, en ce qui concerne la mort, on s’attaque aux fondements de notre existence. Si nous prenions le temps de penser ne serait-ce qu’un peu au sujet de ce mystère, aurions-nous encore la motivation de faire advenir un monde qui ne peut être que sans amour ?
Guillaume Lemonde
Un autre article qui pourrait vous plaire : J’AIME TROP LA VIE POUR VOULOIR ÊTRE IMMORTEL