
QUAND UNE PSYCHOSE PARANOÏAQUE S’EMPARE DE LA SOCIÉTÉ
- Posté par Guillaume Lemonde
- Catégories Actualité, Articles, Chroniques Contemporaines et Pensées, Démarche Saluto, Droit et société, Pédagogie, Relation thérapeutique
- Date 17 novembre 2023

QUAND UNE PSYCHOSE PARANOÏAQUE S’EMPARE DE LA SOCIÉTÉ
Nous sommes ouverts au monde par nos sens. Nous en rencontrons à travers eux les formes les plus diverses, les plus variées. Des formes visuelles, évidemment, mais aussi olfactives, auditives…
En fait, toutes les informations que nous recevons sont permises directement ou indirectement par la sensorialité, ce qui d’ailleurs laisse supposer que les sens sont plus que les cinq généralement répertoriés (1). Nous avons par exemple une proprioception, à distinguer du sens du toucher. Le sens du toucher permet de percevoir les limites de notre corps, alors que la proprioception permet de percevoir plus ou moins consciemment les différentes parties de celui-ci. Nous avons une sensorialité intéroceptive qui nous permet de percevoir les dysfonctionnements corporels grâce à des alertes lorsqu’un déséquilibre survient. Le plaisir et le bien être sont pour la sensorialité intéroceptive ce que l’agréable silence est pour l’ouie. Nous avons une sensorialité kinesthésique qui nous donne une information au sujet de la position du corps dans l’espace. Quant au sens de l’équilibre, il nous permet de nous orienter par rapport au centre de la Terre. Nous pouvons également percevoir, au-delà du sens de l’ouïe ou de la vue, qu’un son, qu’un geste ou qu’une suite de chiffres ou de lettres puissent constituer un langage. Nous avons un sens pour cela. Et au-delà de cela, nous avons la possibilité de percevoir le fil d’une pensée, et même de percevoir que cette pensée est émise par un être humain (perception qui, comme toute perception, peut être brouillée par des subterfuges dont A. Turing (2) avait conscience).
Or, chaque information sensorielle agit sur notre état intérieur. Nous avons un mouvement d’ouverture ou de fermeture pour chacune d’elles; des sentiments de sympathie ou d’antipathie.
En termes psychologiques, nous pouvons dire que la fonction sensorielle détermine naturellement notre fonction affective.
Cela ne s’arrête pas là, puisqu’alors les mouvements intérieurs agissent sur notre faculté de jugement. Ils en font un jugement de valeur. Comme le dit Spinoza, « nous ne désirons pas les choses parce qu’elles sont bonnes, mais nous les déclarons bonnes parce que nous les désirons ».
Le jugement de valeur détermine à son tour un cadre de référence. Nous associons en fonction de lui nos représentations du monde d’une certaine façon.
Et alors, c’est le cadre de référence qui à son tour détermine notre sensorialité : nous percevons du monde ce que nous sommes prêts à percevoir.
Et la boucle est bouclée.

Ce cercle vicieux est à l’origine de tous les biais cognitifs. Il s’ouvre en revanche lorsque l’on devient présent à chacune de ces quatre fonctions psychique. Lorsque nous devenons présent au monde intérieur et rencontrons la frustration. C’est un enjeu de l’éducation de la petite enfance. Lorsque nous devenons présent aux perceptions, c’est un enjeu de l’éducation de l’école primaire. Lorsque nous devenons présent aux jugements de valeur et rencontrons le jugement de fait, c’est un enjeu de l’adolescence.
***
Ce que je voudrais vous exposer aujourd’hui est une illustration malheureuse des effets d’un tel cercle vicieux laissé à lui-même. Cela survient à l’adolescence, par un manque de soin apporté à la faculté de jugement. Cela survient lorsque le désir (appartenant à la fonction affective), vient nourrir la valeur de soi (faculté de jugement).
Par nature, le désir frustré refuse le réel qui ne peut le satisfaire. Il le veut autrement et s’il est le seul maître à bord, il le recrée dans ses moindres formes. Il pousse le jugement à un point de vue qui devient une conviction ne supposant aucune opposition. Et cette conviction s’érige en un principe moral – là où Hegel nous rappelle que la seule conviction ne suffit pas à en fonder un (3).
Si ce désir frustré est laissé à lui même, si l’éducation n’apporte pas d’une façon ou d’une autre un contre poids (nous allons voir tout à l’heure lequel), cette toute-puissance peut s’étendre à une masse d’individus agglutinés en une même frustration. Ils deviennent victimes d’une forme de délire, une psychose collective. Au-delà de la névrose qui ne remet pas en doute le réel et cherche des stratégies pour ne pas trop en souffrir, l’état psychotique nous place dans un autre monde et prend même un caractère paranoïaque quand le désir se sent menacé par le réel (4).
Nous avons tous rencontré les manifestations de cette folie répandue aujourd’hui dans notre société. Fondée sur un délire de persécution (paranoïa), elle se retourne contre ceux qu’elle reconnaît comme étant opposés à ce que dicte le désir comme valeurs identificatoires. Elle désigne des ennemis, ceux qui ne partagent pas le point de vue de sa lutte. Les « anti- » ou les « pro- », les « -phobes »… (« islamophobes », « grossophobes », « homophobes », « transphobes », etc.) et elle les persécute, les harcèle, se disant harcelé par eux. C’est le propre de la paranoïa que de persécuter plutôt que de l’être soi-même et d’inverser les rôles.
Pour ce faire, elle use de la manipulation émotionnelle (les bons sentiments et la mauvaise conscience) ou même mentale, en créant des néologismes (5) empêchant de penser clairement : quand la néo-réalité est préférée au réel, les concepts deviennent nécessairement flous, puisque ils ne possèdent pas les contours nets du réel que permet de percevoir notre sensorialité.
C’est ainsi que, plutôt que de parler de réalités biologiques tangibles, comme par exemple d’hommes et de femmes, cet état psychotique infiltrant la société ne reconnaît plus les sexes et nous fait parler de genres. Genre est d’abord une catégorie grammaticale. Lorsque ce mot est utilisé loin du réel, sa définition devient floue. D’ailleurs, le dictionnaire Larousse ne parvient pas à en donner une définition précise (6) : « Concept qui renvoie à la dimension identitaire, historique, politique, sociale, culturelle et symbolique des identités sexuées. (Cette notion récente est en constante évolution.) » Ce mot est un fourre-tout où chacun met ce qu’il veut selon son propre désir, puisque c’est le désir qui préside à ce phénomène, comme nous l’avons vu.
Ainsi, le développement sain des adolescents nécessite qu’ils rencontrent le principe de réalité (les formes du monde doivent pouvoir agir sur la fonction affective, sur le sentiment même si elles ne nous plaisent pas -voir le schéma ci-dessus). Faute de quoi, de plus en plus de personnes quittent le réel et se mettent au service de cette psychopathologie. Elles ne sont pas psychotiques elles-mêmes, mais subissent la suggestibilité de cette folie, contagieuse par nature, puisqu’elle bloque la pensée par des concepts flous et soumet les sentiments à la manipulation émotionnelle.
En ce début de XXIe siècle, les adolescents ont grandement besoin de développer une pensée rigoureuse et d’éprouver l’existence des faits, indépendamment de leurs désirs. Ça leur est fondamental pour apprendre à rester en contact avec le réel tandis que la frustration les prend. C’est essentiel à l’expérience de la frustration, qui, lorsque le réel n’est pas oublié, permet de rencontrer une limite, d’être renvoyé à soi-même et de se centrer plutôt que de s’épancher sans égard pour l’altérité ni pour le réel.
Les réalités du monde sont à enseigner aux adolescents, dans leurs faits les plus exacts. Le monde n’est pas virtuel, mais factuel. Les adolescents ont soif de faits. Comment fonctionne un métier à tisser ? Une centrale nucléaire ? Un moteur à explosion ? Comment sont constitués le système cardiovasculaire, les organes de la reproduction ? Ce n’est pas tant l’accumulation de connaissances qui compte, mais l’effort de comprendre et d’assimiler un sujet dans ses moindre détails. De même, une règle de grammaire, une formule mathématique…
Une activité artistique est également l’occasion d’éprouver que les faits du monde ont leur réalité propre : une pierre qu’il s’agit de sculpter, un fusain qu’il s’agit d’appliquer sur une feuille, un instrument de musique qu’il s’agit de maîtriser, ou le corps dans son mouvement lors d’une pratique sportive.
Ils ont besoin de « règles du jeu » précises, et tenues par ceux qui les ont décidées : un devoir non rendu a telle conséquence prédéfinie, une absence a telle autre conséquence prédéfinie. Aucun arbitraire. L’arbitraire s’appuie sur un jugement de valeur, soumis aux fluctuations des sentiments et c’est pour cela que les règles doivent être prédéfinies : cela empêche l’arbitraire.
Lorsque les adolescents sont considérés comme de jeunes adultes que l’on prend pour partenaires dans l’élaboration de projets, attentifs à ce qu’ils désirent, nous oublions qu’ils ont également besoin de faire l’expérience de faits auxquels ils doivent se soumettre. Ils ont un grand besoin de pouvoir prendre des initiatives, mais que ce soit dans le cadre d’un projet prédéfini qu’ils n’ont pas le choix de remettre en question. Ils ont besoin de se sentir libres, mais que ce soit dans un cadre aux bornes claires, de façon à ce qu’ils puissent s’éveiller au réel. Bien sûr, il y a l’art et la manière pour les conduire à s’y conformer. Cela nécessite pour le moins de ne pas user comme eux de jugements de valeur (propre à l’autoritarisme). Nous avons vu qu’ils sont fragiles à l’endroit des jugements de valeur et cela ne peut que les braquer. Mais en aucun cas, la difficulté que nous pouvons avoir de leur donner une ligne de conduite ne devrait entraîner un abandon de poste et les laisser décider de tout et de rien, comme par exemple de quitter une activité avant la fin, parce qu’ils estiment qu’elle est trop difficile pour eux ou sans intérêt. Il est essentiel qu’ils puissent être rattrapés par des faits, qu’ils aient des balises claires sur leur chemin et que ces balises soient élaborées spécifiquement pour eux, mais pas avec eux (de façon à exclure du jeu leur désir qui n’a pas à décider des réalités du monde).
Bien sûr, lorsque l’on parle de règle du jeu et de faits à respecter, cela demande de la part du parent, du pédagogue, exactement ce que l’adolescent n’a pas : la constance, l’engagement, la vaillance d’avancer pas-à-pas. En effet, la règle, on l’enfreint lorsqu’on se projette dans un résultat espéré (désiré) en s’évitant de se confronter aux faits. L’adulte, quant à lui, même si la chose qui l’occupe est difficile, peut mettre toute son attention à ne pas se projeter dans le résultat et à avancer pas-à-pas avec son projet, même si le chemin ne lui plaît pas.
Puis-je apprendre un cours, même si je ne le trouve pas à mon goût ? Un jeune adolescent n’en a pas la capacité, pour la bonne raison que c’est justement ce qu’il a à découvrir pendant ces années allant de la puberté à la majorité.
Une telle éducation (au sujet de laquelle il serait possible de dire bien d’autres choses encore) est un facteur de santé pour l’adolescent lui-même, mais également un remède pour toute la société.
Bien à vous
Guillaume Lemonde
Bibliographie :
1- Philippe Perennès, RENCONTRE AVEC LES 12 SENS, Fédération des écoles Steiner-Waldorf en France, 2007.
2- Alan Turing, COMPUTING MACHINERY AND INTELLIGENCE, 1950. Turing décrit un test consistant à demander à une personne de distinguer si l’interlocuteur, avec lequel elle ne peut entrer en contact que par l’intermédiaire d’un clavier d’ordinateur, est humain ou un programme informatique. https://redirect.cs.umbc.edu/courses/471/papers/turing.pdf
3- W. Hegel, PRINCIPES DE LA PHILOSOPHIE ET DU DROIT, première édition 1821, Edition Vrin.
4- Ariane Bilheran, PSYCHOPATHOLOGIE DU TOTALITARISME, Edition Guy Trédaniel, 2023.
5- Nicolas Brémaud, LES NÉOLOGISMES PSYCHOTIQUES, dans Perspectives Psy, 2022/1 (Vol.61), pages 74 à 83.
6- Dictionnaire Larousse en ligne, entrée : GENRE.
Médecin, chercheur, développe et enseigne la démarche Saluto dans ses différents champs d'application. Après des études de médecine à Lyon, il découvre la pédagogie curative et la sociothérapie, alliant la pédagogie et la santé. Pour lui, la question de toujours est d’offrir l’espace et les moyens permettant à chacun de devenir acteur de sa vie. Il ouvre un cabinet en Allemagne où il poursuit ses recherches dans le cadre de l’éducation spécialisée, puis en Suisse.
À partir de l’étude des grands chapitres de la pathologie humaine, il met en évidence quatre étapes de la présence à soi et au monde (1995) et découvre et développe à partir de cette recherche la Salutogénéalogie (2007) et la démarche Saluto (2014).
Il donne des conférences et des séminaires de formation pour enseigner cette démarche.
Il est auteur de publications faisant état de ses travaux.
Vous aimerez aussi

DE PTOLÉMÉE À COPERNIC

LES VOYAGEURS DE LA STEPPE
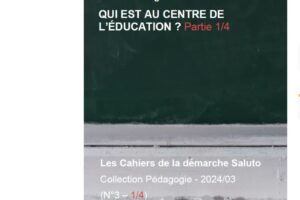

2 Commentaires
J’ai trouvé cet article de fond très intéressant, comme d’habitude ; à votre bibliographie, vous pourriez ajouter “Psychosophie” de Rudolf Steiner.
Merci beaucoup Guillaume
C’est très précieux et d’actualité ton article ( comme d’habitude)